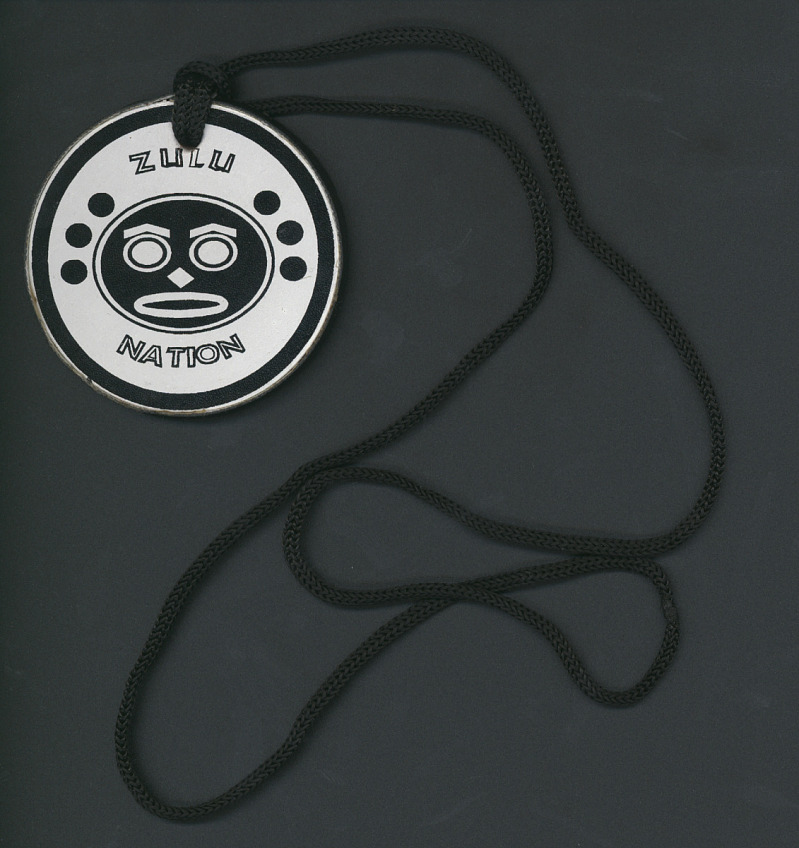française
Le grand retour des années 80
Suscitant un intérêt grandissant tant auprès des experts que d’un large public, la bijouterie et la joaillerie des années 1980 sont pourtant encore peu étudiées. Ce triptyque d’articles co-écrit par Emilie Bérard et Marion Mouchard a pour objet d’introduire une réflexion sur l’histoire de la création joaillière de cette décennie, ses caractéristiques stylistiques et ses codes.
L’ampleur du sujet et l’accès aux sources induisent la nécessité du choix, que ce soit quant aux créateurs pris pour exemple qu’aux foyers géographiques auxquels ils appartiennent. Seront majoritairement cités des joailliers dits "traditionnels" ainsi que quelques noms de bijoutiers-artistes, mais ne pourront être abordés, par exemple, la bijouterie fantaisie et les bijoux de couturier. De même, si les conventions ornementales de certains groupes sociaux étaient développées, il serait impossible de réunir ici les codes bijoutiers de la myriade de contre-cultures animant cette période. Il est important de souligner la diversité de pays et d’expressions culturelles qu’il reste encore à mettre en lumière pour dresser une histoire mondiale de la bijouterie et de la joaillerie de cette décennie.
Cette série d’articles se focalisera sur l’importance sémantique du bijou dans les interactions sociales en Occident. Les multiples sens qui conditionnent le port du bijou peuvent être conceptualisés comme des forces opposées mais bien souvent poreuses.
Au cours des années 1980, la tension entre conformisme et individualité est plus que jamais un enjeu que ce soit dans les milieux conservateurs qu’au sein des contre-cultures.
Article I : Bijoux et culture Hip-Hop
Article II : Bijouterie de pouvoir, entre conformisme et individualité
Article III : Logotypes et citations patrimoniales
Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.
Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.
Publicité Fred (détail), 1984, Paris, Bibliothèque Forney.
Logotypes et citations patrimoniales
Par Emilie Bérard et Marion Mouchard
Dans le contexte de récession économique ouvrant la décennie, la classe active affiche son pouvoir de consommation au travers d’une bijouterie siglée, parfois à outrance, et de modèles reconnaissables et donc aisément attribuables à une marque de luxe.
Si, dans le cas de cette clientèle, le but est de revendiquer son appartenance à un groupe socio-économique par un conformisme des apparences, en ce qui concerne les maisons de joaillerie, l’objectif est au contraire de se singulariser. Ainsi Cartier qui adopte pour ses publicités le slogan : « L’art d’être unique ».
A- Les bijoux à logotypes
Pour la première fois, le logotype1 ou logo des marques de luxe, jusqu’alors réservé à la publicité, devient un ornement à part entière tant pour le bijou que pour le vêtement, comme on l’observe par exemple chez Moschino, Chanel ou encore Versace.
Cette quête identitaire est avivée par l’explosion de la contrefaçon2 contre laquelle les gérants de grandes maisons de joaillerie tentent de lutter. La plupart se contentent de les traquer et de les racheter pour les détruire. Alain Dominique Perrin, président de Cartier, souhaite mettre à profit cette situation pourtant désavantageuse. La montre Tank est alors l’un des modèles joailliers les plus copiés. Il s’emploie à mener de vastes campagnes de collecte de montres contrefaites puis à organiser publiquement leur destruction par un rouleau compresseur, mise en scène diffusée, qui plus est, en France au journal de 13h3. Alain Dominique Perrin va jusqu’à confier quelques exemplaires de fausses montres au sculpteur César pour concevoir une Compression qu’il installe ostensiblement sur son bureau de la boutique Cartier, rue de la Paix. Par là même, la marque affiche un double succès : elle détourne l’impact négatif des contrefaçons en démontrant que leur nombre n’est que le reflet du succès de leurs créations, et suscite d’autant plus le besoin en transformant des campagnes de répression en véritables coups publicitaires.
En somme, le phénomène des bijoux à logotypes apparaît dès le début des années 1970 dans la production de maisons de joaillerie expérimentant une crise à la fois économique et identitaire. Il trouve cependant tout son épanouissement au cours de la décennie suivante.
La maison Bulgari
Ainsi, dès 1975, la maison Bulgari développe une édition limitée de montres numériques portant l’inscription « BVLGARI ROMA » destinée aux cent meilleurs clients de la marque à l’occasion des fêtes de Noël. À partir de ce bijou promotionnel, Bulgari crée la montre BVLGARI BVLGARI. Ce modèle, conçu en 1977, se distingue par la présence du logotype de la maison gravé sur sa lunette pour seul ornement.
Inventé en 1934, le logo se caractérise par une typographie latine, en capitales romaines. Sa disposition, suivant le pourtour de la montre, évoque les inscriptions numismatiques. À l’image de la collection Monete de 1966, la montre BVLGARI BVLGARI contribue à ancrer l’identité de la maison de joaillerie dans l’héritage de l’Antiquité.
L’exemplaire ici illustré présente une chaîne tubogas bichrome en or jaune et blanc, caractéristique des orientations matérielles de la bijouterie à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Bulgari, Montre BVLGARI Roma, vers 1975, or, chanvre naturel et cuir, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.

Bulgari, Montre-bracelet BVLGARI BVLGARI, vers 1980, or jaune et or blanc, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.

Photographie de la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI parue dans Vogue Paris, octobre 1987.

Modèle portant la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI, Vogue Paris, février 1982.

Lambert Wilson portant la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI et Cyrielle Claire portant une parure en acier et or jaune Bulgari, Vogue Paris, juin-juillet 1983.

Photographie de Gianni, Paolo et Nicola Bulgari publiée dans Vogue Paris, novembre 1981.

Photographie de la boutique Bulgari 27, avenue Montaigne à Paris publiée dans Vogue Paris, novembre 1980.
La maison Van Cleef & Arpels
Si Van Cleef & Arpels réalise depuis 1933 de multiples dépôts de marque pour des monogrammes4, la maison fait pleinement usage de son logotype dans les créations comme reconnaissance visuelle à partir des années 1970. La maison sigle « VCA » des accessoires, tels des fermoirs de sac et des boucles de ceinture, ainsi que ses lignes horlogères, et ce jusqu’au début des années 1990.
L’un des modèles emblématiques est la montre Sport Collection 22, déposée en 1983. Elle est dotée d’un bracelet articulé en acier et d’un cadran en or jaune surmonté du monogramme VCA. Les trois lettres superposées, caractérisées par leur stylisation géométrique, sont la redite d’un chiffre employé sur une Minaudière dès 1936. Ainsi, cette montre diversifie la création horlogère en revenant à l'identité visuelle de Van Cleef & Arpels des années 1930.
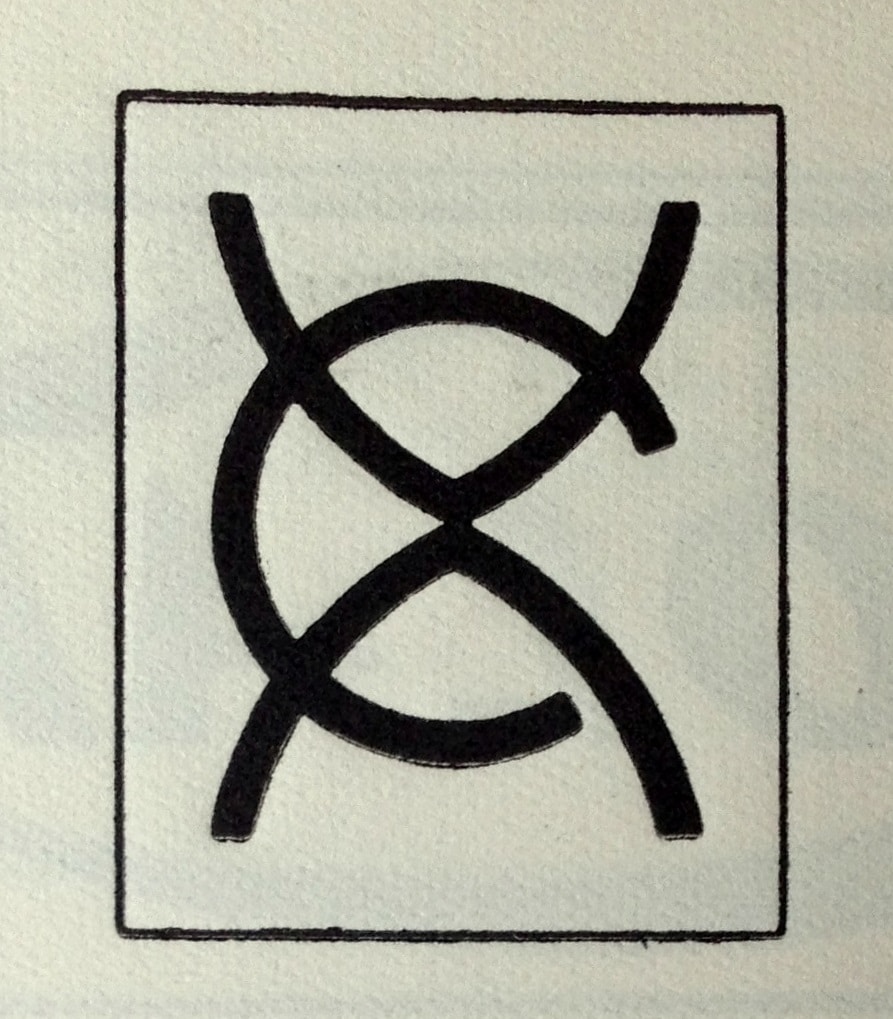
Dépôt de marque d’un monogramme pour des articles d’horlogerie bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, maroquinerie et articles pour fumeurs, 31 janvier 1933, Archives Van Cleef & Arpels.

Dépôt de marque d’un monogramme pour des articles d’horlogerie bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, maroquinerie et articles pour fumeurs, 10 décembre 1962, Archives Van Cleef & Arpels.
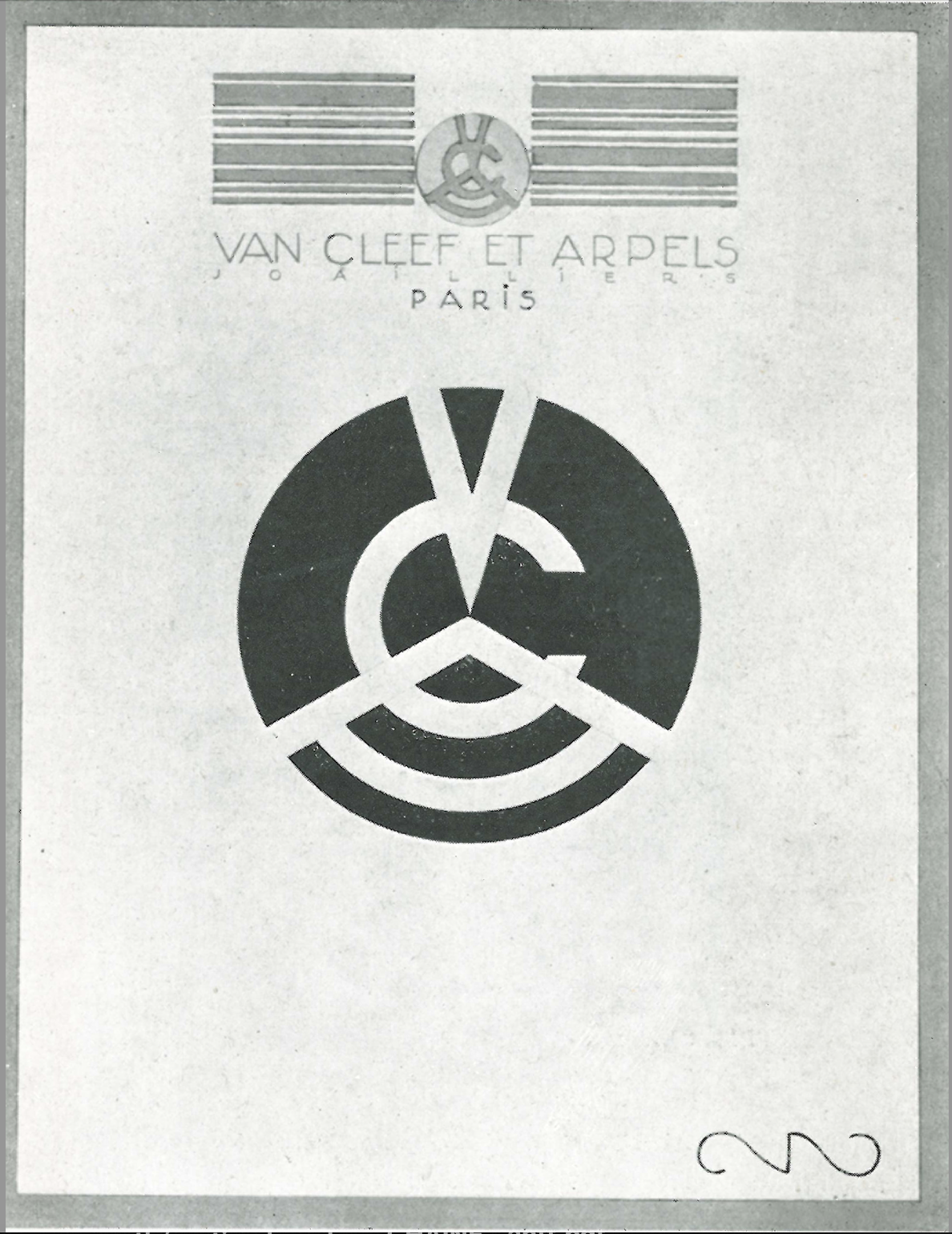
Robert Couallier, Visuel publicitaire pour Van Cleef & Arpels, La Renaissance de l’art français et des industries de luxe, 1928.

Dépôt de modèle d’une montre, 1973, Archives Van Cleef & Arpels.
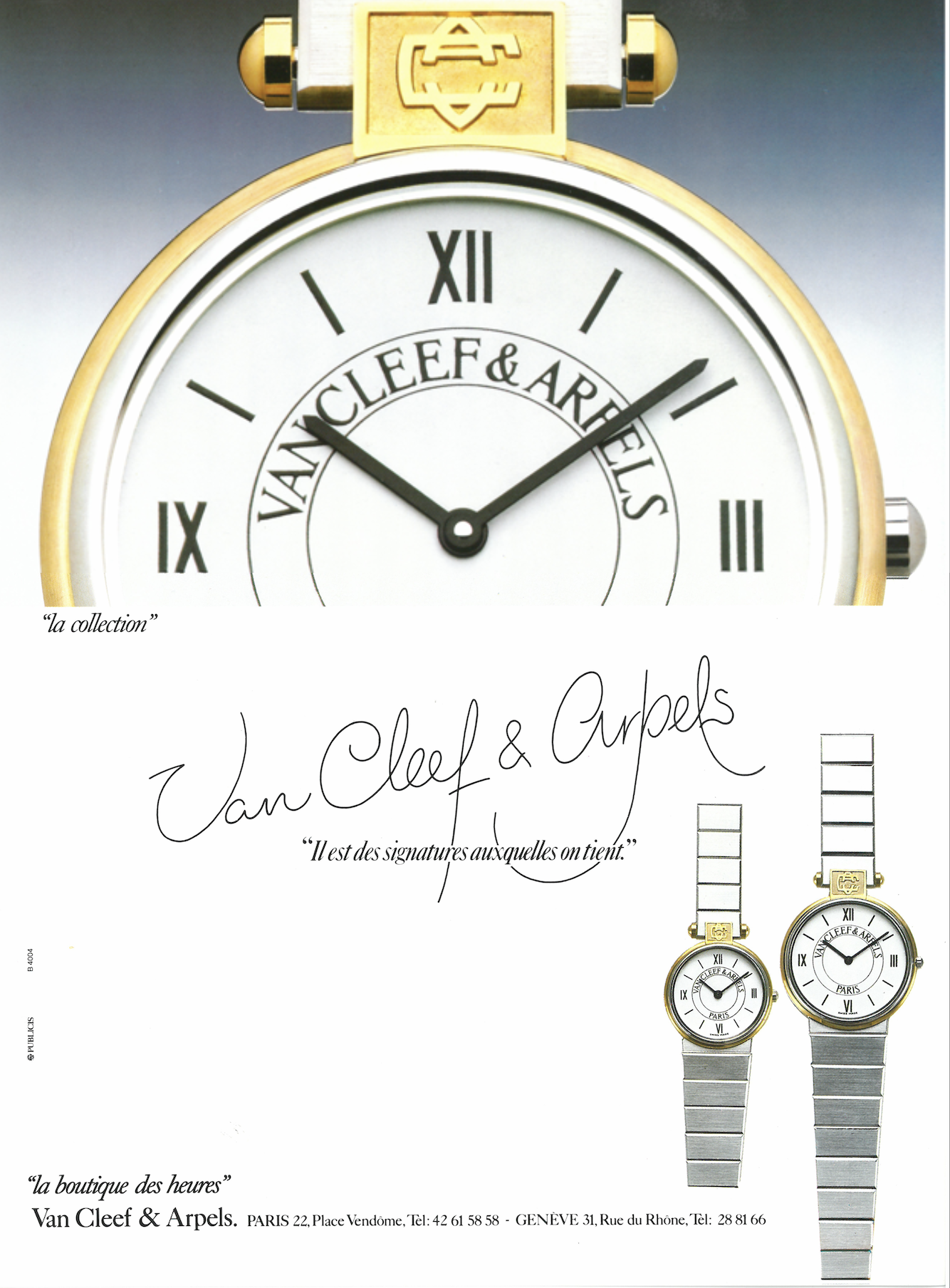
Publicité Van Cleef & Arpels, 1987, Archives Van Cleef & Arpels.
La maison Cartier
Cartier, enfin, excelle dans la création de bijoux à logotype au cours des années 1980.
Si les deux C entrelacés ou affrontés – motif issu du monogramme néo-XVIIIe ornant les écrins Cartier – sont utilisés par la maison avant cette date, ce chiffre est l'une des composantes du renouvellement connu par la marque à partir de 1973, porté par l’introduction de l’offre des Must. Ainsi, une décennie plus tard, il orne créations joaillières, horlogères, accessoires et maroquineries.
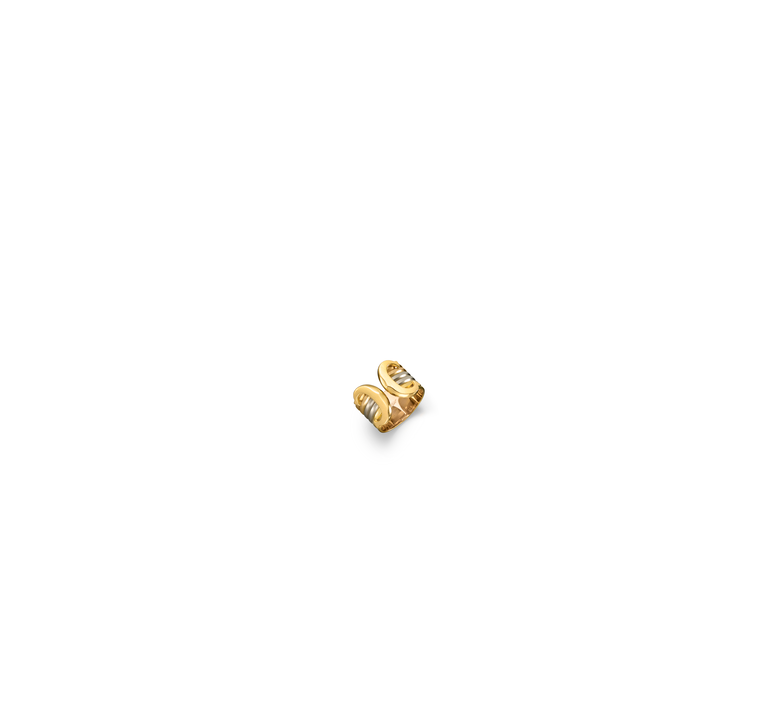
Bague, Cartier, 1985. Or jaune, or rose, or blanc, Cette bague est souvent dénommée Ressort. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

Bracelet, Cartier, 1990. Or tressé, diamants taille brillant. Ce bracelet, souvent dénommé Neptune, a été lancé en 1988. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

Modèle portant un bracelet les Must orné de deux C à ses extrémités, Vogue Paris, février 1979.

Publicité pour la maroquinerie Les Must de Cartier, 1983. Les Ateliers ABC © Cartier

Photographie de la boutique Cartier 12, avenue Montaigne à Paris publiée dans Vogue Paris, novembre 1980. La porte est ornée du monogramme de la maison.

Pierre Le-Tan, Dessin de la boutique Cartier 12, avenue Montaigne à Paris, publié dans Vogue Paris, octobre 1987.
B- La citation patrimoniale : le retour aux sources des maisons de joaillerie
Parallèlement aux bijoux ornés de logotypes, une autre expression de l’identité des maisons de joaillerie passe par des citations de créations passées, devenues personnifications de la marque à laquelle elles sont associées.
La réédition d’icônes est à mettre en regard avec l’enrichissement des collections patrimoniales de ces maisons : à partir du début des années 1970, Jacques Arpels débute une politique de rachat afin de constituer la collection Van Cleef & Arpels. Il en va de même pour Cartier, sous l’impulsion décisive d’Éric Nussbaum. Cette forme de patrimonialisation fait écho à l’affirmation identitaire des acteurs de l’industrie du luxe au cours des années 1980, qui trouvent dans leur passé, légitimité et prestige. Ces valeurs sont recherchées par une clientèle achetant les bijoux portant leur marque.
Les années 1980 voient l’apogée d’une « nouvelle économie culturelle 5 » : non seulement la culture devient un secteur économique de poids et est donc l’objet de stratégies d’investissement, mais elle permet aussi de stimuler d’autres secteurs de l’économie. Ce sont, dans le même temps, les prémices du mécénat culturel d’entreprise : Alain Dominique Perrin inaugure ainsi en 1984 la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. Les expositions patrimoniales et les monographies dédiées à l’histoire des grandes maisons de joaillerie se multiplient au cours de la décennie : Van Cleef & Arpels se raconte sous la plume de Sylvie Raulet en 1986 6 tandis que L’Art de Cartier s’expose au Petit Palais en 1989. Les publicités et articles de presse abondent pour relier la construction de ce nouveau patrimoine à la stratégie commerciale des maisons, à l’instar de Chaumet qui célèbre « 200 ans d’histoire 7 ».

« Grand cocktail au Pavillon Gabriel où l’on fêtait le bi-centenaire de Chaumet ». À droite, Jacques et Pierre Chaumet. Vogue Paris, novembre 1980.
Le motif de la panthère, icône de la maison Cartier depuis le début du XXe siècle, continue de marquer le répertoire stylistique de la maison au cours des années 1980. Le pelage tacheté noir et blanc ainsi que la silhouette du fauve vont offrir de nombreuses déclinaisons, que ce soit pour des motifs d’oreilles, des clips, des colliers, des bracelets, des bagues et pour l’horlogerie. En 1988, la Maison lance la collection Égypte qui comprend notamment une manchette en or jaune et blanc. Reprenant la forme des pectoraux égyptiens, cette création se compose de deux frises de panthères superposées en position de marche, réinterprétation des bas-reliefs antiques. Par là même, la maison renouvelle son emblème et créé une nouvelle icône.
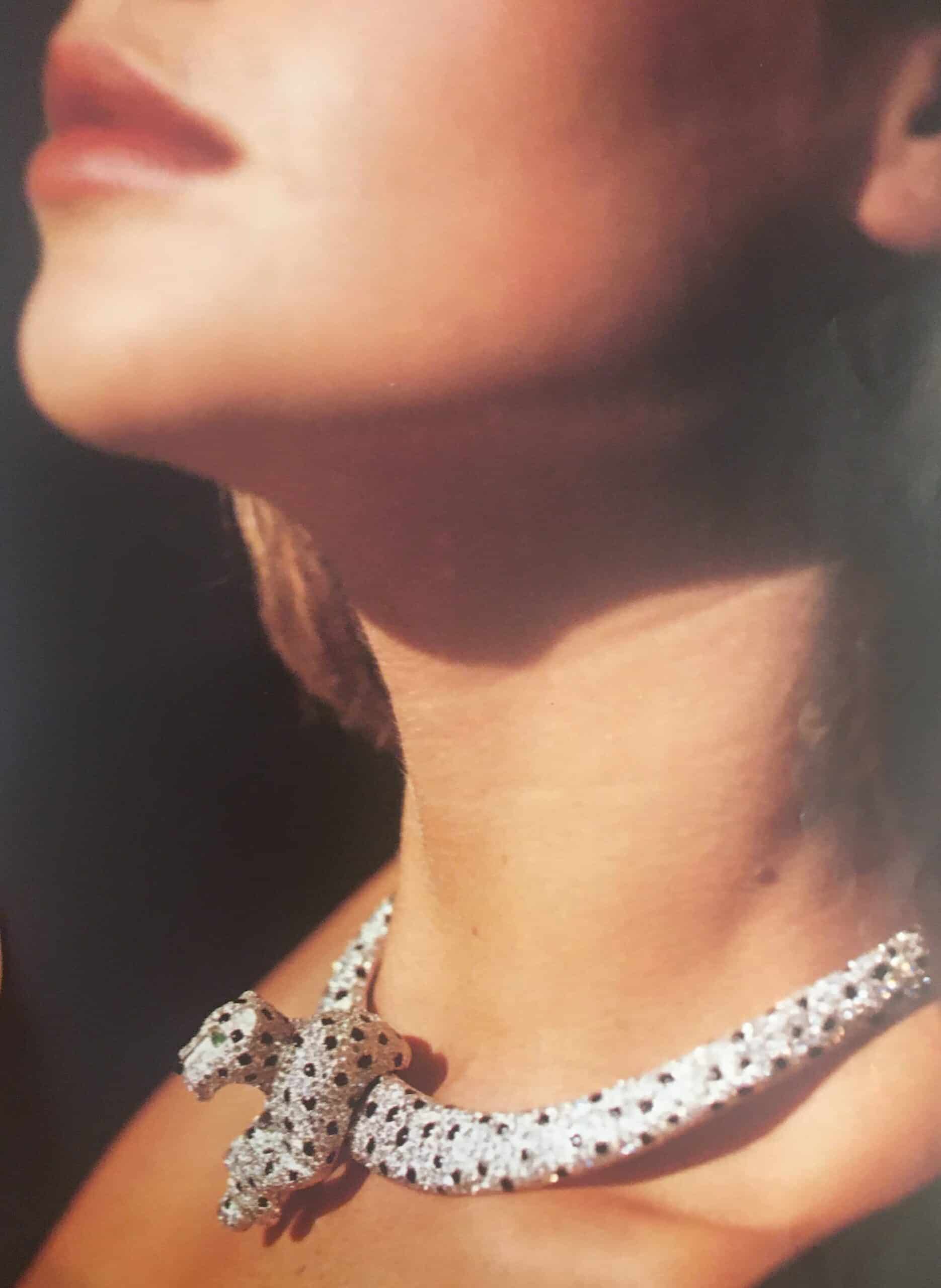
« Collier à broche panthère détachable, pavé de 1 600 brillants et d’onyx, monté sur or gris et platine. Cartier. » Vogue Paris, septembre 1986.

Collier rigide avec broche Panthère, Cartier Paris, 1988. Platine, or blanc, diamants, saphirs, émeraudes, onyx. Marian Gérard, Collection Cartier © Cartier
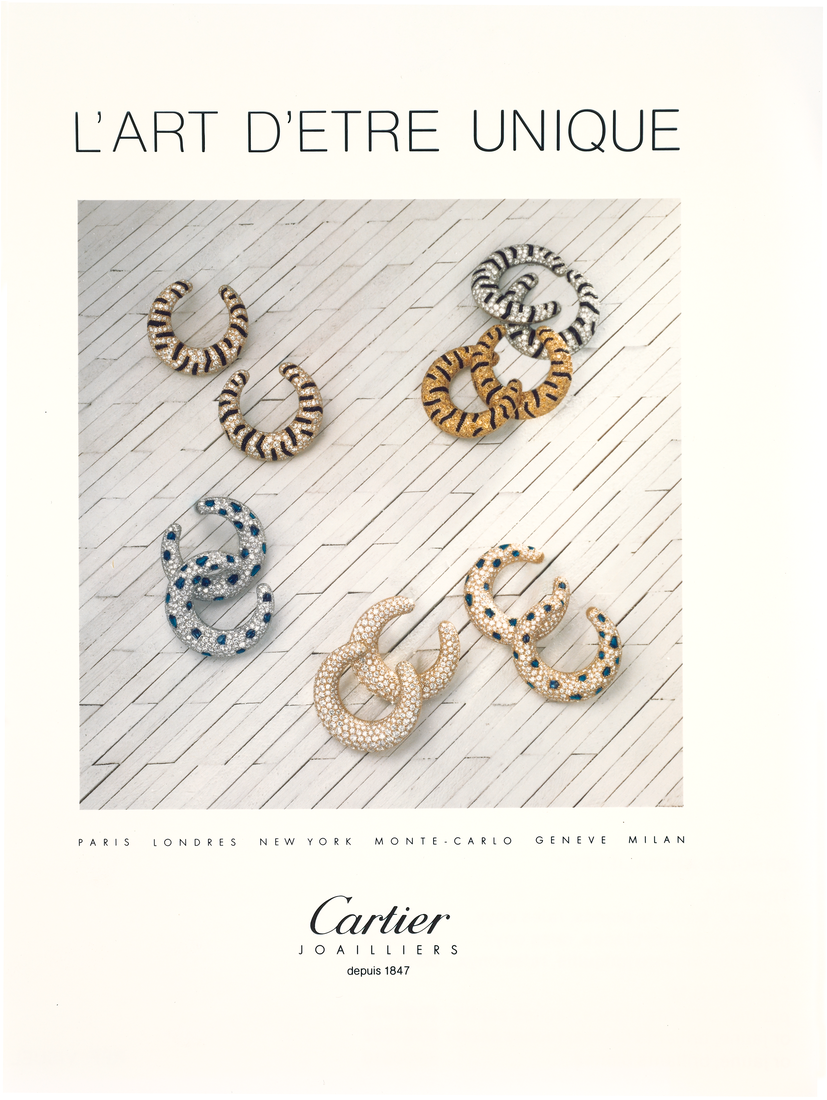
Publicité pour des boucles d’oreilles tigre et panthère de Haute Joaillerie Cartier, 1988. Les Ateliers ABC © Cartier

Hunter Reno photographiée par Albert Watson, portant des créoles Panthère de Cartier, couverture de Vogue Paris, avril 1984.

Parure « Tigre », Cartier Paris, 1986-1987. Or jaune, diamants blancs et « fancy intense yellow », émeraudes, onyx. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier.

Bracelet à motif panthères, Cartier, 1997. Or jaune, or blanc. Ce bracelet, souvent dénommé Pharaon, fait partie de la collection Égypte lancée en 1988. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier
Réinterprétation de la broche Cercle commercialisée par Van Cleef & Arpels à partir de 1930, les bijoux Magique, imaginés en 1988, contribuent au regard rétrospectif porté par la maison sur ses propres créations durant cette décennie.
Réalisés en or jaune, les broches et motifs d’oreilles Magique présentent un décor godronné, parfois rehaussé de diamants. À l’instar du modèle des années 1930, le clip Magique peut être porté de multiples manières : « Il se fixe sagement sur le drapé d’une robe ou le revers d’un tailleur. Puis on le découvre subitement jouant les fermoirs sur une pochette du soir 8 ». « La femme qui le porte peut donner libre cours à sa fantaisie, [à] son imagination 9 ». À la différence de l’original, cette réédition est réalisée grâce à la technique de la fonte, ce qui permet d’éditer en grand nombre un même modèle.
Ainsi, de pièce unique dans les années 1930, le Cercle devient près de cinquante ans plus tard, un bijou reproductible, donc moins onéreux, à destination de la boutique.

Clip Magique, 1988, or jaune, Paris, Collection Van Cleef & Arpels.

Article consacré à « La dernière surprise de Van Cleef & Arpels : un "Cercle Magique" », Madame Figaro, 1988, Paris, Archives Van Cleef & Arpels.
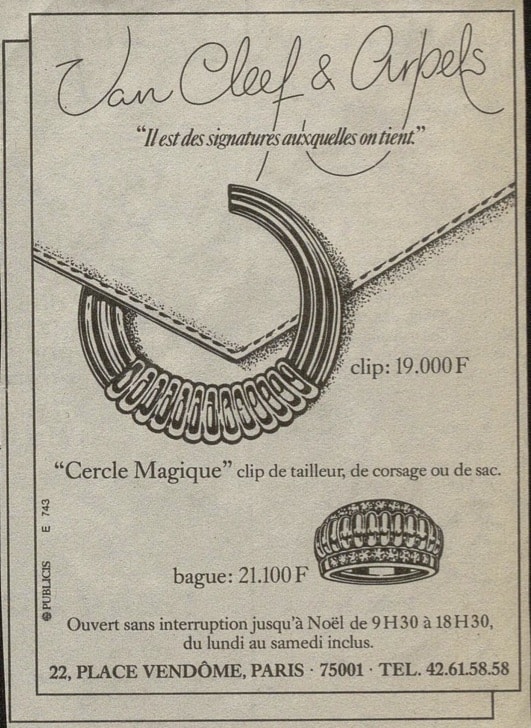
Publicité Van Cleef & Arpels illustrant le clip Cercle Magique, 1988, Archives Van Cleef & Arpels.
Phénomène touchant une grande partie des maisons de joaillerie à partir des années 1970, le bijou siglé est, pour celui qui le porte, une affirmation de son identité et de son appartenance sociale.
***
1 Dit aussi logo, apocope de logotype. Initiales, mots ou symboles qui singularisent une marque.
2 Pierre Zapalski, « La contrefaçon : une activité en expansion », L’Aurore, 22 avril 1980, n.p.
3 « Destruction montres », TF1 13h, 14 octobre 1981, Paris, INA (cote : CAA8101395201).
4 Un premier dépôt (n°203862), en date de 1933, est renouvelé en 1948 (n°423560). Un second monogramme, celui utilisé pour la montre Sport Collection 22, est déposé en 1962 (n°196259). L’idée d’un monogramme « VCA » se retrouve développée dès 1928 dans une illustration commerciale créée par Robert Couallier [Fig. 10].
5 François Cusset, La décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2008, p. 329-330.
6 Sylvie Raulet, Van Cleef & Arpels, Paris, Éditions du Regard, 1986
7 Catalogue commercial Chaumet, 1980, Paris, Bibliothèque Forney (cote : CC252 1980A).
8 Article anonyme intitulé « La dernière surprise de Van Cleef & Arpels : un "Cercle Magique" » publié dans Madame Figaro, 1988, Paris, Archives Van Cleef & Arpels.
9 Ibid.
***
Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.
Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.
Les auteurs remercient pour leur aide, leurs relectures et leur confiance :
Cartier :
Violette Petit
César Imbert
Gaëlle Naegellen
Bulgari :
Gislain Aucremanne
Van Cleef & Arpels
Sibylle Gallardo-Jammes
Alexandrine Maviel-Sonet
Visuel de "une" : Bulgari, Montre BVLGARI Roma, vers 1975, or, chanvre naturel et cuir, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.
Veuillez cliquer sur ce lien pour vous inscrire à la newsletter de
Property of a Lady
Bijouterie de pouvoir : entre conformisme et individualité
Par Émilie Bérard et Marion Mouchard
À partir des années 1970, un nombre croissant de femmes, non seulement accèdent à la vie professionnelle, mais surtout peuvent prétendre à de hauts postes décisionnels au sein des entreprises privées et des institutions publiques. À ces nouvelles fonctions, correspond un langage des apparences qui définit les interactions dans ce contexte précis. Ce langage consiste à asseoir, au travers de signes extérieurs tels que le vêtement et les éléments de parure, les compétences et la crédibilité de la personne qui les porte.
C’est ce que l’on désigne plus généralement sous l’anglicisme de power dressing.
Se vêtir selon un code permet d’exprimer de manière active une identité au travail : « C’est comme un retour aux temps des chevaliers avec leurs armures. Vous revêtez votre armure et vous êtes prêtes pour le travail[1] » Le vêtement et le bijou sont porteurs de sens sociaux. Cette « ingénierie vestimentaire[2] » est véhiculée par des manuels à l’instar des célèbres Dress for Success Book de John Terence Molloy[3]et The Yuppie Handbook, décrivant les silhouettes des Young Urban Professionals. Ils définissent ce qui est approprié, ce qui est socialement accepté dans le cadre professionnel.
Se développe une image stéréotypée de la business woman, reposant sur l’équilibre de principes antagonistes : masculinité et féminité ; conservatisme et sensibilité aux modes ; conformisme et créativité[4]. La première opposition peut être illustrée par l’obligation du port au travail du tailleur-jupe. Cet uniforme est un pendant du costume masculin permettant aux femmes de s’intégrer dans un milieu majoritairement composé d’homme, tout en s’en différenciant. La jupe souligne une dissociation nette des genres dans une société des années 1980 qui retourne à des valeurs conservatrices tout en les redéfinissant.
Le bijou – à l’instar d’autres accessoires comme les foulards – contribue également à la féminisation du costume. Ils cristallisent également les deux autres oppositions du vestiaire professionnel féminin.
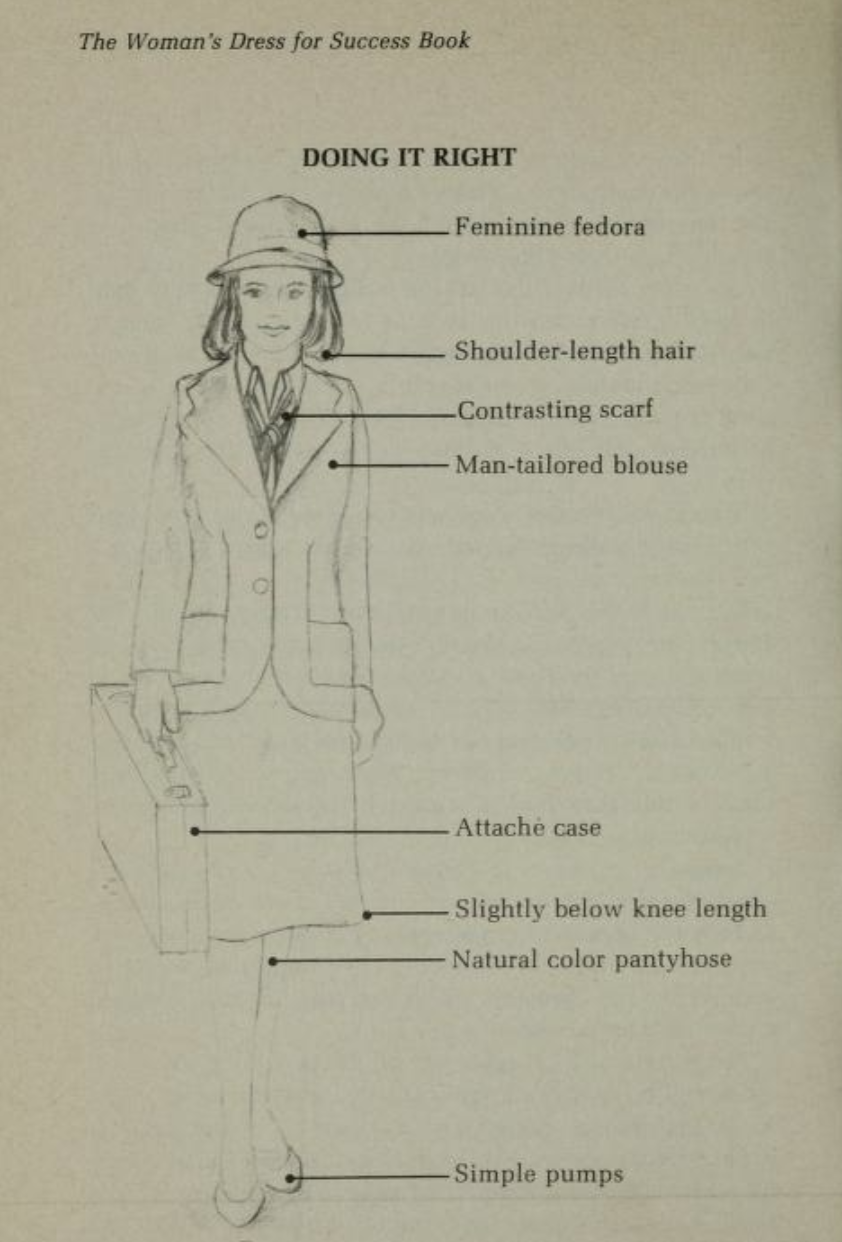

A- Prestige de la griffe et fonctionnalité
L’un des aspects les plus saillants du power dressing est la volonté de se conformer à un groupe, en l’occurrence un entourage professionnel.
Se vêtir et se comporter de manière similaire entre employés reflète des valeurs et des objectifs communs. Le succès de l’entreprise est un but partagé qui s’extériorise par une codification généralisée de l’apparence, gommant par la même les spécificités individuelles. L’adoption du costume, à pantalon pour les hommes et bien souvent à jupe pour les femmes, correspond à une standardisation des employés. Cet uniforme se doit d’être de couleurs neutres – les tons beige, gris et bleu marine sont privilégiés –, peu ornementé et de coupe classique. Il est l’une des composantes d’un conservatisme largement partagé dans les entreprises des années 1980.
Cette uniformisation de l’apparence se couple à la volonté d’afficher, par l’apparence, un statut socio-économique.
Dans le cas du bijou, la principale recommandation soulevée par John Molloy est la suivante : « achetez des pièces de joaillerie de meilleure qualité[5] ». La principale erreur serait de porter un ou plusieurs bijoux de faible qualité. Il conseille ainsi : « Plutôt que d’acheter quatre ou cinq bijoux de moindre qualité au cours de l’année, [la femme active] devrait acquérir une très belle pièce de joaillerie[6] ». Et ce d’autant plus qu’il prône une économie raisonnée quant au nombre de bijoux à porter : « la principale règle pour la femme active est simple : le moins de bijoux elle porte, le mieux c’est[7]». Il se place de ce fait en réaction face aux pratiques de la fin des années 1960 et du début des années 1970 en matière de parure : « une règle pertinente dans le cadre professionnel est de ne porter qu’une seule bague. Une femme dont les oreilles sont percées devrait porter des boucles d’oreilles dormeuses. Les pendants d’oreilles ne sont pas préconisés. Tout ce qui est susceptible de cliqueter, d’heurter un autre élément ou plus généralement de produire un son métallique est à éviter[8]» Il s’oppose ainsi aux principes d’accumulation et d’ostentation esthétique qui ont caractérisé la période entre 1965 et 1975.
En somme : « Si [une femme active] porte des bijoux, ils doivent être fonctionnels[9]».
Ce à quoi répond une invention de Philippe et Jacques Arpels[10]
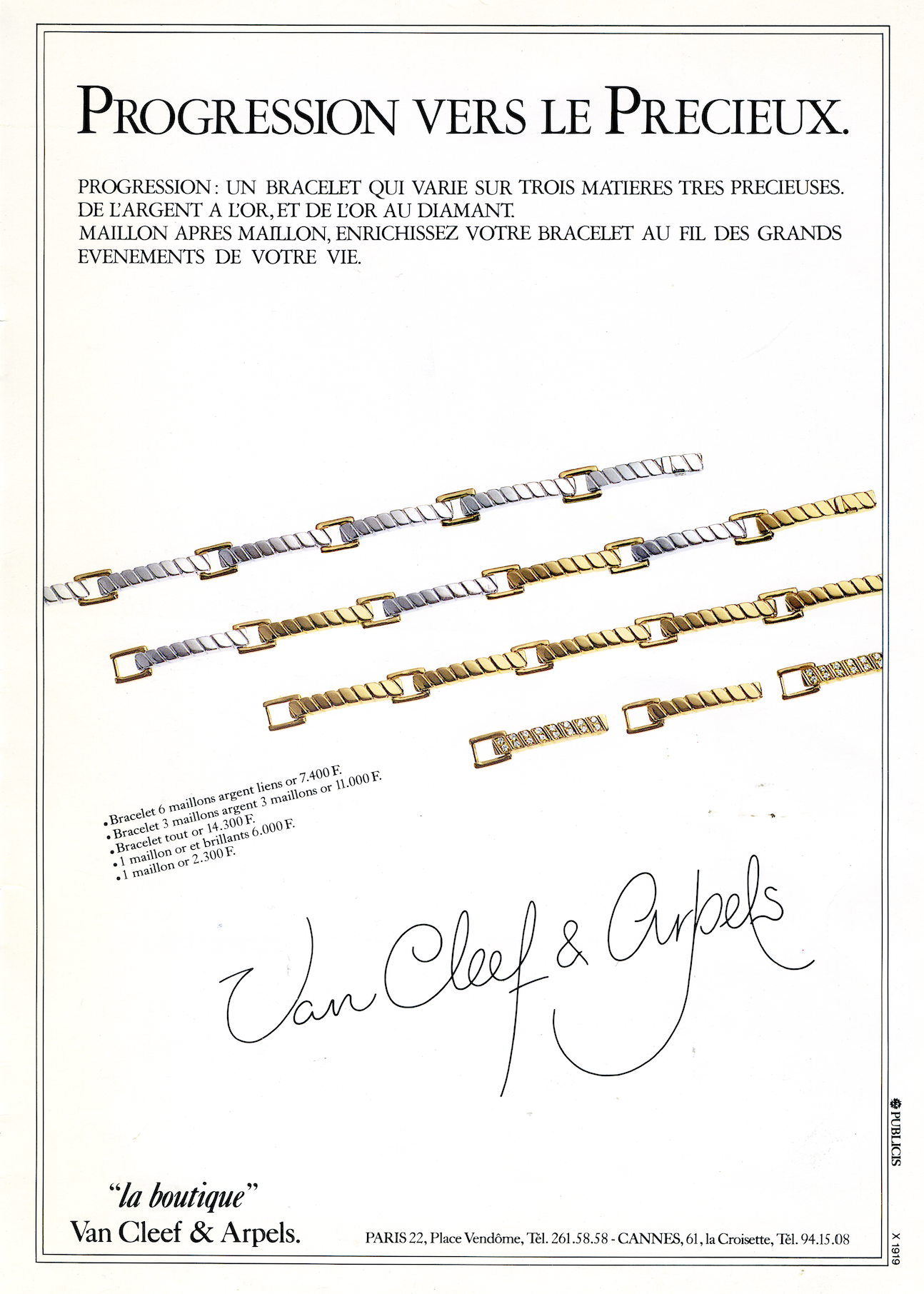
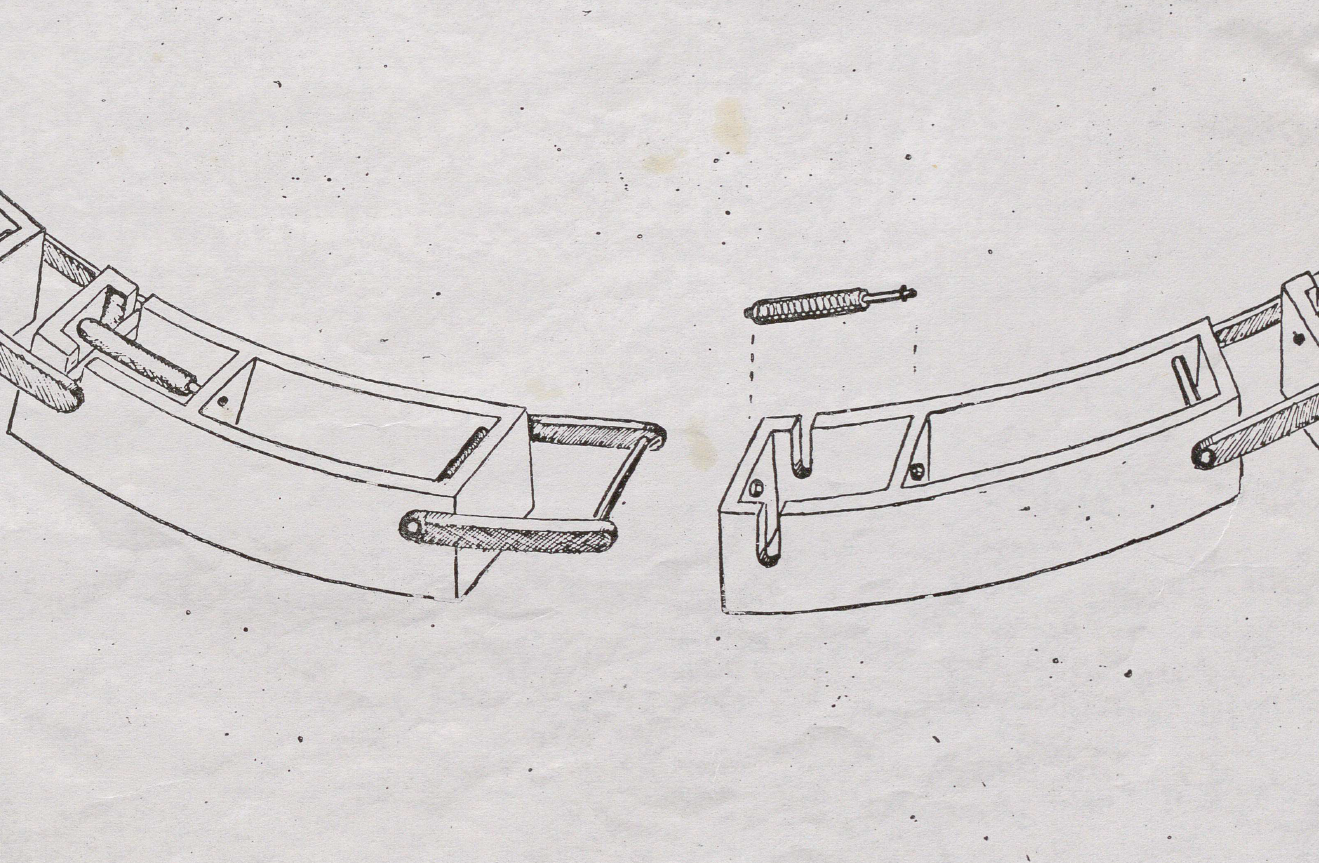
Philippe et Jacques Arpels[10] veulent commercialiser à La Boutique, un bracelet de six maillons, « accessible à tous les budgets[11] » tout en portant la signature Van Cleef & Arpels, gage de qualité et de prestige. (Emergeant dans le contexte économique de l’après-guerre et du début des Trente Glorieuses, La boutique est cet espace de vente inauguré par Van Cleef & Arpels en 1954 au 22, place Vendôme, pour promouvoir un grand choix de bijoux et d’objets à prix raisonnables auprès d’une nouvelle clientèle).
Dénommé Progression, ce bijou à transformation, breveté en 1983[12], consiste à rendre modulable un bracelet formé d’une succession de motifs longilignes reliés entre eux par des maillons quadrangulaires. Les motifs sont creux au revers et comportent à leurs extrémités, d’un côté deux encoches, et de l’autre un axe de pivotement formant le maillon qui unit chaque motif. Ce dernier vient se loger dans les encoches du maillon suivant et est maintenu grâce à un piston. Ainsi, pour assembler deux maillons, il suffit de retirer le piston, introduire le lien du second maillon à relier au premier dans les encoches et remettre ensuite en place le piston.
Ces maillons peuvent être en argent, en or, ou en or serti de diamants, « ce qui fait qu’une cliente ayant acheté la version de base peut ensuite enrichir son bracelet maillon par maillon en fonction de ses moyens[13] ». À l’image du traditionnel collier de perles offert à une jeune fille pour ses dix-huit ans et auquel on ajoute une perle chaque année[14], « ce bijou symbolise la progression, les différentes étapes d’une vie, l’évolution d’une carrière, d’une réussite. Quelque chose comme des galons mérités, gagnés au fil des jours, des années, par le travail, le succès[15] ». Les maillons étant interchangeables « très rapidement et très simplement[16] », le bracelet Progression s’adresse ainsi tout particulièrement aux « femmes de notre temps[17] ».
De même, en 1986, au terme d’une année de réflexion, Jean Vendome invente le Compact[18].


Bijou à transformation inédit, ce dernier prend la forme d’un pendentif rectangulaire dans lequel s’encastre une bague, une paire de boucles d’oreilles et un bracelet. Peu d’exemplaires ont été tirés de cette innovation, mais chacun est unique et présente un décor singulier. Jean Vendome le conçoit pour « la femme moderne, une femme qui travaille le jour, mais qui souhaite être plus habillée le soir, lorsqu’elle sort[19] ». Sous sa forme de pendentif, le Compact se porte de jour. Il suffit alors, le soir ou à certaines occasions, de déplier la parure et de porter tout ou partie des pièces. Il répond ainsi aux exigences de fonctionnalité soulevées par John Molloy. Si ce dernier recommandait en outre de porter un nombre raisonné d’ornements bijoutiers, il indique également que ceux-ci doivent « apporter une présence », avant de citer en exemple : « un pendentif large et de qualité confère une présence [20]».
Parmi les accessoires bijoutiers susceptibles d’être les plus adaptés à la vie d’une femme active, John Molloy recommande la montre, plus précisément un modèle masculin dont les proportions auraient été adaptées à un poignet féminin[21].
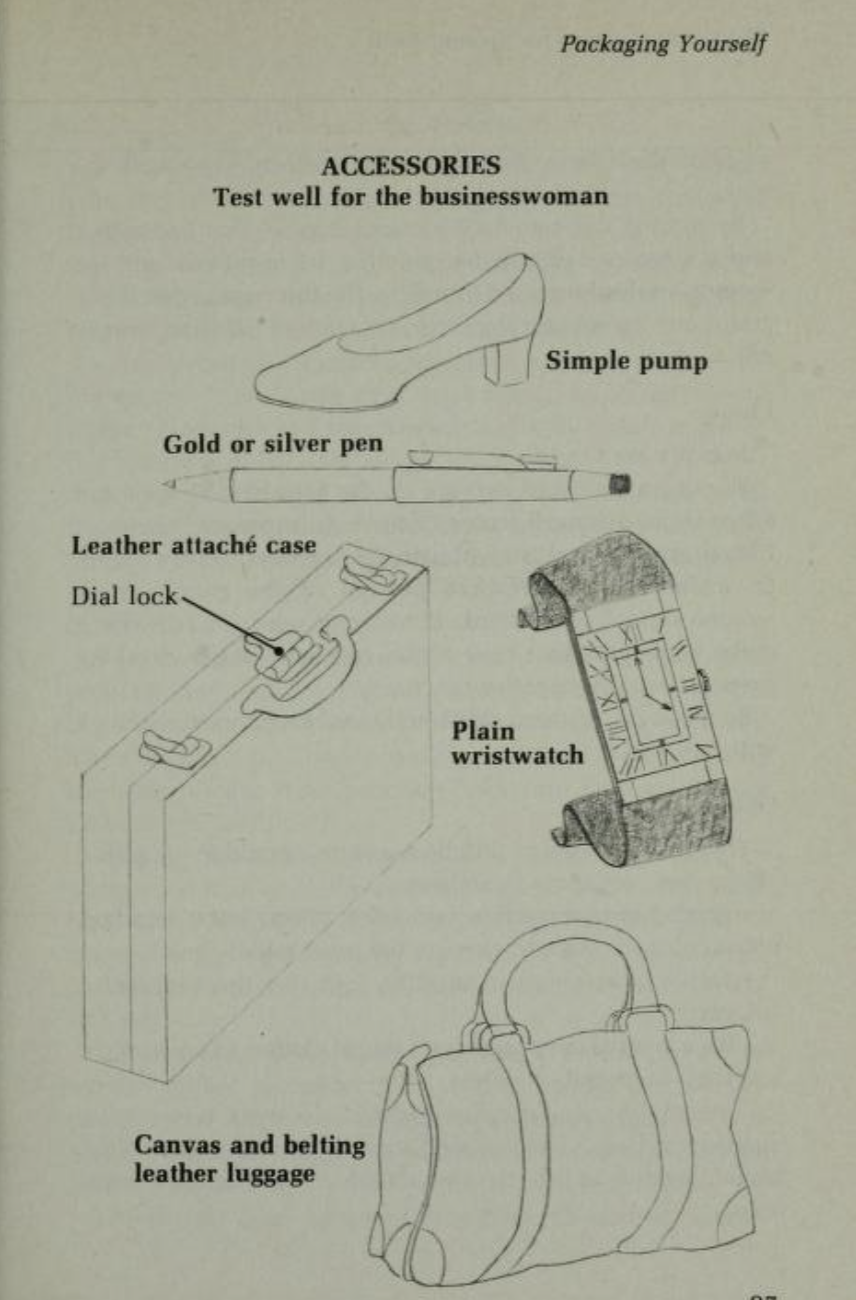



Un article de Vogue se fait l’écho de cette préconisation : il met en scène une montre d’homme Corum portée par un poignet féminin. Si la main est manucurée, celle-ci contraste avec la manche d’une chemise rehaussée de boutons de manchettes et d’une veste de costume, dont le « jeu de rayures » est qualifié de « masculin »[22] . En guise de description, le magazine indique : « ce dont une femme active a besoin : une bonne montre » ; avant de poursuivre : « la meilleur montre en ce moment : fonctionnelle, simple... [23]». Le conseil de John Molloy se rencontre également sur la page de couverture du Yuppie Handbook, faisant figurer une business woman arborant une montre Tank de la maison Cartier.
Le modèle horloger, qui n’a cessé d’être renouvelé depuis sa création en 1917, est adapté en vermeil pour rejoindre l’offre des Must au cours des années 1970, contribuant de ce fait à en assurer un plus vaste succès.

Le conformisme des apparences enjoint, de fait, les employés à consommer les mêmes produits et les mêmes marques. La silhouette devient une énumération de grands noms de maisons de couture, de joaillerie, de maroquinerie, reflétant le pouvoir d’achat de cette catégorie sociale. Le langage des marques, pratiqué à l’outrance, menant parfois même à la caricature comme le décrit Bret Easton Ellis dans son roman American Psycho, est un signe extérieur d’appartenance à un groupe. C’est pourquoi les modèles de costumes et d’accessoires doivent être identifiables.
Les maisons de joaillerie l’ont bien compris et orientent en conséquence leur production. L’édition en de multiples exemplaires de modèles bijoutiers ou horlogers devenus les personnifications d’une marque – à l’instar de la montre Tank de Cartier – ou, de manière plus évidente encore, affichant ostensiblement le logotype de celle-ci, forme une part non-négligeable du chiffre d’affaires des grandes maisons. Une version de la publicité de la montre Tank ici reproduite porte ainsi le slogan : « If you want to wear the watch that has been worn by people at the top since 1904, wear Cartier ».
B- Le bijou interchangeable : vers une personnalisation du Power dressing
Cette forme de conformisme indissociable du power dressing, pratiqué à l’extrême, entraîne une perte d’identité individuelle. Par extension, la conformité risque d’occulter les compétences personnelles et donc d’entraver une ascension dans la hiérarchie de l’entreprise. Progressivement, au cours des années 1980, une liberté raisonnée se fait jour dans le vestiaire féminin : de plus larges panels de couleurs, de motifs, de matières et de coupes sont intégrés grâce à la combinaison de différents vêtements et accessoires. Les signes extérieurs de capacités créatives sont d’autant plus encouragés dans certains domaines, à l’instar des médias ou les relations publiques.

L’un des principaux vecteurs de cette variété esthétique est le bijou à décor interchangeable.
Si des éléments de parure semblables existent dès les années 1930[24] et regagnent en popularité au cours des années 1970[25], ceux-ci se multiplient au cours des années 1980.
À commencer par les créations de Marina B. qui, depuis 1978 et sa collection de bijoux Pneu, ne cesse d’inventer des modèles de pendants d’oreilles à ornements démontables : JP (1982), Pneus Perles, ou encore Alexia (1983)[26].
En 1984, toujours pour La Boutique, Van Cleef & Arpels créé le collier Nattes et ses dérivés en bracelets et motifs d’oreilles, centrés sur un motif en or jaune et diamants dans lequel viennent s’insérer des tresses de perles fines, hématite ou chrysoprase.
En 1988, c’est au tour de Jean Vendome de développer sa collection Bulles et Boules[27], dont les bijoux présentent une monture en perles d’or ou d’argent dans laquelle vient se nicher une gemme sculptée en sphère. Celle-ci, bien souvent en pierre ornementale, peut être détachée et remplacée par une autre afin de varier les couleurs de la parure.

Un même système est également appliqué au bijou masculin, par Boucheron, pour des boutons de manchettes dénommés « Les Pluriels » : deux anneaux reliés par une plaque en or jaune, accueillent des bâtonnets de bois d’amourette, de lapis-lazuli, d’œil de tigre, de malachite, d’onyx ou même d’or gris. Ceux-ci peuvent très aisément être retirés de leur monture et remplacés par une autre matière. La commodité de cette invention est louée par Boucheron sous le slogan : « c’est quand même plus simple que d’apprendre à coudre[28] ». Le texte publicitaire accompagnant l’illustration de ces boutons de manchettes précise : « Vous n’allez pas me croire, mais il n’y a aucune option « couture » ni à HEC, ni à Berkeley. […] Alors comme je suis un homme d’action, j’entre chez Boucheron et je leur demande des boutons de manches interchangeables[29]». Les Pluriels se déclinent aussi en bijou féminin, sous forme d’anneaux, de joncs et motifs d’oreilles créole en or godronnés, formant « une base », dans laquelle s’insère un motif « intercalaire », en métal, corail ou bois[30]



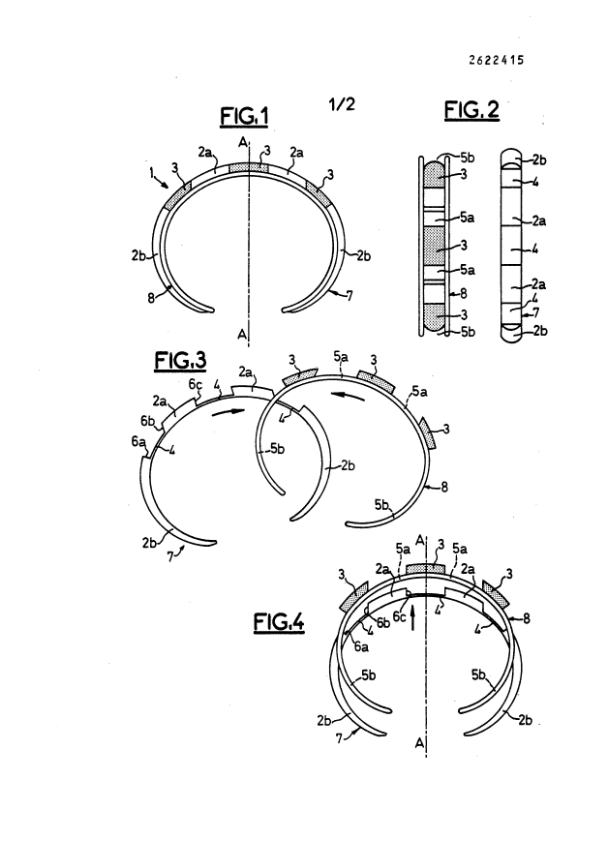
Pareillement, en horlogerie, les modèles de montres à bracelets interchangeables se multiplient durant la seconde moitié des années 1980.
Boucheron étend sa gamme de bijoux à décors interchangeables avec une série de montres, aussi bien féminines que masculines, dont le cadran – tantôt rond, carré ou rectangulaire – est muni de boutons poussoirs permettant de libérer la tige du bracelet et de le changer très aisément. La montre Ma Première de Poiray, conçue en 1986, connaît également un succès retentissant. Son boîtier carré est muni de systèmes d’ouverture à cliquet permettant de changer les bracelets. Ces derniers se déclinent par conséquent dans un vaste éventail de couleur et de matière. Nathalie Hocq, alors directrice artistique de Poiray, en est la meilleure adepte lorsque que sur le plateau d’Antenne 2[31] , elle présente ce nouveau modèle horloger à destination de « la femme d’aujourd’hui, [la femme qui] vit activement ».


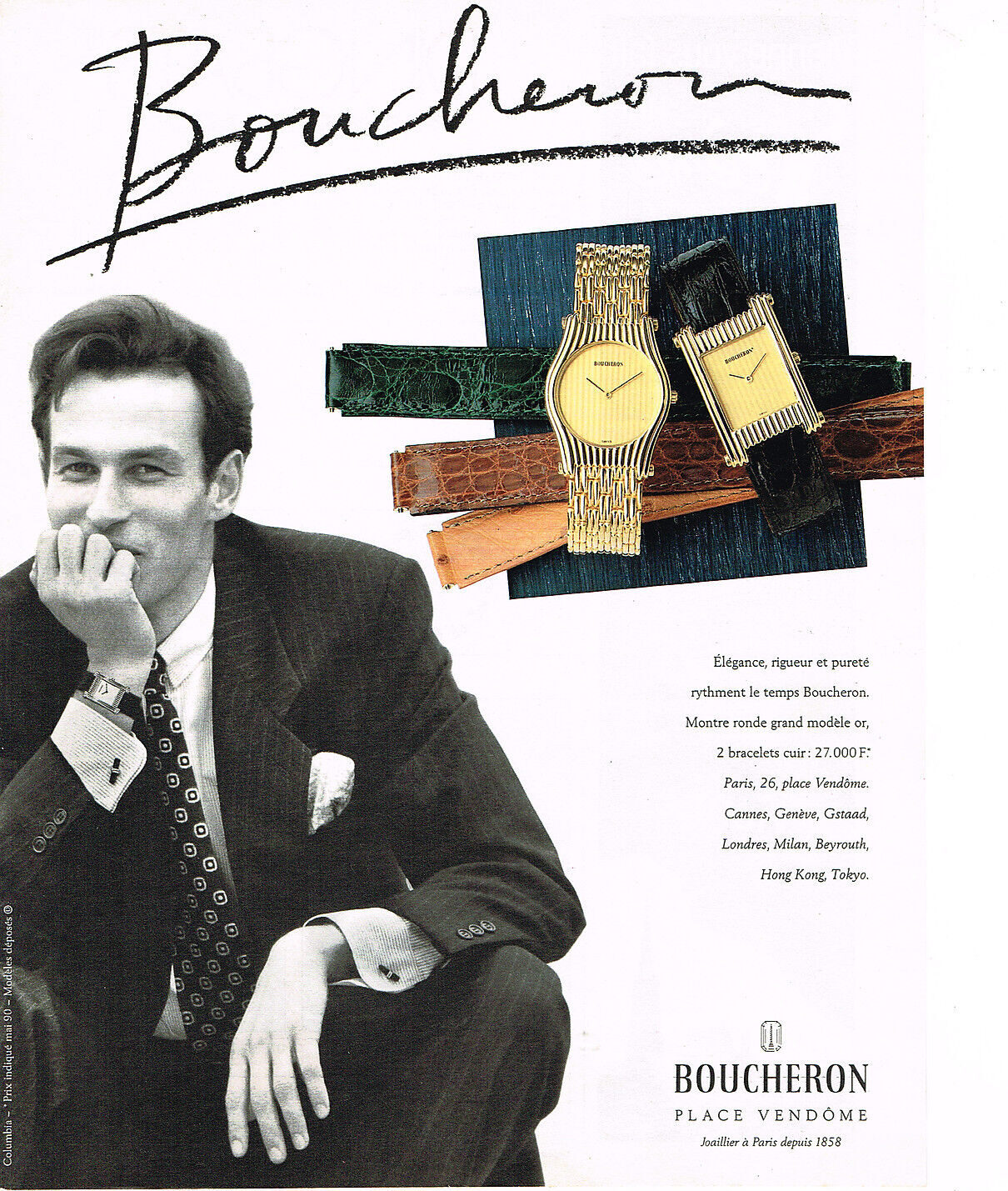


Si elle engendre une plus grande liberté dans la façon de se vêtir, l’introduction d’une plus grande variété de choix provoque aussi de l’incertitude quant à ce qui est approprié ou non de porter dans un contexte professionnel.
Le sens du vêtement et du bijou devient plus vague, s’étiole, le power dressing perd de son importance à l’aube du nouveau millénaire en Occident.
*** A suivre ! ***
[1] « It’s kind of back to the knight and the armor. You put on your armor, and you’re ready for business ». Témoignage rapporté dans : Patricia A. Kimle, Mary Lynn Damhorst, « A Grounded Theory Model of the Ideal Business Image for Women », Symbolic Interaction, vol. 20, n°1, 1997, p. 57.
[2] Ibid.
[3] Le premier volume du manuel Dress for Success est édité en 1975 à destination d’un public masculin. Il faut attendre 1977 pour que paraisse The Woman’s Dress for Success Book.
[4] P. A. Kimle, M. L. Damhorst, « A Grounded Theory Model of the Ideal Business Image for Women », op. cit., p. 51.
[5] « Buy […] better pieces of jewelry ». John T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, New York, Warner Books, p. 89-92.
[6] « Instead of buying four or five cheaper pieces throughout the year, [the businesswoman] should buy one good piece. » Ibid.
[7] « The jewelry guideline for the businesswoman is simple: the less jewelry she wears, the better of she is. » Ibid.
[8] « A good guideline is not more than one ring at a time for business. A woman whose ears are pierced should wear simple gold posts. Dangling earrings are out. Anything that clangs, bangs, or jangles should be avoided. » Ibid.
[9] « If [a business woman] wears any jewelry at all, it should be functional. » Ibid.
[10] Si le brevet mentionne comme inventeur Philippe Arpels, une lettre de Dominique Arpels en date du 25 avril 1983 attribue l’idée du bracelet Progression à son père, Jacques Arpels.
[11] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », Figaro Magazine, 20 mai 1983, n.p.
[12] Brevet n°2 540 364 pour un « Système d’articulation amovible, applicable à des articles de bijouterie ou de joaillerie, par exemple des bracelets, des colliers, etc. » déposé le 3 février 1983, Archives de l’INPI (cote : FR2540364_B1).
[13] Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.
[14] « L’idée de Papa est un petit peu inspirée du « add a pearl » necklace. » Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.
[15] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », op. cit.
[16] Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.
[17] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », op. cit.
[18] Sophie Lefèvre, Jean Vendome. Un demi-siècle de création de bijoux contemporains, cat. expo., Lyon, Muséum d’Histoire naturelle (6 novembre 1999-27 février 2000), Paris, Somogy, 1999, p. 176-177.
[19] Marlène Crégut-Ledué, Jean Vendome. Les voyages précieux d’un créateur, Paris, Éditions Faton, 2008.
[20] « A large, expensive pendant can add presence. » J.T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, op. cit.[Fig. 10] « Les accessoires convenant à la femme d’affaire ». John T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, New York, Warner Books, p. 97.
[21] Ibid.
[22] « A play of menswear stripes, in a jacket, the cuff of a shirt. » [Anonyme], « Top choices », Vogue, août 1984, p. 322.
[23] « More of what an active woman needs, count on: a good watch. » ; « The best watch now: functional, simple… » Ibid.
[24] Entre autres exemples, Raymond Verger dépose un brevet en 1932 pour une « Bague à pierre interchangeable » (INPI, cote : FR737464).
[25] Citons notamment la bague Bagatelle de Gilbert Albert (1970), un principe que l’on retrouve durant la même décennie chez Chaumet.
[26] Viviane Jutheau, Marina B. L’art de la joaillerie et son design, Milan, Skira, 2003.
[27] Sophie Lefèvre, Jean Vendome. Un demi-siècle de création de bijoux contemporains, op. cit., p. 147.
[28] Publicité Boucheron pour les boutons de manchettes « Les Pluriels », années 1980, Paris, Bibliothèque Forney.
[29] Ibid.
[30] Publicité Boucheron pour les bijoux « Les Pluriels », années 1980, Paris, Bibliothèque Forney.
[31] « Plateau : Nathalie Hocq », Antenne 2, 07 octobre 1987, Paris, INA (cote : CAB87034614).
Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.
Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.
Veuillez cliquer sur ce lien pour vous abonner à la newsletter de Property of a lady
Visuel de "une" : Perles interchangeables en tourmaline verte, tourmaline rose et citrine, cabochons d'améthyste, onyx, diamants de taille circulaire. Marina B. Christie's, Important Jewels, Londres, 4-18 novembre 2020. Lot 80[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Bijoux et culture Hip-Hop
Par Émilie Bérard et Marion Mouchard
To read this article in English, please click on this link
Le hip-hop est un mouvement culturel né à New York au début des années 19701, dans un contexte de paupérisation des quartiers défavorisés – Harlem, Queens, Bronx et Brooklyn. Il regroupe quatre pratiques : le graffiti, le breakdance, le deejaying et le rap. L’une de ses caractéristiques est la volonté d’appartenir à la fois à un groupe socio-économique d’une part, et à un clan, un quartier, une communauté d’autre part.
Surtout, il prône une individualisation ostentatoire, qui passe notamment par l’apparence.
Le vêtement et le bijou sont dès lors, pour les membres de la culture rap, un vecteur d’expression, que ce soit d’un statut ou d’une identité : « Au cours des années 1980, le style vestimentaire en disait plus sur vous que tout autre chose. […] il devait donc parfaitement convenir et il devait vous définir2 ». Ainsi, les choix de couleurs, de marques, et même la façon dont les lacets des chaussures sont noués informent le groupe de son statut social, de ses origines3.
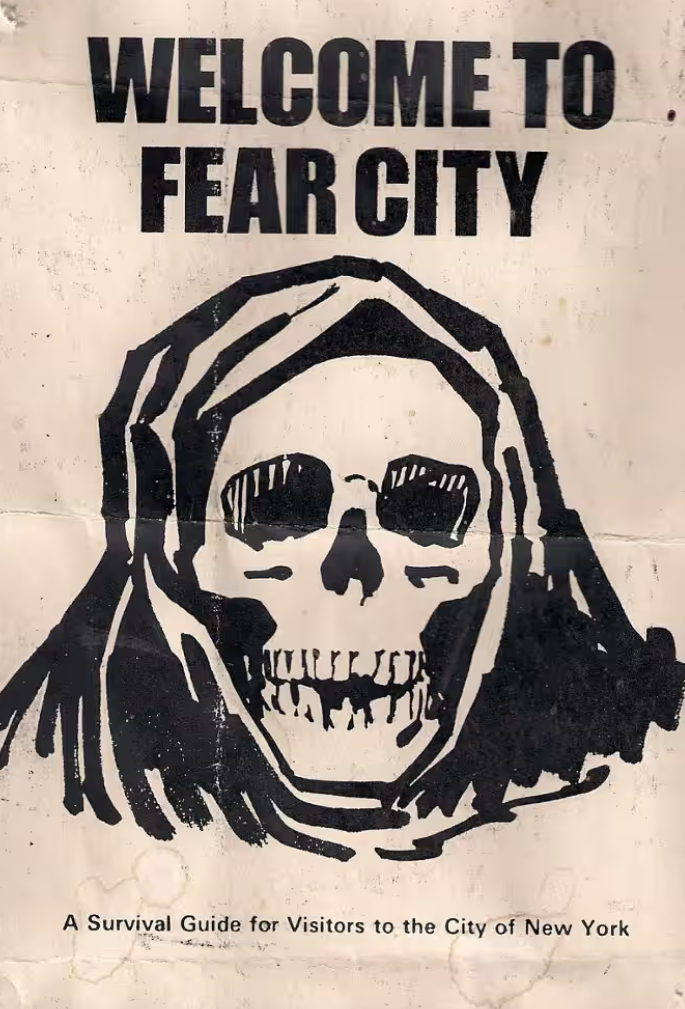





1 Elena Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, New York, Rizzoli, 2023, p. 29.
2 « Around the way in the ‘80s, wardrobe said more about you than anything. […] it had to fit well, and it had to define you ». Ibid., p. 121.
3 Ibid., p. 115
A- Le bijou comme marqueur ostentatoire de richesse
Dans la culture rap, vêtements et bijoux peuvent être des signes extérieurs de réussite : l’objectif est de « s’habiller comme la personne que l’on souhaiterait devenir4 ». L’ostentation des bijoux que les rappeurs arborent est à la mesure de leurs aspirations, qu'elles soient d’ordre financière ou sociale.
Dans le contexte de spéculation et de récession ouvrant la décennie, tandis que les joailliers traditionnels « [s’adaptent] au marché en allégeant les poids5 » des bijoux et qu’une grande partie de la population new-yorkaise vend ses bijoux à des négociants d’or sur la 47e rue6, les membres de la culture hip-hop se distinguent par des bijoux en or aux proportions exubérantes et portés en accumulation.
La richesse se mesure à l’aune des chaînes, des grillz7 et des montres en or achetées à Canal Street, dans Chinatown. Du reste, cette opulence est évoquée par les rappeurs dans leurs morceaux : en 1985, Pebblee Poo dans « A Fly Guy » assure à son auditoire que ses boucles d’oreilles ne sont pas en plaqué, mais en or massif8.

Outre les matériaux, l’iconographie révèle également ces ambitions, à l’instar des symboles graphiques monétaires, en particulier celui du dollar. De même, les vêtements et les bijoux siglés ne sont pas seulement l’apanage des Yuppies, mais sont également un marqueur de réussite sociale pour les membres de la culture hip-hop. Cette dernière contribue d'ailleurs pleinement à accentuer ce phénomène. Les paroles de rap, au travers de la pratique du name dropping, reflètent l’obsession de leurs auteurs pour les marques : « le name dropping démontrait que vous apparteniez à un statut différent de toutes autres personnes… […] La mode signifiait beaucoup. Nous devions nous parer pour nous faire respecter9 »
Les paroles de rap sont des indicateurs de ce qui est à la mode. Dans “La Di Da Di”, le Get Fresh Crew énumère ainsi les marques Gucci, Bally, Kangol et Ralph Lauren10. Ces dernières, ainsi que Louis Vuitton, Versace, Armani, ou encore Tommy Hilfiger sont autant de noms du luxe européen et américain à être progressivement intégrés et surtout transformés par le style hip-hop. À celles-ci s’ajoutent également les marques de sportswear telles Adidas ou Nike.


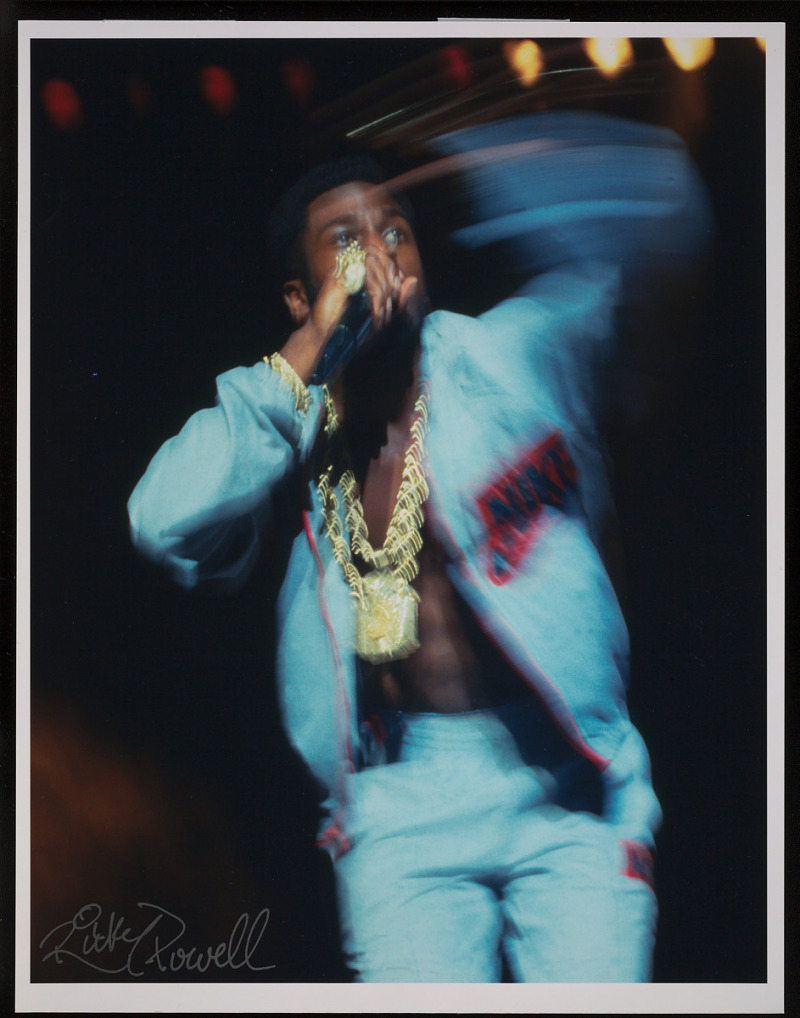
L’œuvre de Daniel Day, dit Dapper Dan, en est l’une des plus célèbres manifestations.
Celui-ci a contribué à introduire les marques de luxe dans la mode hip-hop – principalement Louis Vuitton, Gucci et Fendi. Depuis son atelier à Harlem, ouvert en 1982, il utilise des tissus et des cuirs à logotypes afin de concevoir des créations inédites11. Dès lors, ses réalisations seront portées par les plus grandes stars du rap, tels Heavy D et Big Daddy Kane. Le succès de Dapper Dan repose sur sa compréhension du vêtement en tant que symbole, permettant de transformer le regard qu’un groupe social peut porter sur un individu. La clé de l’apparence à Harlem, à cette époque, était ce qui inspirait de l’admiration12.



Dans le cas du bijou, le pendentif adoptant pour iconographie le logotype de la marque automobile Mercedes-Benz est un exemple récurent. De nombreuses versions en or, de diamètres variables, sont portées par des rappeurs tels LL Cool J., Sir Mix-a-lot ou Erick Sermon – leader du groupe EPMD – afin de suggérer leur réussite sociale par la possession d’une automobile de luxe.

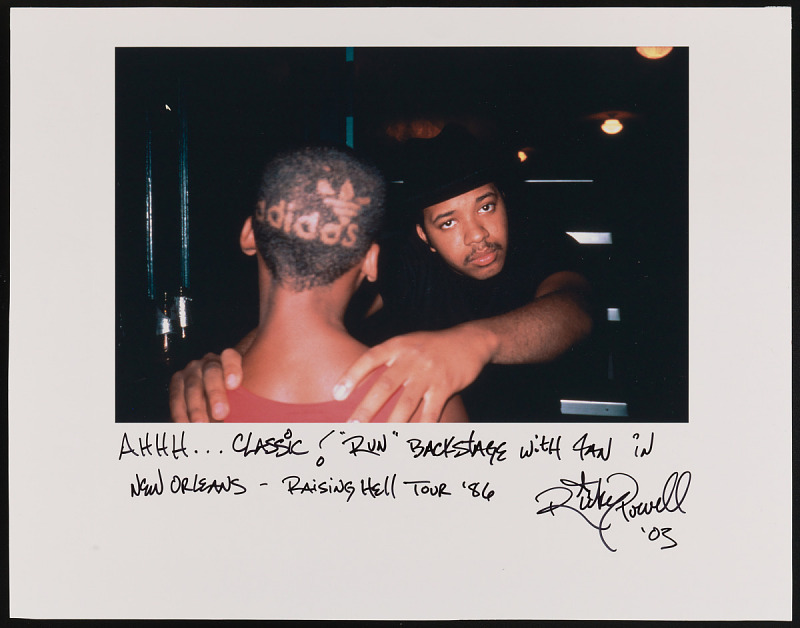


Mais l’exemple le plus éloquent est sans doute le pendentif prenant la forme d’une basket Superstar de la marque Adidas, porté par les membres du groupe Run-DMC.
En 1985, le rappeur Dr. Deas sort un morceau intitulé « Felon Sneakers », message directement adressé à l’encontre de ceux portant des sneakers et dénonçant dans le même temps les troubles qui leur sont associés13. En réponse, Run-DMC compose une ode au basket Superstar : « My Adidas » sera lancé en 1986, dans l’album Raising Hell. Le groupe n’est pas à son premier name dropping. En 1984, dans « Rock Box », il mentionnait déjà les marques de jeans Calvin Klein et Lee14. Au travers de son style vestimentaire, il crée l’une des images les plus reconnaissables du début du hip-hop : souvent vêtus de noir, ils portent des lunettes Cazal et surtout des Superstar sans lacets avec la languette dirigée vers l’extérieur. Le morceau « My Adidas » va faire le succès de Run-DMC en menant à l'une des premières collaborations passées entre un groupe de rap et une marque. Le 19 juillet 1986, ils se produisent au Madison Square Garden et demandent aux quarante mille spectateurs de lever en l’air leurs Superstar pendant qu’ils performent « My Adidas »15. Cette action, et la réponse spontanée qui en a résulté, engagent Angelo Anastasio, représentant de la marque, à conclure un accord de partenariat avec Run-DMC, négocié par leur manager Lyor Cohen.
Les marques de sportswear réorientent alors leur stratégie publicitaire en misant sur les effets démultiplicateurs de la controverse et sur les nouvelles figures populaires de la jeunesse. Rappelons ici l’accord passé en 1984 entre Nike et le numéro 23 des Bulls de Chicago, Michael Jordan, donnant naissance à l’une des plus célèbres campagnes publicitaires de la décennie. L’un des fruits de l’association entre Adidas et Run-DMC est un pendentif, offert par la marque au groupe, à l’image de la célèbre basket telle que portée par les trois rappeurs. Ce bijou symbolise ainsi ce partenariat qui est devenu une référence en la matière, et est le témoin du pouvoir culturel du hip-hop.
4 « Dress like the person you want to become ». Ibid., p. 33.
5 « Bijhorca », TF1, 12 septembre 1979, Paris, INA (cote : CAA7901677001).
6 « L’or, incidence sur la fabrication des bijoux », Soir 3, FR3, 16 janvier 1980, Paris, INA (cote : DVC8008015501).
7 Prothèses dentaires, bien souvent en or, parfois rehaussées de diamants.
8 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 171.
9 « Name droppin’ happened to show that you are on a different level than someone else… […] The fashion meant something. We had to adorn ourselves. We found respect. » Ibid., p. 97.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 33.
12 Ibid., p. 79.
13 Ibid., p. 97.
14 Ibid., p. 99.
15 Ibid., p. 97.
B- Le bijou comme signe extérieur d’appartenance à un groupe
Pour les membres de la culture hip-hop, l’apparence est également un moyen de revendiquer leur appartenance à un groupe en marge de la culture dominante, que ce soit à un gang, un quartier, une communauté. Chaque groupe possède un langage vestimentaire très codifié dans lequel le bijou tient une place importante.
À l’échelle des gangs, les couleurs des vêtements et des bijoux, les symboles qui les ornent, ou même les signes de mains, permettent de se reconnaître dans un milieu urbain défavorisé, où la façon de se vêtir peut mener à des violences : « Les sneakers que vous portiez peuvent soit vous faire agresser par des voleurs, soit vous faire ridiculiser, donc vous deviez bien réfléchir à la manière dont vous vous habilliez16 ».
Déjà, les années 1970 voient le développement de vestes personnalisées et peintes aux couleurs des gangs ou ornées de leurs logos17. Dans le cas de la rivalité entre Crips et Bloods, qui accompagne l’évolution du rap de la côte Ouest des États-Unis, le bleu est attribué aux premiers tandis que le rouge caractérise les seconds. De même, chaque quartier possède son code vestimentaire : à Brooklyn, on adopte le modèle de chaussures Wallabee de la marque Clarks, une casquette Kangol et des lunettes Cazal, tandis qu’à Harlem, le port du survêtement et des sneakers de la même marque s’impose18. Ces mêmes quartiers possèdent leurs propres boutiques spécialisées, dont des magasins de bijouterie : à Brooklyn, s'établit Gold Teeth USA en 1987 ; dans Chinatown, A$ap Eva ouvre son commerce en 1988.
Surtout, la culture hip-hop, « née de la ségrégation et de l’oppression des communautés de couleurs [afro-américaine, latino, juive, chinoise] dans les centres urbains américains19», utilise le bijou comme symbole d’appartenance à une communauté. Dans le cas des rappeurs afro-américains, le port du bijou s’inscrit dans l’héritage politique des droits civiques et du mouvement Black Power : « Ils étaient la génération succédant aux droits civiques qui aspirait à l’égalité et à la liberté. Ils voulaient avoir une voix, par tous les moyens nécessaires20». En 1989, le New York Times consacre un article à ces éléments de parure, affirmation d’une identité africaine : « C’est un retour aux années 1960, rappelant l’époque durant laquelle les droits civiques et le mouvement Black Power inspira une génération d’afro-américains […].
À nouveau, des bijoux et des vêtements symboliques sont portés par des jeunes afro-américains, les transformant en affirmation de fierté et d’identité21». Au cours des années 1980, le centre de l’African style et de la Black Power jewelry se situe dans Harlem West22. Revendiquer son appartenance à cette communauté passe par le port de dashikis, de kufis, de t-shirt à slogan23. En 1989, Queen Latifah et Monie Love, dans le clip de « Ladies First », s’affichent avec des turbans africains et des couronnes égyptiennes24. La même année naît la marque Cross Colours, promouvant au travers de tissus ou de campagnes publicitaires une identité africaine25.



Pendentifs, l’un en forme de croix Ânkh, un second à l’effigie d’Elijah Muhammad, et un troisième portant l’inscription Zulu Nation, n.d., métal, cuir, photographie, tissu, Washington, National Museum of African American History and Culture (numéro d’inventaire : 2006.0067.11, 2006.0067.17, 2006.0067.12).
Dans le cas de la bijouterie, le New York Times observe le port de « collier en cuir avec des médaillons rouges, noirs et vert, certains formant la silhouette du continent africain, d’autre comportant des photographies de Malcom X, Marcus Garvey et Haile Selassie26 ». À la fin des années 1980, on constate en effet un très relatif « éloignement de l’or27 » dans les parures des rappeurs. L’utilisation du cuir lui est parfois préférée pour être associée à des iconographies faisant référence à l’Afrique : « les pionniers du rap comme Expérience Unlimited, Heavy D and the Boys, Kool Mo Dee et Public Enemy – associés au port de larges bijoux en or – portent à présent des bijoux inspirés de l’Afrique28». Un jeune homme interrogé par le magazine new- yorkais exprime sa satisfaction d'observer cette réminiscence du passé politique afro-américain avant d’ajouter : « Au moins, ce ne sont plus ces pacotilles en or de mauvais goût. »
D’autres bijoux suggèrent, par leur sujet, une glorification du passé antique du continent africain, notamment des pendentifs prenant la forme de croix Ânkh, d’un buste de pharaon égyptien ou de la reine Néfertiti. Se positionnant dans les pas de Malcom X arborant sa chevalière aux couleurs de Nation of Islam, les rappeurs des années 1980 se parent pour revendiquer leur identité dans une société qui les marginalise.
Le bijou devient symbole de fierté et d’affirmation de soi.
16 « The sneakers you wore on your feet could either get you robbed or get you roasted, so you had to dress defensively. » Ibid., p. 121.
17 Ibid., p. 50.
18 Sacha Jenkins, Fresh Dressed, 2015.
19 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 11.
20 « They were the post-civil rights generation who wanted equality and liberation. They wanted to have a voice by any means necessary. » Ibid., p. 65.
21 « They are throwbacks to the 1960’s, recalling the time when the civil rights and black power movements inspired a generation of young black men and women, when everything and anything black was beautiful. [...] Once again, symbolic jewelry and clothing is being worn by young black Americans making statements of pride and identity. » Lena Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », The New York Times, 30 juillet 1989, p. 46.
22 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 65.
23 L. Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », op. cit.
24 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 33.
25 Ibid., p. 89.
26 « Leather necklaces with medallions of red, black and green, some shaped in the outline of Africa, others framing photographs of Malcom X, Marcus Garvey and Haile Selassie. » L. Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », op. cit.
27 « A Move Away From Gold ». Ibid.
28 « Rap grounds like Experience Unlimited, Heavy D and the Boys, Kool Mo Dee and Public Enemy – associated with the fad of large gold jewelry – now wear African-inspired jewelry. » Ibid.
C- Le bijou comme support d’une individualité
Au sein de la culture hip-hop, la quête d’une reconnaissance sociale passe également par l’individualisation des bijoux : « Lorsque les marques de luxe n’étaient plus à la hauteur et ne nous servaient pas, nous créions notre propre luxe. La récompense la plus satisfaisante était d’être interpellé par quelqu’un dans la rue qui nous demandait : “Où as-tu eu cela ?” et de répondre “Quoi ? Tu ne connais pas ?! Je l’ai fait moi-même”29 ».
Les modes d’expression du hip-hop consistent à imposer la présence de ses inventeurs dans un contexte socio-politique qui les marginalise au travers d’une pauvreté systémique, des déplacements, et des mesures d’austérité ciblées30. Plus généralement, la customisation et le re-mixing - c’est-à-dire la personnalisation par adjonction d’un signe singulier ou par l’association d’éléments provenant d’émetteurs culturels différents voire opposés – sont au cœur de la culture hip-hop que ce soit dans la manière de se parer ou dans l’adoption de surnoms. Ces phénomènes s’observent dès les années 1970 dans les pratiques vestimentaires des B-boys et des B-girls31, combinant le style des gangs urbains avec des chaussures de sport. Le graffiti offre de nouvelles images qui migrent rapidement des murs ou des trains vers les couvertures d’albums et les vêtements. Les graffeurs – tels Shirt King Phade – interviennent sur des vestes ou des jeans pour y peindre des logos uniques et personnels.

De même, si Dapper Dan utilise les logotypes des marques établies du luxe européen et américain, il les transpose en réalité sur des vêtements à la coupe ample, issue de la culture urbaine d’alors. Dan se place ainsi à contre-courant des grandes maisons : « Je ne dicte pas la mode. Je transcris la culture32 ». Il accueille ses clients – notamment des rappeurs qui alors ne sont pas les bienvenus dans les boutiques de la Cinquième Avenue – et les habille de telle sorte que, par le vêtement et la parure, ils deviennent la meilleure version d’eux-mêmes33. En prenant en compte leur musique et leur personnalité, il crée ainsi l’image qu’ils voulaient véhiculer.
En somme, « La traduction du hip-hop pour l’individualité s’exprimait par la customisation. Avoir quelque chose que personne n’a, […] porter un élément de parure unique en son genre ou des bijoux inscrits à votre nom, c’est montrer au monde qui vous êtes34 ». Ainsi, les pionniers du hip-hop, n’ayant pas accès aux grandes marques de joaillerie, vont faire fabriquer des bijoux vecteurs de leur individualité.
Les bijoux dits namesplates sont un support privilégié de cette personnalisation. Ils consistent à inscrire un mot, généralement des noms, dans une plaque de métal ajourée à la forme et parfois empierrée. Ils comprennent une grande variété de typologie : collier, motifs d’oreilles, bague, boucle de ceinture et bracelet. Une grande liberté de choix est également accordée quant à la taille, la typographie, le type de chaîne ou encore les ornements qui encadrent l’inscription, autant d’éléments permettant de créer un bijou unique. Les nameplates sont de ce fait un moyen pour les premiers rappeurs de montrer de manière ostentatoire leur surnom, leur personnalité, leur identité à l’échelle individuelle.
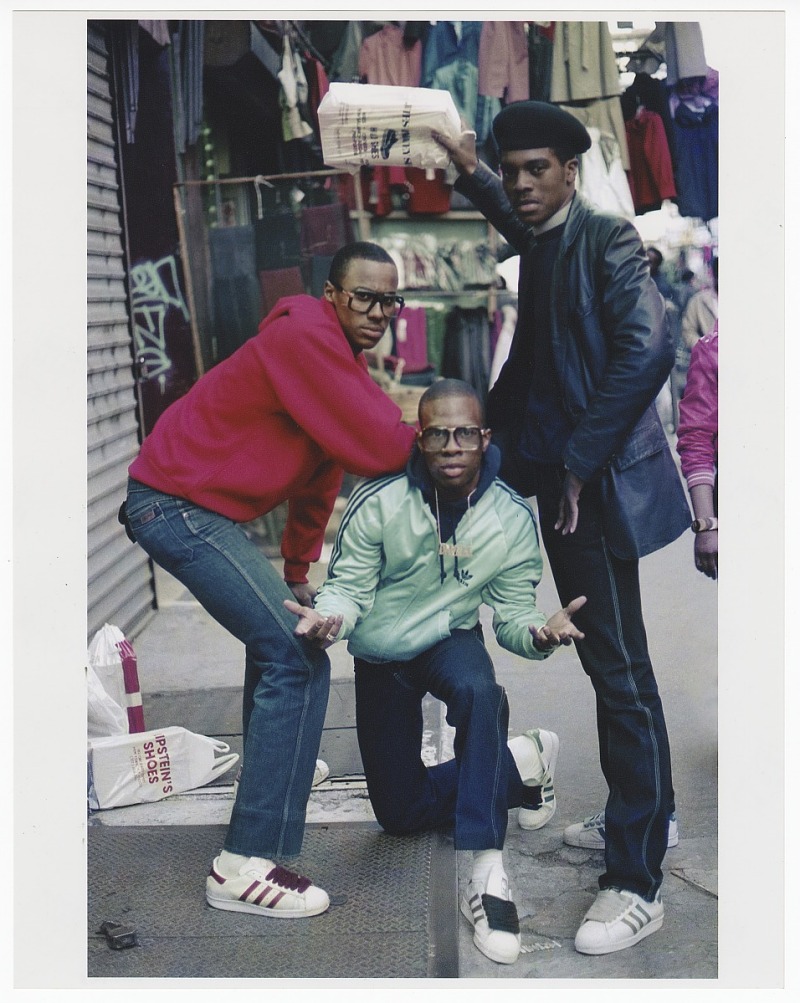
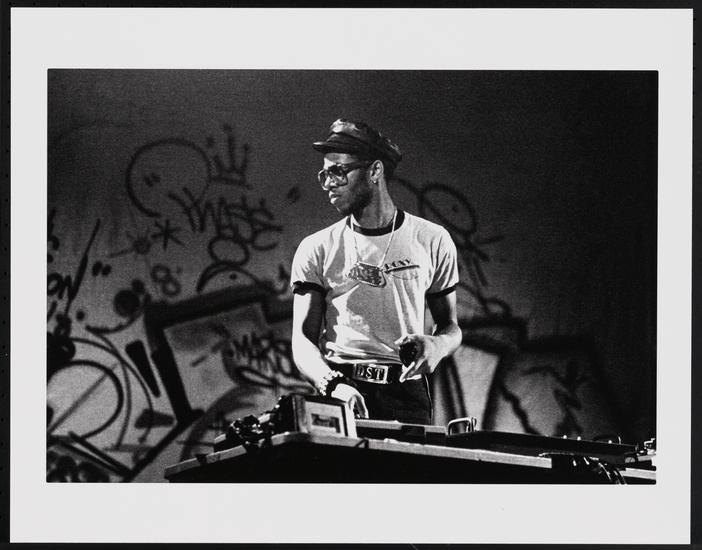
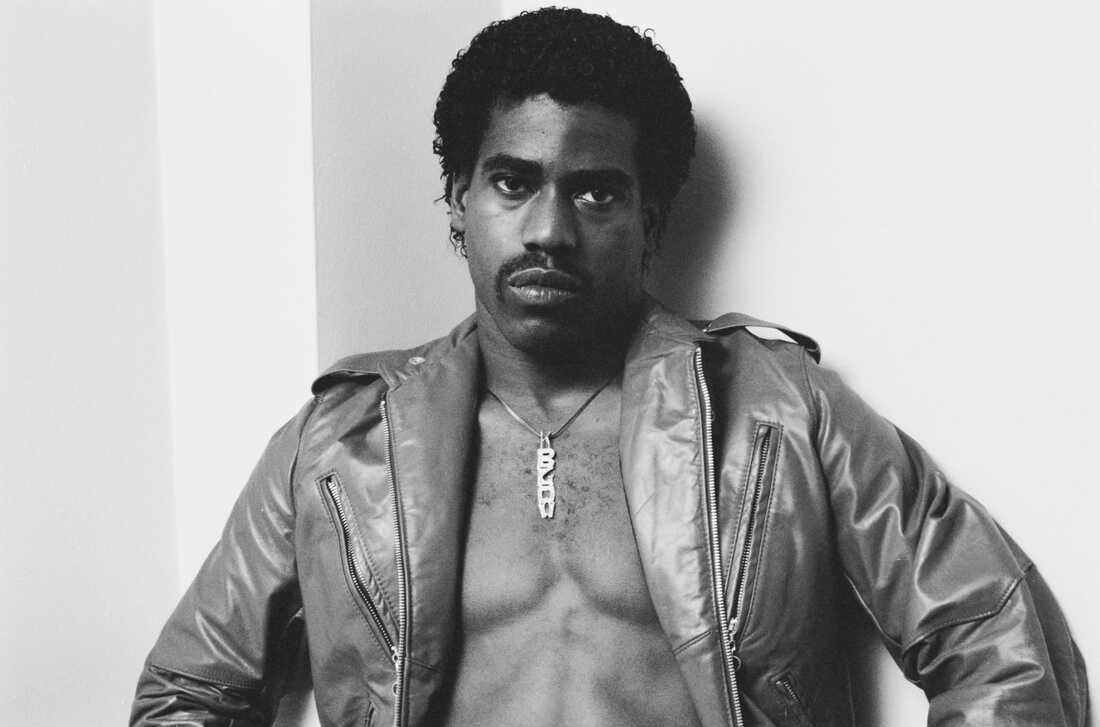
Le rappeur Kurtis Blow, par exemple, contribue à façonner le port des bijoux chez les rappeurs dès son premier album : sur la pochette, il s’affiche avec pour ornements une accumulation de colliers et chaînes à pendentifs, à ce moment-là de dimensions raisonnables. Il porte à d’autres occasions un pendentif nameplate à son nom : les lettres « BLOW » sont disposées à la verticale depuis une chaîne. Le pendentif devient ainsi un bijou distinctif permettant d'imprimer dans l’imaginaire collectif le style et l’image du rappeur.

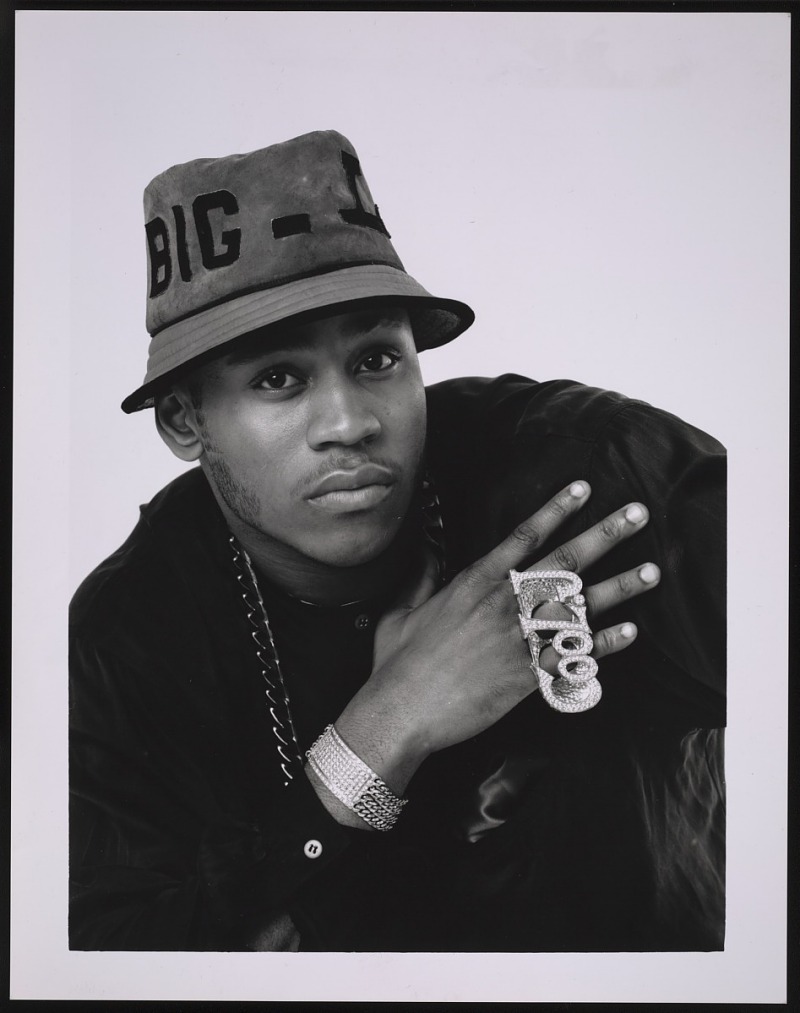
Le rappeur LL Cool J, quant à lui, contribue à populariser la bague à quatre doigts. Il possédait deux exemplaires de bagues nameplates - l’une inscrite avec son prénom de naissance, James, dont la lettre finale est remplacée par un « $ », la seconde en or jaune et empierrée portant son nom de scène.
Dans les années 1990, la culture hip-hop trouve une première forme de légitimité dans l’industrie musicale et de la mode. Les rappeurs New School, dont Run-DMC, contribuent à étendre l’influence d’une culture alternative, le hip-hop, sur la culture dominante. L’apparition d’émissions dédiées sur des radios libres ou à la télévision – rappelons ici l’important rôle de MTV, créé en 1981, dans la diffusion des clips vidéo – contribue à propager la musique rap et son style vestimentaire aux heures de grandes écoutes.
Le succès de Dapper Dan ou encore d’April Walker et Karl Kani, ouvre également la voie aux nombreuses marques de mode hip-hop créées durant la seconde moitié des années 1980, à l’instar de Cross Colours. Celle-ci rencontre un enthousiasme grandissant et sature les écrans, diffusée par les clips vidéo ou les séries télévisées à l’instar du Prince de Bel-Air. Dans le même temps, les rappeurs fondent leurs propres labels indépendants. Dès lors, « les artistes promouvant leur propre marque devint la nouvelle norme pour les labels et leur manière de faire des affaires. Ils demandèrent leur propre placement de produit, et les contrats commencèrent à refléter cela35». Alors que les rappeurs accèdent à une reconnaissance commerciale et internationale dans les années 1990, il est devenu plus facile pour eux d’afficher leur succès, ce qu’ils peuvent à présent aisément s’offrir ou encore obtenir par des partenariats.
La culture hip-hop devient une industrie à part entière, en mesure de composer avec les maisons de haute couture et de haute joaillerie. Les collaborations de A$AP Ferg et Tiffany en 2018, puis celle de Jay-Z et Beyoncé avec cette même maison de joaillerie en 2021 confirment l’évolution du regard porté par les industries du luxe, et en particulier la joaillerie, sur la culture hip-hop.
29 « When the luxury brands fall short and don’t serve us, we create our own luxury. The most satisfying payoff is when someone on the street asks that age-old question: “Where’d you get that from?”, my answer is always at the ready “What, you ain’t know!? I made it myself”. » Vikki Tobak (dir.), Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, Cologne, Taschen, p. 9.
30 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 168.
31 Contraction de Breaking-Boys et Breaking-Girls, autrement dit des danseurs de breakdance.
32 « I do not dictate fashion. I translate culture. » E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 79.
33 Ibid.
34 « Hip-Hop's tradition of individuality was expressed through customization. To have something nobody else has, to make you piece a bit more unique, to wear an article of adornment made with a one-of-a-kind design, to rock jewelry displaying your name, is to show the world who you are. » V. Tobak (dir.), Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, Cologne, Taschen, p. 19
35 « Artists endorsing their own brands became the new norm for record labels and how they did business. They demanded their own product placement, and contracts eventually started to reflect that. » Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 122.
***
Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.
Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.
***
Exposition :
Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry
American Museum of Natural History
Opening Thursday, May 9, 2024
Floor 1, Mignone Halls of Gems and Minerals, Meister Gallery
Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry célèbre l'influence culturelle du hip-hop à travers des bijoux portés par certaines de ses stars emblématiques. S'appuyant sur la célébration par la ville de New York du 50e anniversaire du hip-hop en tant que phénomène mondial, l'exposition mettra en lumière l'évolution des bijoux dans le hip-hop au cours des cinq dernières décennies, en commençant par les chaînes en or surdimensionnées portées par les pionniers du rap dans les années 1980 et en passant par les années 1990, lorsque les rappeurs devenus des magnats du business arboraient des pendentifs de maison de disques étincelants de diamants et de platine.

visuel de "une" : Jam Master Jay, Adidas Pendant
Alvaro Keding/© AMNH
Après la chanson "My Adidas" de Run-DMC en 1986, Adidas a conclu avec le groupe un accord de parrainage unique en son genre, offrant à chaque membre un de ces pendentifs en or 14 carats en forme de chaussures de sport.
Veuillez cliquer sur ce lien pour vous abonner à la newsletter de Property of a lady
Une histoire des bijoux régionaux : la Normandie
Par Brigitte Serre-Bouret
"Des carrioles arrivaient des communes voisines, déchargeant au seuil des portes les hautes Normandes en robes sombres, au fichu croisé sur la poitrine et retenu par un bijou d’argent séculaire". Guy de Maupassant, La Maison Tellier, 1881
Témoin de son temps, Guy de Maupassant (1850-1893) nous évoque sa région, la Haute Normandie (à l’époque la Seine-Inférieure et l’Eure) où les parures ne brillaient qu’en de rares occasions.
A quelle catégorie sociale appartenaient les élégantes qui portaient ces bijoux ? Gravures et portraits nous renvoient indifféremment, paysannes, femmes de pêcheurs, maîtresses ou servantes, modestes artisanes, commerçantes aisées. Comme dans toutes les provinces de France, le bijou est avant tout transmission patrimoniale et valeur refuge, jalousement conservé de mère en fille. Assorti de la coiffe en dentelle, parfois presque aussi coûteuse, il sert aussi de langage, attestant de la provenance géographique de sa propriétaire, témoignant de son bien.
A l’époque de l’écrivain, quelques kilomètres suffisent à souligner les différences : coutumes, costumes, langage. Les jours de foires ou de fêtes, avant de se parler, chacune, chacun, s’identifie au port du vêtement et du bijou, à la manière dont la coiffe est amidonnée. Dans le pays de Caux natal de Maupassant, le montage de cette dernière suffit à lui seul à identifier une femme de Dieppe, d’Yvetot ou des bords de Seine.
Pour le bijou, le particularisme est moindre. Si la Seine est une sorte de frontière entre la Haute et la Basse Normandie, les bijoutiers se copient, voyagent, suivent la mode. Certains fabriquent sur place, d’autres se fournissent à Paris d’éléments assemblés selon la commande. C’est ainsi qu’il n’est pas rare dans la Manche de trouver un bijou provenant de Rouen.
Dès avant la Révolution, Normandie et Provence, sont les premières régions de France, économiquement prospères, à témoigner de bijoux fabriqués localement. Du fait de l’essor industriel et des réseaux de communication, ferroviaires, maritime également avec l’Angleterre, la Normandie sera aussi parmi les premières à perdre son identité régionale, la mode parisienne gagnant vite du terrain.


La croix-bosse : un vénérable ancêtre
Presque toutes les croix normandes présentent la particularité d’avoir le pendant inférieur amovible. La croix bosse se porte dès avant la Révolution en Haute Normandie et dans le Calvados. Les deux faces du bijou obtenues par estampage d’une mince feuille d’or ou d’argent, sont soudées l’une à l’autre. Le décor bosselé imite les pointes de diamant. Le rembourrage de ce bijou fragile et creux se fait avec de la résine, du plâtre, parfois même du torchis !
Le bijou se complète de pendants d’oreilles et d’un cœur coulant, les petits orifices aménagés au verso de ce dernier permettant de passer un ruban remplacé au début du XIXème siècle par une chaîne. Ce bijou léger peut atteindre des dimensions surprenantes, plus de 15cm de hauteur. Il est fragile : la croix bosselée se cabosse !

Les pans de dentelle relevés sur le sommet de la tête évoquent une coiffe de l’Eure. Croix bosse et cœur coulant en or sont retenus par une chaine jaseron. Des pendants d’oreilles les complètent.

Or, fin XVIIIème, début XIXème. Collection Michael Fieggen.
Les croix à pierres
La quadrille et la croix de Saint-Lô
Mis à la mode par les grands bijoutiers du XVIIIème siècle, le strass séduit par son imitation parfaite et économique du diamant. Sous l’Empire, il brille sur les croix normandes, reléguant la croix-bosse dans quelques écrins d’ancêtres. Dans toute la Normandie se fabrique la « croix drille » (du nom de l’outil du bijoutier) aussi nommée, la « quadrille » du fait de sa forme carrée.
Sur fond d’or ou d’argent repercé à décor de fleurons, le bijoutier aménage des cabochons sertis en cônes retenant le strass. Croix et cabochons deviennent volumineux à Saint Lô, ville qui donnera l’appellation générique à ce type de croix.

De la quadrille aux formes stylisées, naît la croix de Rouen. Sa forme s’étire sur une large plaque d’or repercée, bombée, garnie de strass. Le cabochon central s’ouvre en une myriade de pierreries nommée « à l’enfantement ». Elle est articulée et se complète du « coulant » qui tient plus du bouton de fleur que du cœur. Ce bijou, toujours en or, fabriqué à Rouen sous l’Empire et la Restauration, se fera aussi à Paris ultérieurement.


Des artistes parisiennes séduites par les bijoux normands
Le tableau Le Balcon réalisé par Édouard Manet est célèbre car il représente la première apparition de celle qui, d’élève à modèle, allait devenir la première femme impressionniste : Berthe Morisot (1841-1895). Elle porte le cœur coulant d’une croix de Rouen, témoignage de ses attaches familiales fécampoises.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski


De même dans ses autoportraits, Marie Bracquemond (1840-1916), peintre impressionniste méconnue, témoigne de son intérêt pour les bijoux normands. Ces artistes font preuve d’originalité. En effet, dans certains milieux parisiens, il était à la mode de se démarquer en portant des bijoux régionaux.

Genève, musée du Petit Palais. L’artiste, à gauche, porte une croix de « St Lô ».
Le collier d’Yvetot
Ce collier à pierres, lourd et d’un bel effet, se compose d’éléments s’articulant entre eux à décor géométrique ou floral, retenant une croix ou la colombe du Saint-Esprit.
Cette appellation lui a été donnée par un bijoutier du pays de Caux ayant constaté qu’il s’en portait beaucoup à Yvetot, gros bourg du pays de Caux ainsi qu’à Rouen et sa région. En réalité, son origine est parisienne.
C’est l’exemple typique d’une fabrication que les bijoutiers normands s’approprient, se procurant à la capitale les éléments de bijoux qu’ils assemblent ensuite selon la demande et les moyens financiers du client.

Le Saint-Esprit
Ce bijou suspendu à une bélière en forme de nœud était déjà fabriqué à Saint Lô avant la Révolution. Au siècle suivant, il provient aussi d’ateliers niortais et parisiens.
On le nomme Saint Esprit car il représente la colombe emblématique descendant du ciel tenant au bec un rameau orné de pierres blanches ou de couleurs. Parfois ce sont des grappes de raisins auxquelles s’abreuvent des oisillons en signe de fécondité. Messagère de Vénus puis symbole de paix et du baptême chrétien, il est difficile de déterminer si ce bijou, évocateur de l’amour était offert au moment du mariage ou s’il était symbole religieux, catholique ou protestant.
Ce bijou fragile s’est porté dans toute la Normandie.

Argent moulé, strass blancs et de couleurs. Paris, milieu XIXème. Collection Michael Fieggen.
Les ivoires de Dieppe
En créant au milieu du XVIIème siècle la Compagnie normande, Richelieu accordait à une association de marchands de Dieppe et de Rouen le privilège d’exploiter le Sénégal et la Gambie. Parmi les marchandises importées, le commerce de défenses d’éléphants allait faire de Dieppe le principal centre ivoirier de France.
Au sein de la production surabondante qui va de la maquette de navire à la statuette en ronde-bosse, de l’objet religieux aux objets usuels, râpes à tabac, carnets de bal, souvenirs touristiques, les ivoiriers produisent des bijoux à motifs floraux, pensées, corbeilles de mariages, colombes, gerbes de blé, tout un vocabulaire évoquant l’amour, l’union conjugale et que les ébénistes sculptent aussi sur le fronton des armoires de mariage.
Le travail de l’ivoire était florissant à Dieppe qui comptait en 1820 près d’une centaine d’ateliers. En 2016, le décret Ségolène Royal interdisant le commerce de l’ivoire en France a conduit à la fermeture du dernier atelier qui perpétuait un artisanat de qualité depuis six générations.

Ivoire. XIXème siècle. Dieppe. Les Pêcheries, musée de Fécamp

Le collier dit « d’esclavage »
« De s’y mettre en ménage, ce n’est qu’un trépas certain… penser à son ouvrage. Adieu plaisirs, adieu beau temps, je suis dans l’esclavage »
Cette chanson populaire poitevine a malheureusement associé la condition féminine à ce charmant collier offert au moment du mariage. Un bien vilain nom pour un collier original qui se distingue par l’enchaînement de une à trois plaques à des chaînes différentes.
Son port se développe sous le Directoire à Paris pour être très en vogue sous l’Empire et jusqu’au milieu du XIXème siècle où il rencontre un vif succès en Normandie, en Poitou-Charentes, en Bourgogne, en Auvergne. Les bijoutiers se fournissent en éléments séparés. Les plaques émaillées proviennent du Poitou ou de la Bresse, les chaînes aux mailles différentes sont fabriquées à Paris. En Normandie, des bijoutiers plus talentueux gravent et repercent eux-mêmes la plaque centrale. Le charme de ces colliers vient de la variété de l’assemblage des éléments aux choix de la cliente. Ils sont tous différents !
C’est encore en Normandie que l’on retrouve les plus anciens esclavages aux décors gravés. Ils évoquent l’amour et la symbolique nuptiale (colombes, arc et flèches, corbeille de mariage, cœurs unis). Lorsqu’il s’agit d’une plaque émaillée le décor associe le chien de la fidélité aux cœurs enlacés ou le rébus de la pensée fleurie associée à l’inscription A MOI (Pensez à moi).

Au tout début du XIXème siècle, le collier de type « esclavage » comporte souvent une seule plaque comme en atteste cette élégante jeune femme. Le couple de colombes qu’elle tient répond en écho au décor identique gravé de colombes se becquetant sur ce collier normand.

Le sous-sol normand était-il riche ?
Les « diamants » normands
Dans son livre paru en 1787, intitulé Mémoires historique sur la ville d’Alençon et sur ses seigneurs, Joseph Odolant Desnos écrit : « les orfèvres de la ville utilisent des diamants faux, blancs et bruns extraits des carrières environnantes et qui lorsqu’ils sont mis en œuvre ne le cèdent en rien pour l’éclat aux diamants fins ». Effectivement, la carrière du Pont-Percé à quelques kilomètres d’Alençon, a longtemps livré un beau quartz cristallisé en prisme exploité et vendu sous le nom de diamants d’Alençon pour la fabrication des bijoux.
Jusqu’à l’Empire, des croix de Saint Lô sont reconnaissables car ce quartz fumé est légèrement brunâtre. Les bijoux ont continué à être fabriqués avec l’appellation « diamants d’Alençon » que seule une analyse géologique authentifierait car au fil de l’épuisement des carrières, des quartz plus blancs venant d’autres régions et surtout le strass, vinrent le remplacer.

***
Brigitte Serre-Bouret est docteur en histoire de l’art et archéologie, conservateur en chef du patrimoine et enseignant chercheur. Après plus de trente ans de direction de musées de Beaux-arts, elle se consacre aujourd’hui à la recherche et à l’enseignement supérieur dans ses domaines de compétences. Notamment, elle enseigne à l’Institut National de Gemmologie à Paris et à Lyon, l’histoire et la sociologie du bijou. Elle a organisé ou participé à plusieurs expositions sur le sujet.

Son dernier ouvrage « Bijoux, l’Orfèvre et le Peintre » porte sur la symbolique des gemmes et des bijoux au travers des portraits, de l’Antiquité au début du vingtième siècle.
A voir !
Manet/Degas
Du 28 mars au 23 juillet 2023
Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie et le Metropolitan Museum of Art, New York où elle sera présentée de septembre 2023 à janvier 2024.
Musée d'Orsay
Esplanade Valéry Giscard d'Estaing
75007 Paris

Pistes bibliographiques :
Brigitte Serre-Bouret Bijoux, l'orfèvre et le peintre 2022
contact@editionsdesfalaises.fr
Brigitte Bouret Bijoux et Orfèvres en Haute-Normandie 1993
Michael Fieggen Les Bijoux des Français 2021.
Un mystérieux objet de vertu signé Cartier-Linzeler-Marchak
To read this article in English, please click here
Par Olivier Bachet
Cet article est le fruit d'une acquisition. Mon partenaire est un jour revenu des États-Unis avec dans sa poche un bel objet : un étui à cigarettes Cartier en or, décoré sur ses deux faces d'extraordinaires scènes de chasse persanes probablement inspirées d'une page de manuscrit persan, et réalisées en délicates incrustations de nacre et de pierres dures par Wladimir Makowsky (1884-1966), le maître de la marqueterie joaillière de l'époque Art Déco.
Cette boîte était signée « Cartier Paris Londres New York », mais elle portait également une mention mystérieuse : « incrustations de Linzeler Marchak ».
Il était pour le moins curieux de trouver une double signature sur une boîte Art Déco.

Or, lapis-lazuli, émail, marqueterie de nacre.
Signé Cartier Paris Londres New York.
À l'intérieur, le long du bord gauche, est gravé la mention "Incrustations de Linzeler Marchak".
La marqueterie en nacre et pierres dures porte le monogramme de l'artiste dans le coin inférieur droit : un "m" arrondi pour Wladimir Makowsky
L: 8.7 cm; W: 5.4 cm; H: 1.3 cm.
Collection privée.

A noter chacune des deux scènes de cet étui portent le monogramme de W. Makowsky

Cartier et Linzeler-Marchak n'avaient pas, à ma connaissance, travaillé ensemble. Une autre énigme s'est alors ajoutée à la première. Je connaissais le joaillier Linzeler davantage pour ses pièces d'orfèvrerie que pour ses bijoux, et Marchak davantage pour ses créations d'après-guerre - et notamment ses grandes bagues « cocktail » - que pour ses créations Art déco, mais surtout je n'avais que très rarement vu l'association des deux noms sur une pièce. Je me suis alors soudain souvenu que la plupart des pièces en argent fabriquées par Cartier dans les années 1930 portaient le poinçon de Robert Linzeler. Ces pièces étaient très nombreuses, car si, pour le commun des mortels, Cartier est avant tout un joaillier, une part très importante des ventes de la période Art Déco était alors représentée par l'argenterie, notamment l'argenterie de table, l'argenterie de ménage, les centres de table, les flambeaux, etc… A l'époque, je faisais des recherches pour le livre que j'écrivais avec Alain Cartier, Cartier : Objets d'exception. Il était donc temps de mettre un peu d'ordre dans tout cela pour voir plus clair et comprendre la relation entre trois grands noms de la bijouterie parisienne : Linzeler, Marchak et Cartier.
Robert Linzeler est né le 9 mars 1872. Il descendait d'une dynastie de bijoutiers-orfèvres installés à Paris depuis 1833. En 1897, il s'installe au 68 rue de Turbigo, où il rachète l'atelier de Louis Leroy. Par la même occasion, il dépose son poinçon de maître orfèvre le 14 avril 1897. Celui-ci se compose des deux lettres R et L surmontées d'une couronne royale. Comme le veut la tradition chez les bijoutiers français, ce poinçon reprend le symbole du poinçon de son prédécesseur, à savoir une couronne royale. On aurait pu croire qu'en raison du nom de Leroy ce symbole avait été choisi par ce dernier - en général les symboles étaient choisis selon des jeux de mots faisant référence au patronyme du fabricant - mais en réalité, ce symbole était celui du prédécesseur de Leroy, Jules Piault, un orfèvre spécialisé dans la fabrication de couteaux dont l'atelier de la rue de Turbigo avait été racheté par Leroy en 1886.

Spécialité : orfèvre, bijoutier
Poinçon de maître : Symbole : Une couronne
Poinçon de maître : Lettres : R.L
Adresse : 68 rue de Turbigo, puis 9 rue d'Argenson et 4 rue de la Paix, Paris
Date d'insculpation : 14/04/1897
Date de biffage : 1949

Spécialité : Orfèvre
Poinçon de maître : Symbole : Une couronne
Poinçon de maître : Lettres : L et Cie (la répartition des lettres dans le poinçon est hypothétique)
Adresse : 68 rue de Turbigo
Date d'insculpation : 15/11/1886
Date de biffage : 04/05/1897

Spécialité : Orfèvre
Poinçon de maître : Symbole : une couronne
Poinçon de maître : Lettres : J.P
Adresse : 68 rue de Turbigo, Paris
Date d'insculpation : 1856
Date de biffage : 1887
Les affaires sont florissantes puisqu'en avril 1903, Robert Linzeler quitte la rue de Turbigo et acquiert un hôtel particulier de 480 m2 situé rue d'Argenson dans le luxueux VIIIe arrondissement de Paris pour y installer à la fois son atelier et une salle d'exposition pour recevoir une clientèle privée.

La mention " succr. "après le nom est l'abréviation du mot " successeur ".
Autre détail amusant, il précise sous son adresse "près de Saint Augustin", c'est-à-dire près de l'église Saint Augustin. A une époque sans GPS, cela permettait aux clients de situer immédiatement la rue et surtout de montrer que les ateliers étaient situés dans un quartier chic, contrairement à la tradition des ateliers parisiens de bijouterie et d'orfèvrerie qui, historiquement, étaient situés dans le quartier du Marais, aujourd'hui l'un des plus chers de Paris mais au début du XXe siècle, très populaire, ce qui était encore le cas lorsque Linzeler s'était installé en 1897 rue de Turbigo.

Cette période qui précède la première guerre mondiale est féconde.
Le génial Paul Iribe, qui avait également Cartier comme client pour qui il fabriquait de l'argenterie, conçoit des bijoux pour Linzeler, comme le souligne Hans Nadelhoffer dans son livre Cartier. Linzeler était donc, comme souvent à l'époque, à la fois fabricant pour les autres et détaillant pour lui-même.

Platine, diamants, saphirs, perles et émeraude conçus par Paul Iribe pour Robert Linzeler, vers 1911
Collection privée
Après la Grande Guerre, en décembre 1919, la société est rebaptisée ROBERT LINZELER-ARGENSON S.A. Ce changement de nom s'accompagne de l'installation d'un magnifique magasin décoré par les amis de Robert Linzeler, Süe et Mare, connus pour leur décoration Art Déco. Malheureusement, les affaires sont mauvaises. Il ne faut pas oublier que les lendemains de guerre sont une période de crise qui rend les affaires difficiles.


Argent, marbre portor. Signé Cartier. Poinçon français à tête de sanglier pour l'argent. L : 35 cm ; l : 11 cm (set de plateaux). L : 25 cm (couteau à papier). L : 13,5 cm ; l : 6 cm (tampon encreur). L : 4,5 cm ; H : 6 cm (pot à allumettes).
Fabricant : Linzeler. Collection privée.
Cet ensemble de bureau est réalisé en marbre Portor, noir veiné de jaune. Il est identique au marbre choisi par le marbrier Houdot pour décorer la façade de la boutique de la rue de la Paix en 1899. Utilisé pour décorer toutes les boutiques de Cartier dans le monde, ce marbre est souvent associé à Cartier.
C'est alors que les frères Marchak interviennent.
Les frères Salomon et Alexandre Marchak, nés à Kiev respectivement en 1884 et 1892, étaient les fils de Joseph Marchak surnommé le « Cartier de Kiev ». Bijoutier et orfèvre, la haute qualité de ses productions avait fait la réputation de l'entreprise.
En 1922, les frères Marchak entrent dans le capital de Robert Linzeler, et la société devient LINZELER-MARCHAK. Ils signent les pièces en conséquence, et c'est encore sous ce nom qu'elles reçoivent un Grand Prix à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925. La société LINZELER-MARCHAK devient la A. MARCHAK (Société Française de joaillerie et d'orfèvrerie A. Marchak) en décembre 1927.

Cette période correspond, je pense, à l'intervention de Cartier dans l'affaire Linzeler, mais seulement pour la partie concernant l'hôtel particulier de la rue d'Argenson. En effet, ne l'oublions pas, Linzeler possédait cet hôtel particulier et le magasin du 4 rue de la Paix. Je ne sais pas si Cartier était entré dans le capital de Linzeler à la fin des années 1920, mais cela est probable puisqu'en 1932, René Révillon, gendre de Louis Cartier, propose d'augmenter le capital de la société et d'en donner une partie en actions à Robert Linzeler en échange de la vente du fonds de commerce et de l'hôtel particulier de la rue d'Argenson. Les actions restantes sont achetées par Cartier-Paris et surtout par Cartier-New York, qui en devient l'actionnaire majoritaire. Cette date correspond également à la fin de l'association entre Robert Linzeler et les frères Marchak. Il semble donc qu'à cette date, Cartier ait pris totalement possession de la rue d'Argenson et les frères Marchak du magasin de la rue de la Paix. La société Linzeler-Marchak est définitivement dissoute le 10 juin 1936. Robert Linzeler décède le 25 janvier 1941.
Ainsi, à partir de 1932, l'atelier Robert Linzeler du 9 rue d'Argenson produit de nombreuses pièces d'argenterie pour Cartier, son nouveau propriétaire. L'atelier devient, en quelque sorte, l'atelier de la Maison spécialisé dans la fabrication de pièces d'argenterie, notamment pour Cartier-New York, propriétaire de la majeure partie du capital de la société. Cela explique que de nombreuses pièces portent le poinçon de Robert Linzeler, non pas en forme de losange, mais en forme de pentagone dit « obus » ce qui signifie que la pièce était uniquement destinée à l'exportation en témoigne cette extraordinaire paire de candélabres Cartier en or, argent, laque et verre que j'ai eu la chance d'acquérir. Elle fait désormais partie de la collection Lee Siegelson à New York. Il est à noter que c'est dans ce vaste hôtel particulier que Cartier installa dans les années 1930 l'atelier Ploujavy, un autre atelier de fabrication spécialisé dans la réalisation d'objets en argent et en laque tels que des boîtes à cigarettes et des vanity cases.

Argent, or, verre et laque
Signé Cartier Made in France
Poinçon de maître : Robert Linzeler
Siegelson, New York

À l'exception des pendules de l'étagère supérieure, cette vitrine est un bon exemple de l'importance que représentait l'argenterie dans le succès de Cartier, fait aujourd'hui presque totalement oublié.


Spécialité : Orfèvre, bijoutier
Poinçon de maître : Symbole : Deux lignes croisées
Poinçon de maître : Lettres : P.L.J.V
Adresse : 66 rue de de La Rochefoucault, puis 9 rue d'Argenson, Paris
Date d'insculpation : 08/08/1929
Date de biffage : ?
Le poinçon de Robert Linzeler est définitivement rayé en 1949. Le 23 juillet de cette année-là, la société LINZELER-ARGENSON devient la société CARDEL par contraction des noms Cartier et Claudel. Ceci en référence à Marion, la fille unique de Pierre Cartier, le propriétaire de Cartier-New York. Elle était née Cartier et devint Claudel suite à son mariage avec Pierre Claudel (fils de l'écrivain Paul Claudel). La couronne de Linzeler a été conservée comme symbole sur le nouveau poinçon de maître.

Spécialité : Orfèvre
Poinçon de maître : Symbole : une couronne
Poinçon de maître : Lettres : S.A.C.A.
Adresse : 9 rue d'Argenson, Paris
Date d'insculpation : 19/09/1949
Date de biffage : ?
Enfin, pour répondre à la première énigme, pourquoi y a-t-il une signature « Linzeler-Marchak » sur un étui à cigarettes Cartier ?

Je ne vois qu'une seule hypothèse : L'étui est "né" Cartier. Avec sa frise de motifs géométriques gravés sur les bords sans émail, son onglet et ses coins en pierre dure, il appartenait à la série des étuis « chinois ». Il s'agissait d 'étuis relativement peu élaborés dont les deux faces étaient probablement décorées de laque burgauté à l'image d'un autre exemplaire de 1930. La boîte était-elle endommagée ou le client souhaitait-il une boîte avec un décor plus élaboré ? Le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, elle passa vers 1925, dans des circonstances inconnues, entre les mains de Linzeler-Marchak, situé au 4 rue de la Paix en face du magasin Cartier. Elle fut alors transformée par l'ajout d'un entourage émaillé et de deux magnifiques miniatures Makowsky et signée de la mention "incrustations de Linzerler-Marchak", mais la signature Cartier ne fut pas retirée.

L'histoire de cette affaire illustre bien la complexité des relations entre les bijoutiers et les orfèvres parisiens dans le premier tiers du XXème siècle, où, dans certaines circonstances, on n'hésitait pas à racheter des objets de la concurrence, à y ajouter sa propre signature et à les vendre en son nom propre.

Or, laque burgauté, corail, émail, platine, diamants taille rose et écaille de tortue.
Signé Cartier Paris Londres New York.
Poinçon français à tête d'aigle pour l'or.
Poinçon de maître : Renault
L : 8,3 cm ; l : 5,5 cm ; h : 1,4 cm.
Collection privée.
***
Bibliographie :
O. BACHET, A. CARTIER, Cartier, Objets d'exception, Palais Royal 2019.

M. DE CERVAL, Marchak, éditions du Regard, Paris, 2006.
J. J. RICHARD, BIJOUX ET PIERRES PRECIEUSES, Blog, Articles sur Marchak et Linzeler, Août 2017, Février 2018
***
Suzanne Belperron et Aimée de Heeren : une amitié, un collier, une redécouverte
Récemment, le marché a vu brièvement réapparaître un collier de Suzanne Belperron dont on avait depuis longtemps perdu la trace. Les experts se sont penchés sur cette pièce avec respect et admiration - et notamment le premier d'entre eux, Olivier Baroin, qui a bien voulu nous faire part de ses impressions et exhumer pour nous la figure trop oubliée d'Aimée de Heeren, grande amie de Suzanne Belperron, mais aussi grande cliente qui rêvait de posséder un exemplaire de ce collier.

"Il s'agit d'une pièce exceptionnelle, provenant d'une collection privée européenne, que je n'avais jamais vue autrement que sur une photographie précieusement conservée par la créatrice dans ses archives", explique Olivier Baroin, expert de Suzanne Belperron et détenteur de ses archives personnelles. "Ce collier n'est sans doute pas une pièce unique, c'est l'un des exemplaires de ce type, conçu à la fin des années Trente et reproduit au fil des décennies par la créatrice". Combien de pièces semblables existe-t-il ? Difficile à estimer selon l'expert... "D'autres modèles réapparaîtront probablement sur le marché une fois celui-ci dévoilé à la presse et au grand public. Je n'imagine pas que ce type de bijou ait pu être démonté par des héritiers lors de successions : l'esthétique du collier, véritable oeuvre d'art, supplante, une fois n'est pas coutume, la valeur intrinsèque du bijou."

Orné de deux motifs coniques retenant des demi-cercles pavés en alternance de diamants taille ancienne, circonférence intérieure 370 mm environ, poinçons français pour l'or 18K (750/00), poids brut 132.30 g, restaurations. Les cinq arceaux sont mobiles. Le poinçon de maître, difficilement lisible se situe au centre du collier, sur le second demi-cercle en or. On en aperçoit en fait qu'une trace : quand on a insculpé le poinçon, la frappe ne s'est faite que sur la pointe du losange. Le poinçon de maître a ripé. Olivier Baroin perçoit la pointe du losange, le "S" surmonté du "t" et le "é" de Sté. Le poinçon Groené et Darde reconnu par l'expert permet de certifier que le collier a été réalisé entre 1942 et 1955. Accompagné d'une attestation de Monsieur Olivier Baroin. Cf.: Sylvie Raulet & Olivier Baroin, Suzanne Belperron, Paris, 2011, p. 211, pour une photographie d'un collier identique.
Influencée par l'engouement pour les arts africains collectionnés avec passion par les artistes français dès le début du XXème siècle, Suzanne Belperron aurait dessiné ce collier signature à la fin des années 30. Le dessin ci-dessous d'une parure or jaune et diamant est une déclinaison amincie du collier mis aux enchères ce printemps. Les clous d'or sont remplacés par une torsade d'or et de diamants, dessin typique du trait Belperron.

Gouache, projet de collier, bracelets et boucles d'oreilles dits "africains" en or jaune, platine et diamants. Archives Olivier Baroin. Cf.: Sylvie Raulet & Olivier Baroin, Suzanne Belperron, Paris, 2011, p. 210.
On retrouve le même collier que celui de la vente parisienne dans deux pages de publicité commanditées par la Maison Herz-Belperron. Femina et Vogue présentaient en 1948 le collier composé de multiples demi-cercles rigides en or, alternés de demi-cercles sertis de diamants, retenus de chaque côté par un clou de forme conique.
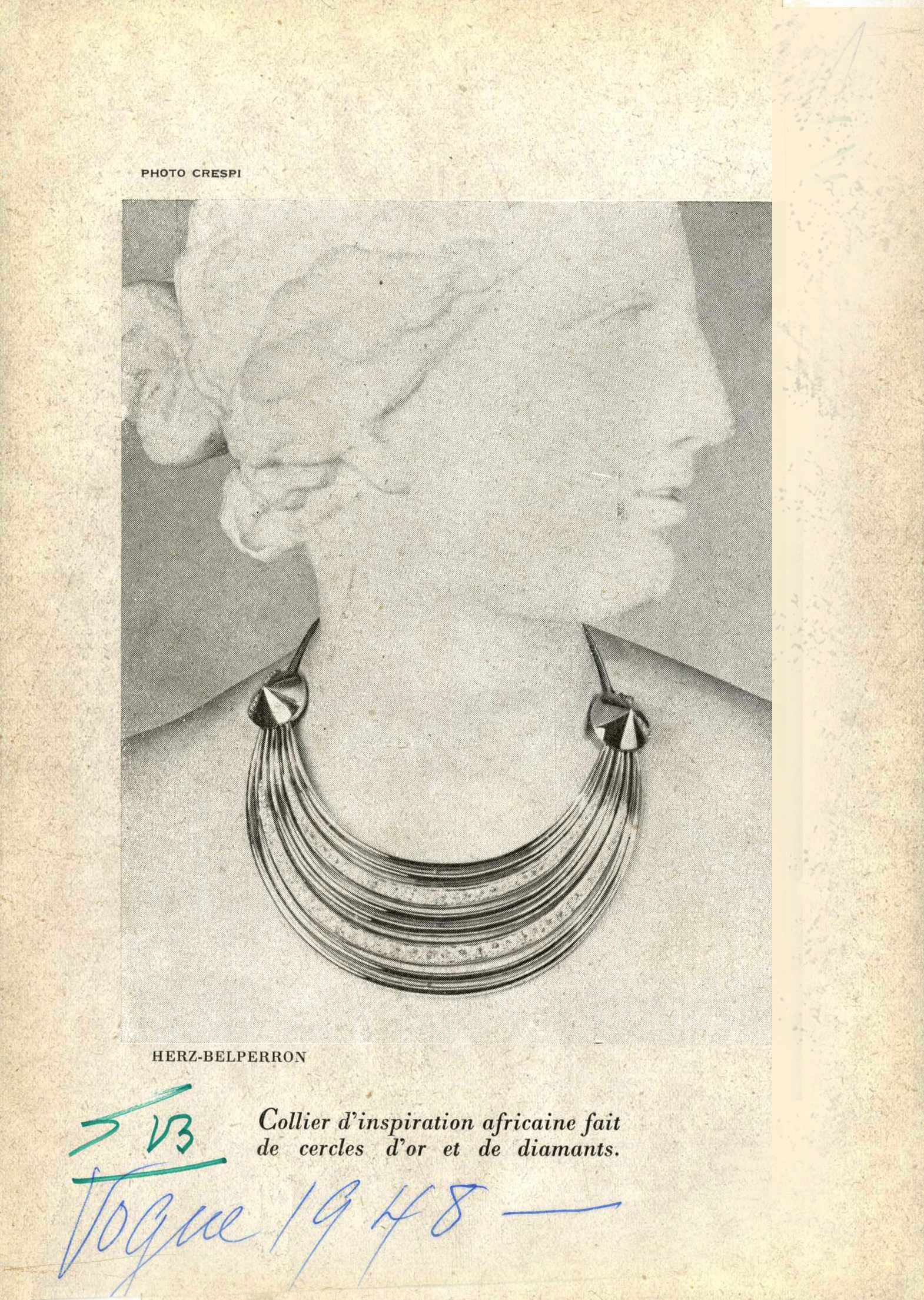
Ce collier a séduit les personnalités qui suivaient attentivement les créateurs et créatrices de leur temps, et influençaient les réputations, au premier rang desquelles Aimée de Heeren.

Aimée de Heeren (vers 1903-2006), ravissante mondaine d'origine brésilienne célébrée pour sa beauté, son originalité, son goût et son élégance, possédait une exceptionnelle collection de bijoux (la légende raconte que le Duc de Westminster, alors amant de Coco Chanel, lui avait offert des bijoux ayant appartenus à l'Impératrice Eugénie). En décembre 2007, The New York Times lui rendit hommage en ces termes : "when she died last year at 103, Aimee de Heeren — of New York; Palm Beach, Fla.; Paris; and Biarritz, France — became one more lost link to an earlier age of social grace and high society".

A l'affût des talents de son temps, Aimée de Heeren faisait partie des grandes clientes de Suzanne Belperron. "On peut même aller jusqu'à dire qu'elle était une amie de Suzanne Belperron", précise Olivier Baroin.


Leur importante relation épistolaire, conservée dans les archives personnelles de la créatrice, témoigne d'une attention mutuelle qui s'étend au-delà des échanges relatifs aux commandes joaillières.
Aimée de Heeren, grande admiratrice du travail de Suzanne Belperron soutenait le projet d'un livre sur l'oeuvre de la créatrice, qui aurait été le couronnement de sa carrière. C'est ailleurs pour ce projet, dont Hans Nadelhoffer aurait été l'auteur, que la créatrice rassemblait cahiers de commandes et souvenirs. Aimée de Heeren offrit d'ailleurs à Suzanne Belperron un appareil pour enregistrer ses mémoires, et lui proposa aussi son soutien pour exposer à New York au MET !
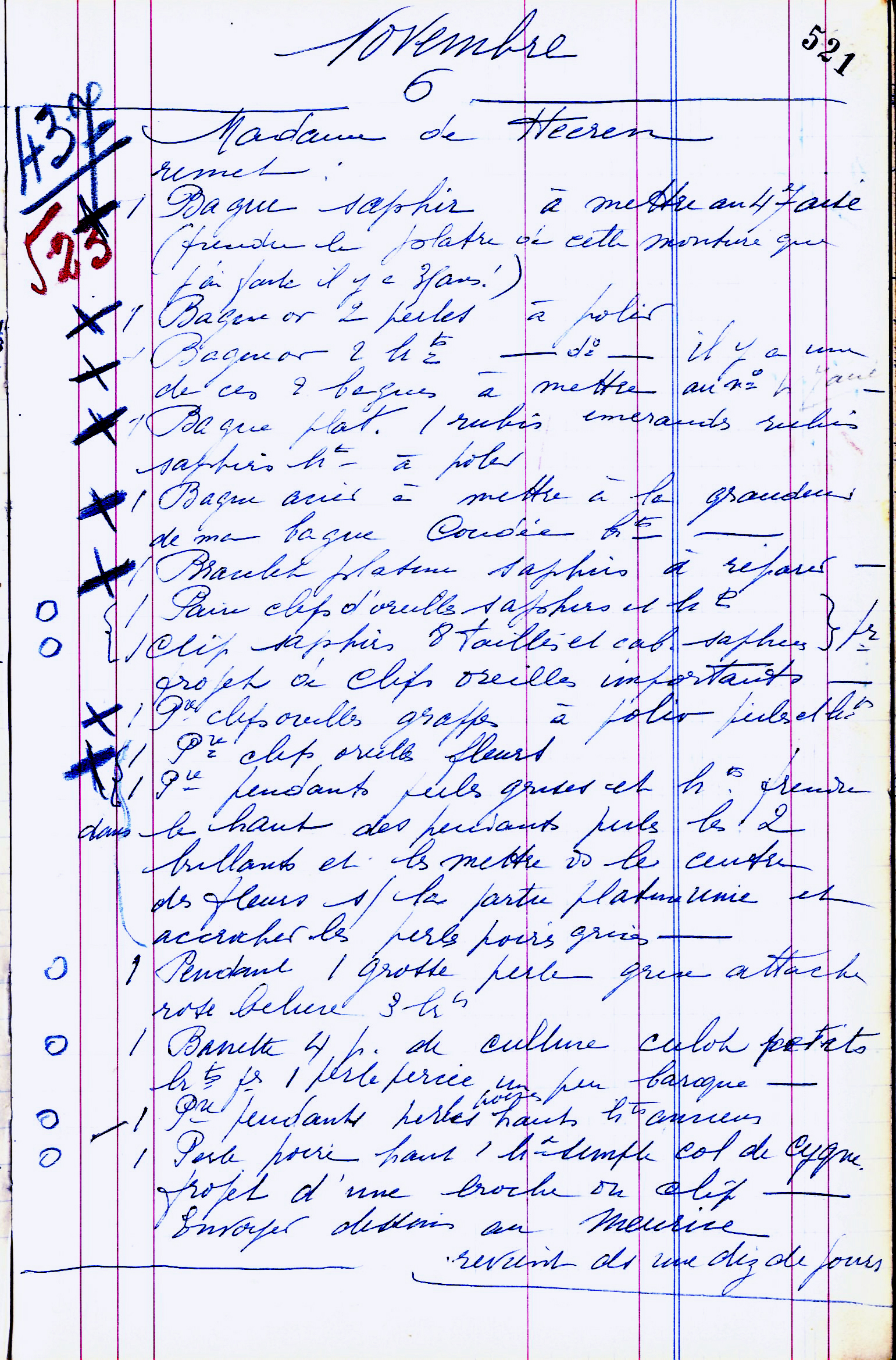
En post-scriptum d'une lettre envoyée de l'hôtel Meurice (au début des années 1980) à sa "chère Amie", Aimée de Heeren décrit, d'un jugement pour le moins définitif, le collier d'inspiration africaine qu'elle avait aperçu des années auparavant chez Bernard Herz et dont elle avait étonnamment conservé intact le souvenir : « Si pendant que vous regarderez vos dessins, si vous tombiez sur celui de ce merveilleux collier en or et diamants, (d’inspiration africaine ?) qui avait de grands clous d’or et que j’ai vu chez Herz en 1939. (...) C’était vraiment merveilleux. Peut-on encore le répéter ? C’est rare un collier en or pour le soir qui soit original et pas les horreurs que l’on voit d’habitude ».
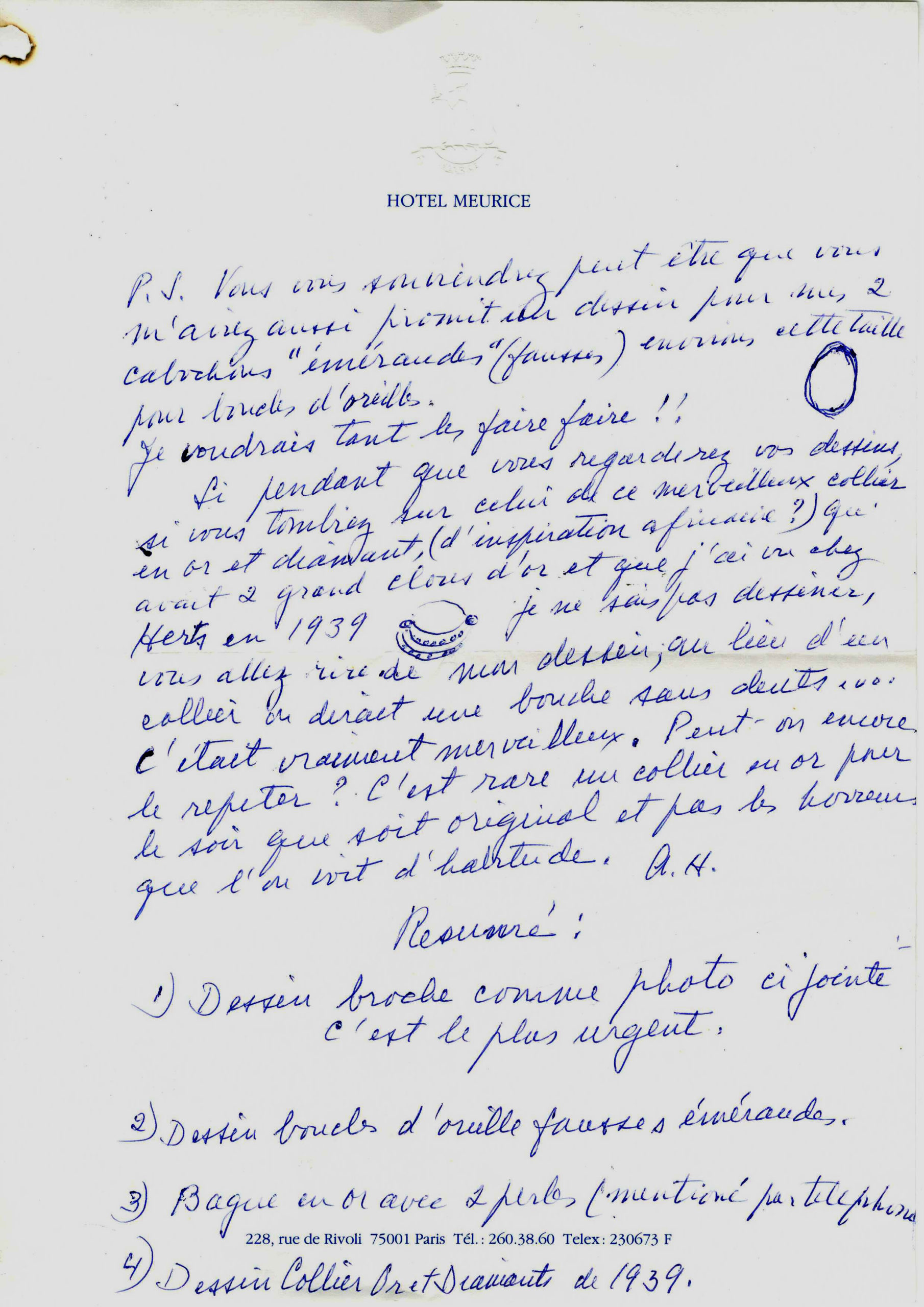
Il est touchant que la réapparition de ce collier fasse renaître tout un pan de la vie de Suzanne Belperron et en particulier cette amitié avec Aimée de Heeren, mondaine fantasque et impertinente incarnant un monde englouti.
Galerie La Golconde - Olivier Baroin
9, Place de la Madeleine. 75008 Paris.
Tel : + 33 (0) 1 40 07 15 69
Suzanne Belperron, Sylvie Raulet et Olivier Baroin,
La Bibliothèque des Arts (version française), 2011.
Antique Collector’s Club (version Anglaise)
***
Les émeraudes de Mellerio, Van Cleef & Arpels et de Belperron : quelques pièces à ne pas manquer lors de la vente Sotheby's, Joaillerie Paris, du 10 juin 2020

Sotheby's présente dans ses salons parisiens une exposition de dix-sept pièces historiques de la maison Mellerio, dont la broche transformable et articulée en émeraude, saphirs, rubis, diamants, formant une plume de paon, achetée par l’Impératrice Eugénie en 1868 et un collier de chien en perles fines, or rose, diamants et émail réalisée en 1900. Cet hommage sera suivi de la vente le 10 juin 2020 de vingt-cinq bijoux Mellerio créés dans les cinquante dernières années.
COLLIER EMERAUDES ET DIAMANTS, MELLERIO, 1977

DEMI-PARURE EMERAUDES ET DIAMANTS, MELLERIO, 1979

BRACELET EMERAUDES ET DIAMANTS, MELLERIO, 1968

COLLIER/BROCHE EMERAUDE ET DIAMANTS, VAN CLEEF & ARPELS

Le motif central amovible, orné d'une émeraude taille coussin rectangulaire pesant 18.22 carats dans un entourage de diamants taille poire et brillant, longueur 420 mm environ, signé Van Cleef & Arpels, numéroté, poinçons français pour l'or 18K (750°/00), poinçons de maître, poids brut 150.95 g, écrin signé Van Cleef & Arpels. Accompagné d'un certificat gemmologique. Lot 267. @Sotheby's Joaillerie Paris, 10 juin 2020. Estimation : 200,000 - 300,000 EUR
CLIP EMERAUDES ET DIAMANTS, "HINDOU", SUZANNE BELPERRON

CLIP EMERAUDES ET DIAMANTS, "HINDOU", SUZANNE BELPERRON. Formant une palmette stylisée ornée d'émeraudes gravées, de diamants taille ancienne et rose, dimensions 54 x 29 mm, poinçons français d'import pour le platine (950°/00) et l'or 18K (750°/00), poids brut 26.60 g, restaurations. Accompagné d'une attestation de Monsieur Olivier Baroin. Lot 252 @Sotheby's, Joaillerie Paris, 10 juin 2020. Estimation: 15,000 - 30,000 EUR
Sotheby's, Joaillerie Paris, 10 juin 2020.
76, rue Saint-Honoré. 75008 Paris.
Téléphone + 33 (0) 1 53 05 53 05
Olivier Baroin
Expert en bijoux anciens Spécialiste de Suzanne Belperron
La Golconde
9 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris
Téléphone : 01 40 07 15 69
Mellerio
9, rue de la Paix 75002 Paris
Te l: + 33 (0)1 42 61 57 53
Email: contact@mellerio.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h
Mellerio, joaillier du Second Empire, Réunion des musées nationaux, 2016.
Mellerio dits Meller, joaillier des reines, Vincent Meylan, Editions Télémaque, 2013
Dix trésors du patrimoine joaillier de l’Institut national de la propriété industrielle
C'est avec émerveillement que j'ai découvert en ce début d'hiver la grande richesse richesse du fonds patrimonial de l'INPI.
Suite à un article que je venais de publier et sur lequel il détenait des informations, Steeve Gallizia, responsable des fonds patrimoniaux et des projets de numérisation de l'Institut national de la propriété industrielle, m'a contactée.
Sous sa conduite et celle d'Amandine Gabriac, chef de projet archivage, j'ai eu la joie de pouvoir consulter quelques pages des lourds catalogues d'archives recensant des décennies d'innovations joaillières, notamment des pages manuscrites déposées au XIXème siècle. Quelle émotion de découvrir tant de noms pour la plupart méconnus, ou oubliés ; quel foisonnement d'idées, de créations ; que d'espoirs et de rêves de grandeur on devine en filigrane derrière toutes ces inventions !
Steeve Gallizia a accepté de nous présenter quelques pépites sélectionnées au cours d'une "chasse au trésor" joaillière.
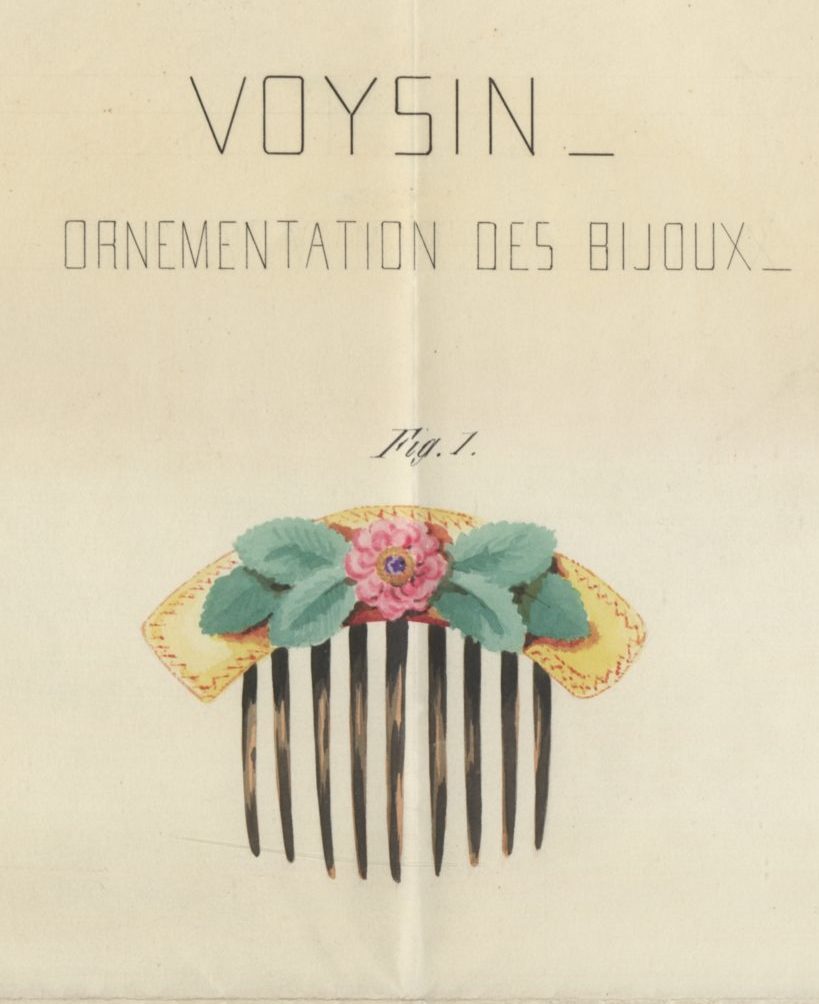
Chasse au trésor ! les joyaux de l'Institut national de la propriété industrielle

L'Institut national de la propriété industrielle en quelques mots ?
L’INPI assure la délivrance des brevets d’invention et l’enregistrement des marques et dessins & modèles en France et recèle des trésors encore méconnus : ses archives !
Héritier des institutions qui l'ont précédé depuis la fin du XVIIIème siècle, cet Institut est devenu la mémoire de l'innovation technique en France. Il conserve dans ses archives un riche patrimoine, constitué par l'intégralité des brevets d'invention déposés depuis 1791 mais aussi des marques de commerce et de fabrique depuis 1857 et des dessins et modèles depuis 1910.
Dans le même élan que celui reconnaissant la liberté de parole, de la presse ou de culte, la Révolution reconnaît à chaque citoyen le droit à inventer : la loi du 7 janvier 1791 relative aux découvertes utiles et aux moyens d’en assurer la propriété à leurs auteurs ouvre la voie aux inventeurs de tous horizons. Ainsi, tout au long du XIXème siècle, près de 410 000 brevets d’invention sont délivrés depuis la loi de 1791 jusqu’à sa révision en 1901.
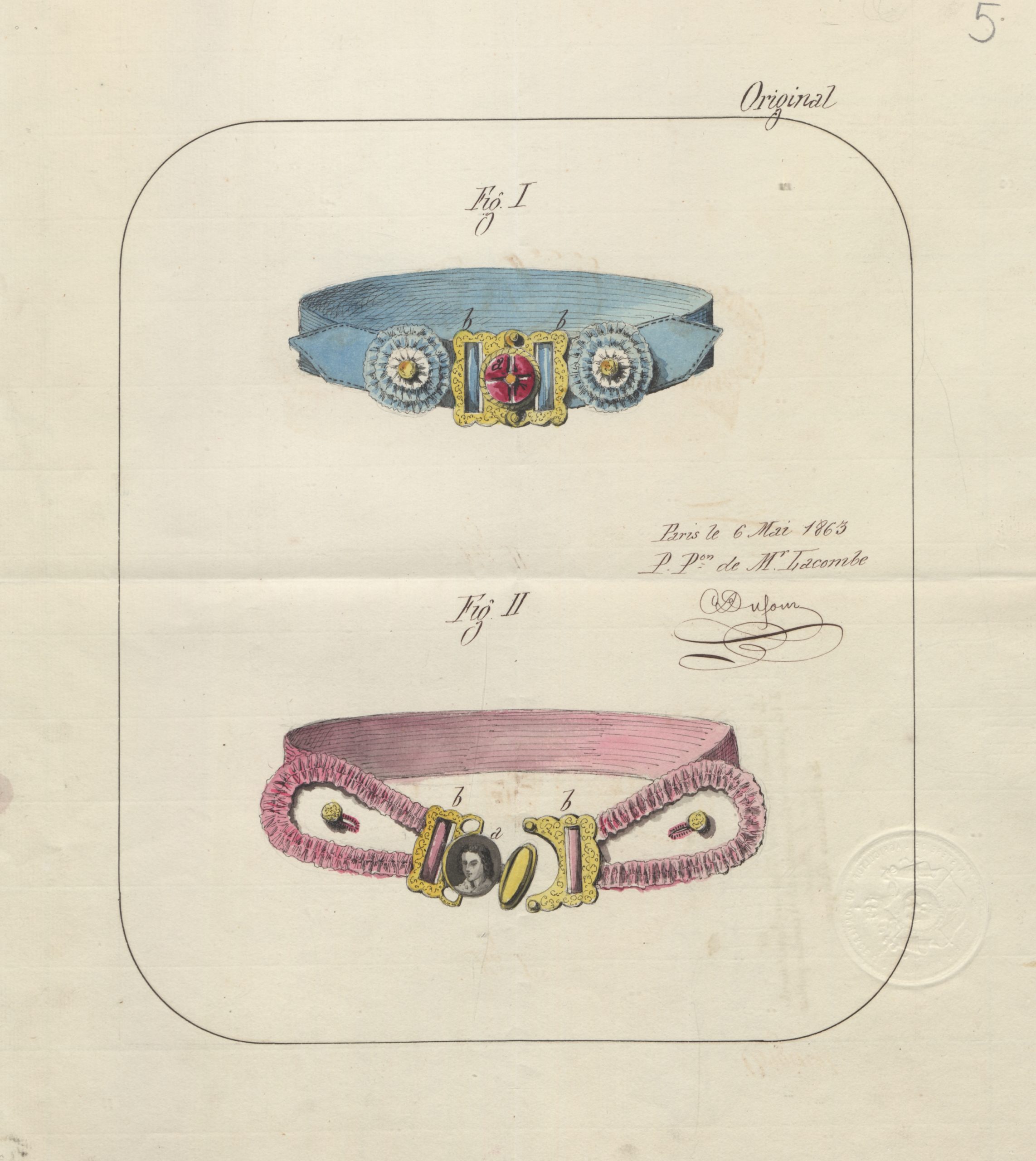
Qui sont les inventeurs venus enrichir les archives de l'INPI ?
Pendant plus d’une dizaine d’années, les archivistes de l’INPI ont classé, reconditionné, inventorié et numérisé, pour préserver et rendre accessible ce patrimoine dont on peut avoir aujourd’hui une vue d’ensemble. Et quelle n’a pas été leur surprise en découvrant, au fur et à mesure de ces travaux, que ces innovations ne sont pas seulement dues à de grands savants ou de prospères industriels tel qu’on peut l’imaginer dans ce siècle de Révolution Industrielle.

Quelle place occupe la joaillerie ?
Tous les domaines techniques, industriels bien sûr, mais aussi artistiques sont représentés. La joaillerie est particulièrement présente. On dénombre ainsi plus de cent trente termes différents pour désigner les professions touchant à la bijouterie, à la joaillerie et aux métiers affiliés. Depuis les joailliers ou les bijoutiers jusqu’aux professions plus spécialisées comme les ciseleurs, sertisseurs, tailleurs de cristaux ou encore fabricants de camées. Cette dernière population témoigne de la diversité des tâches à réaliser pour arriver à un produit fini et commercialisable. Elle témoigne également d’une activité à la fois empreinte d’artisanat et difficilement industrialisable.

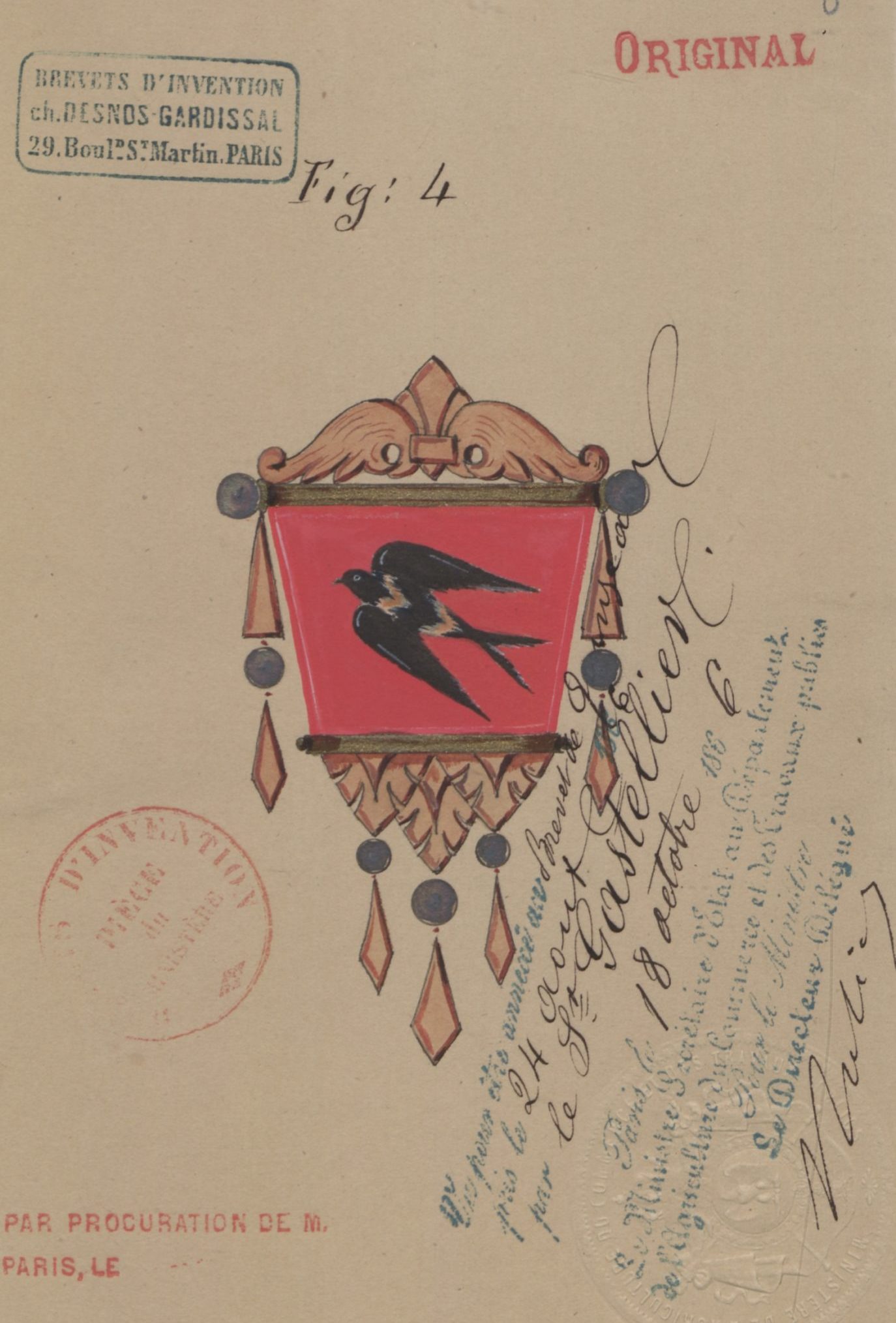
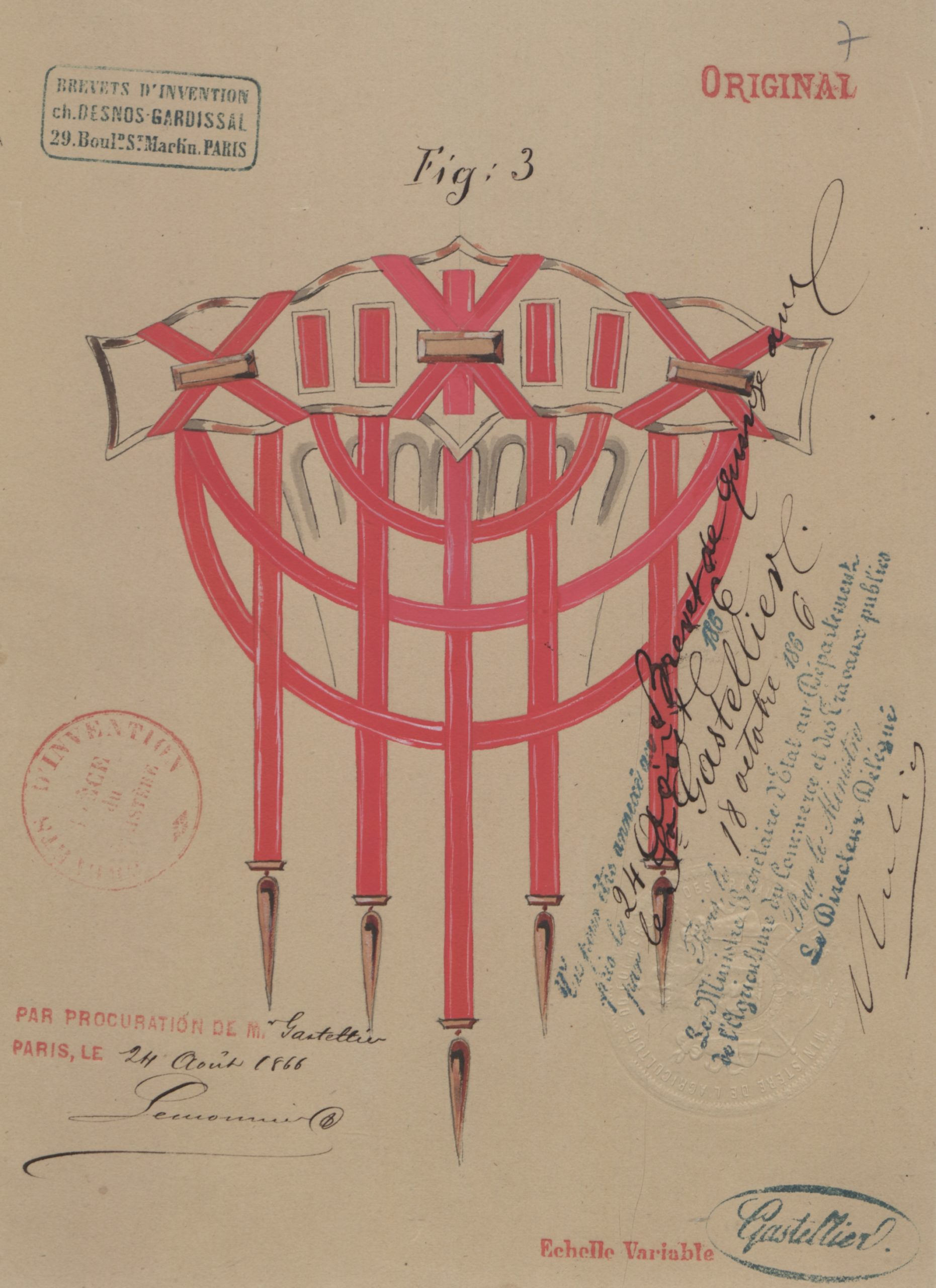
Au sein de la joaillerie, quelles sont les tendances qui dominent ?
Toutes les spécialités participent à cette fièvre inventive, bouleversant parfois les codes et les modes pour créer les tendances de demain. Luxe et raffinement favorisent les innovations pour atteindre des perfections. Certains brevets concernent aussi bien les nouvelles créations, les techniques ou les procédés d’exécution que l’évolution de l’outillage servant à leur fabrication. D’autres traitent des matériaux, précieux et classiques, mais aussi de nouveaux alliages. Parmi les créations, on trouve des bijoux d’apparat mais également des bijoux en faux, des bijoux pour cheveux, des bijoux rubans, des bijoux de fêtes, de deuil, etc.

Brevet d'invention et de perfectionnement déposé le 18 août 1838 par Antoine-Joseph MORIZE, Antoine-Joseph et Louis-Jean-Baptiste VATARD pour un nouveau genre de bijou dit peigne parure à porte-ornement régulateur de la coiffure (1BA6958, planche aquarellée, archives INPI)

Ces quelques exemples, ainsi que les différentes planches tirées des dossiers originaux, illustrent la richesse du fonds conservé par l’INPI. Complémentaires des brevets d’invention, les marques et les dessins & modèles ne sont pas en reste. Là encore, il est possible de retracer l’histoire et l’évolution de la créativité de grandes maisons comme Falize, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Chaumet, etc. On y découvre également une foule d’artisans inconnus mais aussi des artistes fameux qui ont également protégé leurs créations, comme René Lalique (1860-1945).


Les archives de l’INPI sont-elles des ressources pour les historiens ?
Témoignages des techniques et du savoir-faire de l’époque mais aussi des pratiques et des modes, ces nouvelles ressources sont un passage obligé pour qui veut retracer l’histoire de la bijouterie et de la joaillerie. Plus généralement, ce gisement, constitué par les activités de générations d'inventeurs, de créateurs, d’artistes ou d'industriels représente un potentiel scientifique et technique absolument unique en France et constitue une source permanente d'inspiration pour l’innovation d’aujourd’hui et de demain.
Comment contacter l'Institut ?
En tant qu’archives publiques, les fonds historiques conservés par l’INPI sont consultables sur rendez-vous au siège de l’Institut à Courbevoie (92).
Le service des archives gère également les demandes de recherche, de copie de documents, de prêt pour exposition et étudie toute proposition de valorisation de ces archives.
Contact : archives@inpi.fr

***
Tous mes remerciements les plus vifs à Steeve Gallizia et Amandine Gabriac.

Lacloche joailliers : une brillante histoire enfin tirée de l'oubli
Quelle singulière aventure que celle de la maison Lacloche ! Elle aura duré soixante-quinze ans, illustrant un âge d’or de la joaillerie française, brillant dans le monde entier, résistant à deux guerres mondiales, avant de s’interrompre brusquement en 1967, date à laquelle le dernier héritier décida de se tourner vers le design contemporain. Le plus singulier, cependant, c’est que de cette prestigieuse histoire, il ne reste rien. Les archives n’existent plus. Les bijoux sont dispersés. Les catalogues sont difficiles à trouver. La maison Lacloche, un temps si établie et reconnue, aura été le météore de la joaillerie française.

Broche de revers, Lacloche Frères, 1930.
Or, platine, émail, diamants taille brillant et taille rose, saphirs, jadeite, calcédoine, perle et soie. Offerte au Victoria & Albert museum par les amis américains du V&A et de Patricia V. Goldstein. Jewellery, Rooms 91 to 93 mezzanine, The William and Judith Bollinger Gallery, case 68, shelf C, box 3. @ V&A museum.
Il aura fallu le travail inlassable, passionné et minutieux de Laurence Mouillefarine et Véronique Ristelhueber, pour faire revivre le souvenir de cette maison et en exhumer les pièces les plus caractéristiques. Leur livre fruit de presque trois ans de recherches, est le support de l’exposition en cours à l’Ecole des Arts Joailliers. Il retrace une histoire aussi brillante que méconnue.

Légué par Mlle J.H.G. Gollan. Hauteur : 5,3 cm, largeur : 1,4 cm maximum.
@V&A. Jewellery, Rooms 91, The William and Judith Bollinger Gallery, case 31, shelf A, box 4. @ V&A museum.
Quelques mariages et un enterrement
Cette histoire, c’est celle de quatre frères nés dans la plus grande misère, Léopold (1863-1921), Jacques (1865-1900), Jules (1867-1937), Fernand (1868-1931), et de leurs deux sœurs, Bertha (1857-1945) et Emilie (1855-1910). Leur mère, Rosalie Levy, était une femme de tête bien déterminée à faire réussir ses garçons. A la mort de son premier mari, en 1870, elle restait avec six enfants à charge. Elle épousa un bijoutier. C’est cela sans doute qui inspira ses fils. Jules et Léopold ouvrirent la première boutique de la maison Lacloche en 1892, dans le quartier de la Nouvelle Athènes, exactement au 51 rue de Châteaudun, avant de déménager 41 avenue de l’Opéra. En 1898, Léopold s’associe à son beau-frère Louis Gompers, également joaillier sis Place Vendôme et à Trouville. Dans le même temps, Jacques et Fernand ont ouvert une boutique à Madrid.
Jeunes, entreprenants, les frères Lacloche ont connu une ascension rapide. Plusieurs boutiques ouvrent en Europe. Un drame vient frapper la fratrie en 1900. Le train Madrid-Paris déraille le 15 novembre 1900 à hauteur de Bayonne ; l’accident fait treize morts dont Jacques Lacloche. Fernand rejoint alors ses deux frères à Paris et tous trois s’attellent à développer l’entreprise familiale – si bien qu’en 1901 intervient une première consécration : l’installation au 15, rue de la Paix, juste à côté de Cartier. D’autres ouvertures suivront, notamment celle de Bond Street à Londres en 1904. Les Frères Lacloche sont alors dans la force de l’âge, leur clientèle est prestigieuse : l'avenir leur appartient.


LA Collection Privée. © 2019 Christie’s Images Limited. Cette montre-pendentif de femme est présentée à l'exposition de l'Ecole des arts joailliers.

La consécration mondiale : les Expositions de 1925 et 1929


La Première guerre mondiale interrompt pendant quelques années le développement rapide de la maison. Mais les "Années Folles", suivant la guerre, seront indubitablement les années Lacloche.

Laurence Mouillefarine et Véronique Ristelhueber se penchent tout particulièrement sur la grande Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui se déroule en 1925 à Paris. L’idée en avait germé avant la guerre, mais la mise en œuvre avait été retardée par le conflit mondial. Lacloche frères figure en bonne place dans le pavillon dit de la Parure, située au Grand Palais, et dessiné par le designer Eric Bagge.


LA Collection Privée. Photo Bonhams. Cette broche est présentée à l'exposition de l'Ecole des arts joailliers.
A côté de leur vitrine, Cartier, Van Cleef& Arpels, Dusausoy et Sandoz : Les Frères Lacloche font officiellement partie des “happy few” de l’art joaillier mondial. Laurence Mouillefarine et Véronique Ristelhueber se sont lancées sur les traces de cette exposition. A force d’opiniâtreté, elles ont pu dénicher à New York les deux albums de gouaches réalisés en souvenir de l'Exposition. S'y trouvent illustrées toutes les créations (chacune étant unique) exposées sur le stand de Lacloche frères.
Le premier album présente vingt-une pendules, et pendulettes, fabriquées par la maison Verger. Sept de ces objets extraordinaires font partie de l'exposition de l'Ecole des arts joailliers. Ils sont présentés au centre d'une reconstitution suggestive et poétique du hall de la section joaillerie de l'Exposition de 1925.
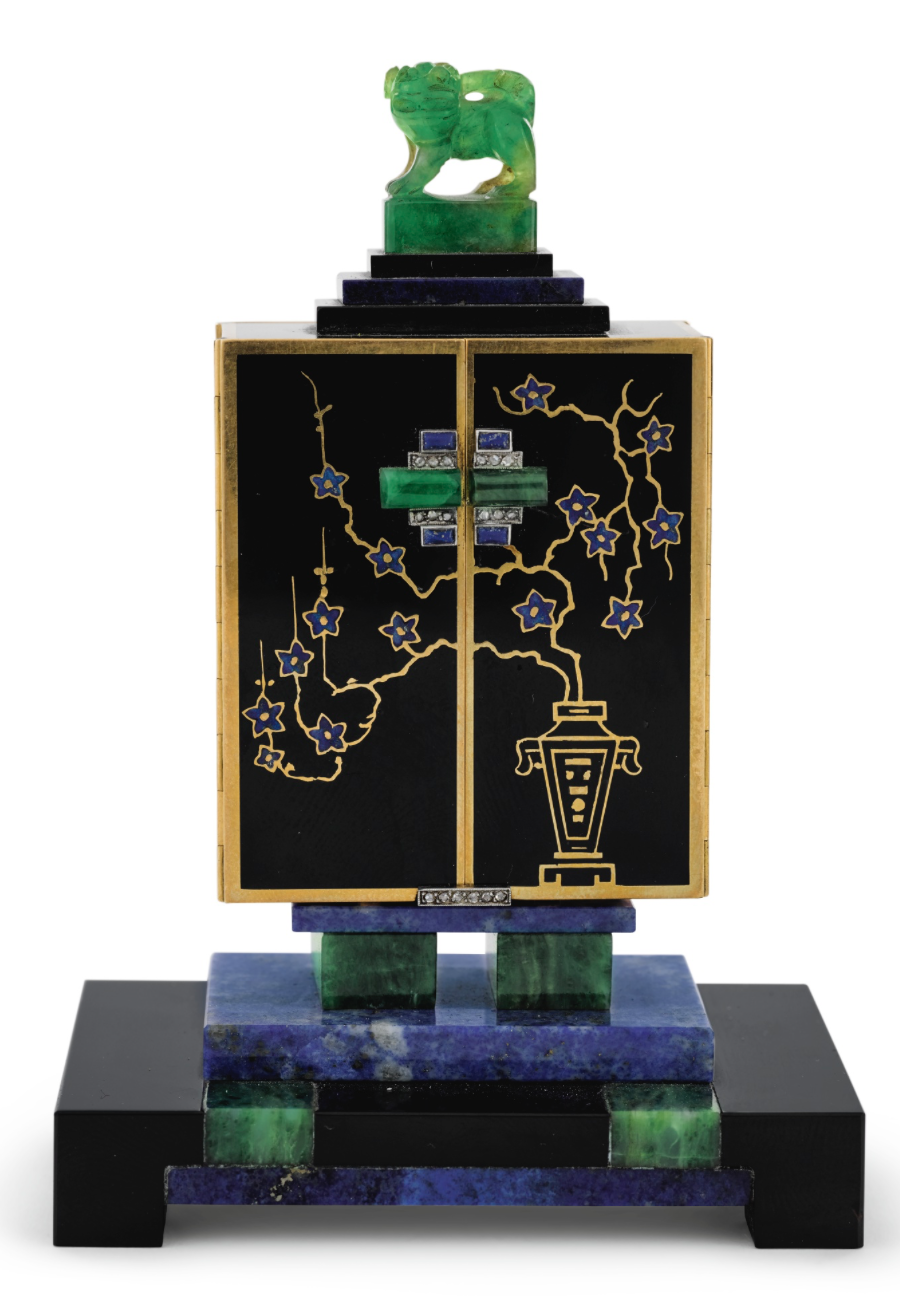

Le second album dévoile soixante-trois dessins de bijoux, étuis à cigarettes et nécessaires ou "vanity case", accessoires si emblématiques des "Années folles". A une mode nouvelle, succédaient de nouvelles parures et objets précieux : les femmes de la Cafe society avaient coupé leurs cheveux à la garçonne, elles portaient des robes souples, fluides, à la ligne droite et aux étoffes colorées. Elles avaient pris l'habitude de se repoudrer en public, de fumer, de conduire! et de nouveaux accessoires de beauté aux vifs contrastes de couleurs, de matières (pierres précieuses versus pierres ornementales) et de diaphanéité (opaque, translucide ou transparent) complétaient cette mode. Lacloche frères a excellé dans l'art du nécessaire de beauté.



Une deuxième occasion de briller fut offerte à Lacloche frères en 1929 lors de l’Exposition des "Arts de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie" au Musée Galliera. On remarque alors une évolution esthétique et stylistique majeure qui sera qualifiée par Henri Clouzot (1865-1941), conservateur du musée, de "grand silence blanc". Lacloche frères présente aux côtés de sept confrères de somptueux bijoux montés sur platine et sertis presqu'exclusivement de diamants.


Ce sera le chant du cygne. La crise de 1929 passe par là, mais aussi les mauvaises habitudes des enfants Lacloche, qui perdent des fortunes au jeu. Dans les années Trente, seuls deux frères sont encore en vie, Jules et Fernand, ce dernier ayant pris les commandes de la Maison familiale depuis 1923. Les dettes contractées au jeu et l’effondrement de grandes fortunes ont raison de la maison Lacloche, qui ferme en 1931, année où meurt Fernand. Une première époque se clôt, qui restera assurément comme la plus brillante de la maison Lacloche.
Le "goût Lacloche" : un hymne au monde des ateliers parisiens
L’usage, on le sait, n’était pas, à l’époque, de se reposer sur un atelier de création interne, mais de faire appel aux très nombreux ateliers que comptait alors Paris.
Bournadet, Chenu, Hatot, Helluin-Mattlinger, Langlois, Lenfant, Pery, Rubel frères, Verger etc... Laurence Mouillefarine et Véronique Ristelhueber mentionnent explicitement dans leur livre les vingt-cinq ateliers qui ont travaillé pour les Frères Lacloche (et dont le nom figurait sur les vitrines de l’Exposition de 1925, Dumont par exemple) : beaucoup ont disparu, d’autres existent encore. A travers l’histoire des Frères Lacloche, c’est un peu l’histoire de ce Paris des ateliers qui est contée par les deux auteurs. C’est aussi un moment de l’histoire du goût joaillier : le génie des Frères Lacloche ne fut pas celui de l’inventivité joaillière, mais celui du choix éclairé, de l’œil, et finalement de l’exigence. C’est pourquoi, dans cette période, les bijoux Lacloche se caractérisent tous par un très grand raffinement technique. Les bijoux Lacloche sont une célébration constante des savoir-faire les plus pointus et les plus rares des ateliers parisiens. Ils sont un hymne à un art disparu.

1952, don de la reine Mary d'Angleterre à Angela Lascelles.
3.6 x 5.2 x 0.6 cm. William Francis Warden Fund. @Museum of fine arts Boston

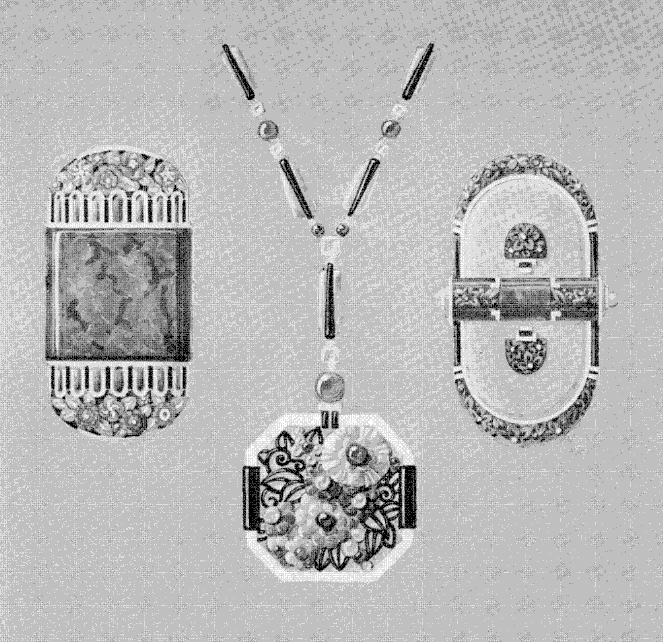

Toutefois, dans ce “goût Lacloche”, on repère aussi les inévitables concessions aux goûts du temps, en particulier l’attirance bien connue pour les pays exotiques, en particulier pour l’Asie : Chine et Japon. Là encore, les Frères Lacloche ne se distinguent pas par l’originalité des objets, mais par l’exigence technique : le degré de sophistication et de précision des bijoux répondant à ce goût pour l’Asie nous vaut des pièces de premier ordre.





Résurrection et bouquet final
En 1936, un autre Jacques Lacloche surgit dans l’histoire de la maison : c’est le propre fils du Jacques décédé en 1900 dans l’accident de train, et qui, né en 1901, n’aura pas connu son père. Il reprend en 1936 l’affaire, la marque, la philosophie de son père et surtout de ses oncles.

La deuxième époque qui s’ouvre alors est parfois considérée par les historiens du bijou comme moins remarquable du strict point de vue joaillier. Elle rencontre cependant un succès éclatant. Partant modestement d’une vitrine au Carlton de Cannes, Jacques Lacloche peut rouvrir une boutique Lacloche Place Vendôme deux ans plus tard. Ce qui compte alors, c’est sa clientèle : la seconde guerre mondiale marque un coup d’arrêt, mais l’après-guerre lui apporte toute la haute société cosmopolite qui s’épanouit alors grâce au développement des transports longs courriers, des magazines, du cinéma. Il bénéficie des derniers feux de l’empire indien et des splendeurs des maharajahs, de la clientèle des vedettes d’Hollywood et de la famille princière de Monaco – ces deux versants étant réunis en la personne de Grace Kelly, à qui Jacques Lacloche fournit un très élégant ensemble composé d'une paire de boucles d'oreilles et d'un clip en saphirs et diamants baguette lors de son mariage en 1956.
Cette clientèle commande nécessairement un goût plus éclectique encore que par le passé, et la maison Lacloche doit se montrer à la hauteur d’attentes diverses dont le point commun est le goût de la sophistication et de la rareté.


A partir des années 60, cependant, c’est le goût de Jacques Lacloche lui-même qui change. Il atteint les rives de la soixantaine et son intérêt véritable se porte sur l’art contemporain et en particulier vers le design, qui connaît alors une véritable explosion. Il transforme le premier étage de sa boutique en salon d’exposition dès le début des années 60, puis en 1967, il prend sa retraite comme joaillier. La boutique ferme. La maison Lacloche se transporte rue de Grenelle et devient un spécialiste d’art et de design contemporains, animé par un Jacques Lacloche dont encore aujourd’hui on peut noter en la matière le goût visionnaire.
Lorsqu’il décède en 1999, le souvenir des Lacloche joailliers s’est évanoui. Les archives n’ont pas été conservées. Ne restent que d’admirables pièces soigneusement conservées par leurs propriétaires, et des allusions dans les livres d’histoire du bijou.
Remonter le fil de cette belle histoire aura requis bien des efforts, mais c’est tout un continent qui revit pour nous. Organiser l’exposition correspondant à ce livre aura été un autre tour de force. Car jamais autant de pièces de la maison Lacloche n’avaient été réunies (soixante-quatorze !) et l’on sent à la parcourir la présence d’une époque et la cohérence d’un goût. Est ainsi conjuré un oubli bien injuste, et les Frères Lacloche reprennent leur rang et leur éclat dans l’histoire de la joaillerie, aux côtés des plus grands noms. Ce n’est que justice et il faut remercier Laurence Mouillefarine, Véronique Ristelhueber, et bien sûr Francis Lacloche, fils de Jacques, qui a soutenu leurs recherches, et l’Ecole des Arts Joailliers de l’avoir aussi bien rendue.
Une exposition, une monographie et quelques autres ouvrages
Exposition du 23 octobre au 20 décembre 2019
Entrée libre du lundi au samedi de 12h à 19h
À L’École des Arts Joailliers
31, rue Danielle Casanova, 75001 Paris
L'exposition sera ouverte au public le 31 octobre, mais fermée les 1er, 2 et 11 novembre.

Lacloche joailliers. Ouvrage co-écrit par Laurence Mouillefarine et Véronique Ristelhueber.
Laurence Mouillefarine, journaliste, spécialiste du marché de l’art, a collaboré avec Architectural Digest, Le Figaro Magazine, La Gazette Drouot, Madame Figaro. Passionnée par la création de l’entre-deux-guerres, elle a été la co-commissaire de l’exposition « Bijoux Art déco et avant-garde » au musée des Arts décoratifs à Paris en 2009.
Elle est l’auteur, avec Véronique Ristelhueber, de Raymond Templier, le bijou moderne, la première monographie consacrée au joaillier (Éditions Norma, 2005). Raffolant des histoires de trésors trouvés dans les greniers, elle a écrit à quatre mains, avec Philippe Colin-Olivier, Vous êtes riches sans le savoir (Le Passage, 2012).
Véronique Ristelhueber est documentaliste et iconographe, spécialiste de l’architecture, du design et du paysage du xxe siècle. Son intérêt pour la joaillerie lui vient des dix années qu’elle a passées aux archives de la maison Cartier.
Publié aux Éditions Norma, avec le soutien de L’École des Arts Joailliers.
Format : 25x3,5 cm. 320 pages, 700 images. Prix : 60 €

A vanity affair : l'art du nécessaire. Rizzoli New York
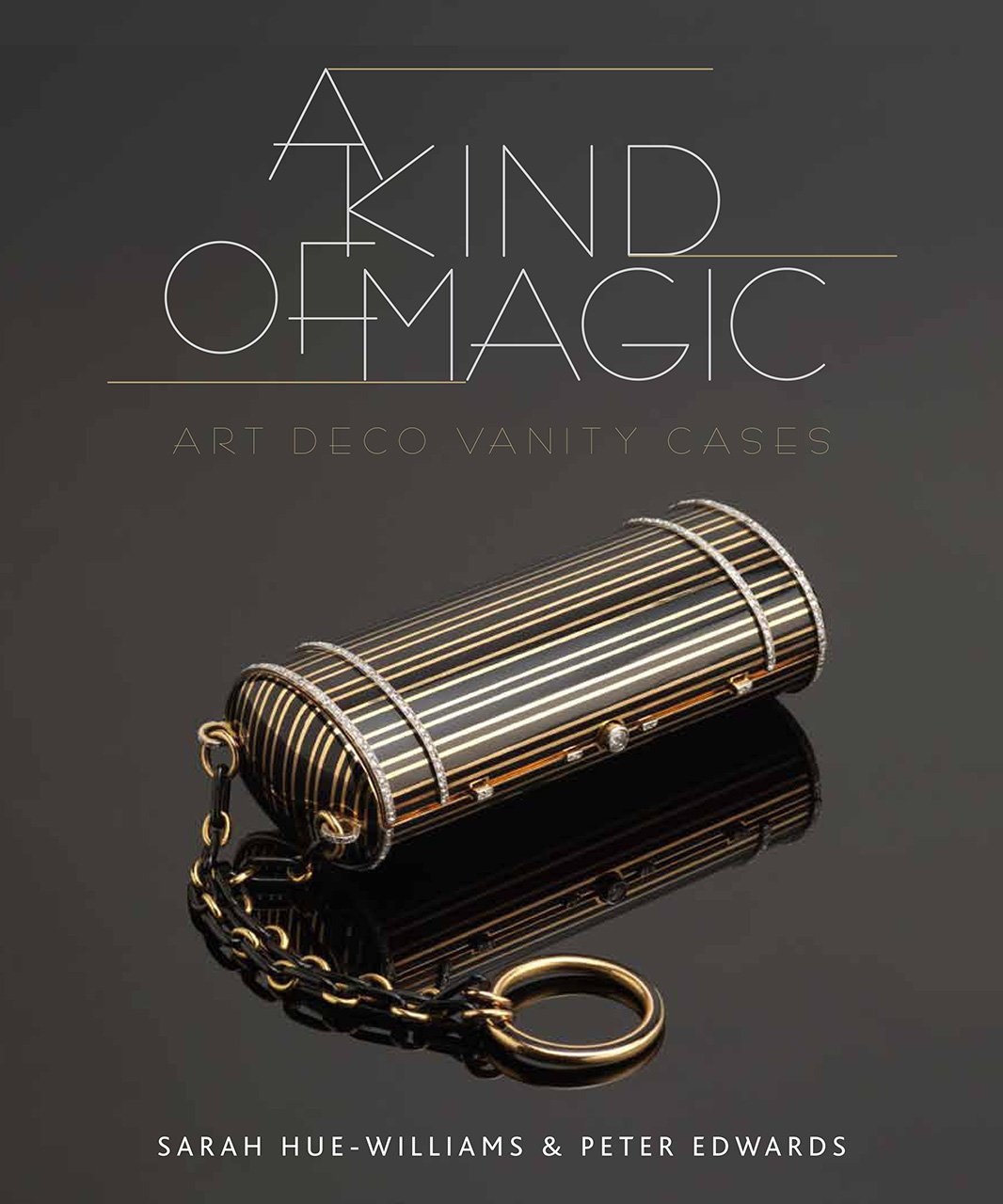
A kind of magic: Art deco vanity cases, Sarah Hue-Williams, Peter Edwards, 2017.

Jeweled splendors of the Art Deco era, the prince and princess Saddrudin Aga Khan collection. Thames & Hudson
Objets précieux Art déco, catalogue d'exposition de la collection du prince et de la princesse Saddrudin Aga Khan. 4 au 25 avril 2018. Ecole des arts joailliers. Cliquez sur ce lien pour accéder aux vidéos relatives à l'exposition.
Article "Lacloche grand joaillier français" (deux parties). Jean-Jacques Richard
A visiter si vous allez à Londres :

La collection des quarante-neuf vanity cases de Kashmira Bulsara, dont trois sont signés Lacloche frères.
Victoria and Albert Museum
Cromwell Road, London, SW7 2RL
à Hong Kong :
L'extraordinaire collection de vanity cases du
Lang Yi museum
181-199 Hollywood Rd,
Sheung Wan, Hong Kong
Acquérir un bijou signé Lacloche frères ou Jacques Lacloche ?
Bernard Bouisset, paire de clips d'oreilles en or jaune, diamants et rubis.
Ventes aux enchères :
A venir :
Christie's Magnificent jewels, Genève 12 novembre 2019. Bracelet rétro en or jaune, saphirs et diamants. Jacques Lacloche. Lot 57.
Sotheby's Magnificent jewels and noble jewels, Genève, 13 novembre 2019. Une broche en diamants, et une broche double clip. Lot 1
Et une ravissante broche "giardinetto" lot 163

Deux nécessaires vendus récemment :

Signé. Travail des années 1925. @ Pierre Bergé & associés. Bijoux, orfèvrerie & objets de vitrine. Mercredi 5 décembre 2018


***
Si vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Property of a lady, veuillez cliquer sur ce lien. A bientôt !

Poinçon d’importation de Londres de 1926.
Fabrication Strauss Allard Meyer.
A Collection Privée. Photo Bonhams. Ce poudrier est présenté à l'exposition de l'Ecole des arts joailliers.
Visuel de "une" : Boîte à cigarettes Art Déco en onyx, émail, turquoise, lapis-lazuli et diamant, Lacloche Frères, 1925. Collection privée. Cette boîte à cigarettes figure dans l'exposition de l'Ecole des arts joailliers. @ Christie's
Les fleurs dans la joaillerie du XIXème au XXIème siècle : une inspiration inépuisable
"Flowers are one of the ways we mark particular moments in our lives, and jewellery is another. It’s a small wonder, therefore, that flowers are a significant theme in the oeuvre of jewellery designers". Carol Woolton
La Nature est une source d'inspiration pour les artistes depuis la Haute-Antiquité : lotus et papyrus sont un motif récurrent des arts de l'Egypte Antique ; chars fleuris, couronnes et guirlandes végétales évoquent les Anciens, Grecs et Romains ; quant à l'art islamique des redoutables Empereurs Moghols, il se caractérise par la très grande richesse de ses ornements végétaux et floraux, l'iconographie du Taj Mahal en est particulièrement emblématique.
L'orfèvrerie aussi est fortement empreinte de cette thématique depuis l'Antiquité. Au-delà de l'aspect proprement esthétique, la fleur revêt une dimension symbolique consacrée, recelant un message qui prend la forme d'un "langage floral" et qui confère une signification très personnelle, intime, au bijou. La Renaissance et l'époque romantique en ont été très marquées.
Au début du XIX ème siècle, une nouvelle impulsion fut donnée au motif floral : les joailliers s'intéressèrent à l'évolution des sciences naturelles et s'inspirèrent d'une science botanique alors en plein essor.

Bouquets de corsage, fleurs fraîches piquées dans les coiffures ou sur les chapeaux, boutonnières d'un soir, ces beautés éphémères furent peu à peu remplacées par des bijoux d'inspiration naturaliste dont le grand mérite était... de ne pas faner !
L'histoire du motif floral et végétal depuis le XIXème siècle nous a laissé de précieuses oeuvres d'art miniatures, et l'évolution de cette thématique traduit celle, parallèle, des techniques artisanales. Les fleurs réalisées en joaillerie sont aussi typiques des personnalités, des artisans joailliers et des Maisons qui les ont produites. Loin d'être simplement un exercice de style obligé, le motif floral favorise de multiples formes d'expression. Toutes les vitrines de joailliers, ou presque, l'attestent. Certaines Maisons se singularisent même par leur choix d'une fleur devenue leur emblème : le camélia chez Chanel, la rose chez Dior, l'orchidée chez Cartier- ou par celui d'un végétal attitré : le lierre chez Boucheron.
Une vaste littérature a été écrite autour des Arts décoratifs inspirés de la nature, des milliers de bouquets joailliers ont été créés, certains sont d'ailleurs inoubliables : la broche rose de la Princesse Mathilde, la broche lilas de Mellerio ou celle de l'Impératrice Eugénie commandée à Rouvenat, le collier noisettes de René Lalique. Le sujet pourrait presque apparaître épuisé.... mais ce serait ne pas tenir compte du goût constant, intemporel et international des femmes pour le motif floral.
La création joaillière contemporaine peut-elle encore briller au regard de ce riche passé ?
Paris, New-York et Genève répondent en choeur avec deux expositions rassemblant un éventail non exhaustif de créations joaillières du XIXème à nos jours : "Dess(e)in de nature" et "In Bloom" et que vient compléter une sélection de très beaux bijoux floraux présentée lors des "Magnificent jewels" de Sotheby's.
La diversité du monde végétal est majestueusement transposée dans le monde minéral : pierres précieuses, perles fines et pléthore de gemmes multicolores offrent une floraison printanière de toute beauté. Les créations joaillières d'il y a un siècle se confrontent à celles d'aujourd'hui. Les inspirations sont multiples, les créateurs proviennent d'horizons géographiques divers, une joute florale oppose les Anciens et les Modernes !


Dess(e)in de nature : Chaumet à Saint-Germain-des Prés


La maison Chaumet présente jusqu'au 14 septembre 2019 (avec une interruption du 15 au 24 juillet) une exposition intitulée "Dess(e)in de nature" dans le charmant hôtel particulier qu'elle occupe jusqu'à début 2010 à Saint-Germain-des-Prés. Placée sous le commissariat de Marc Jeanson, responsable des collections de l'Herbier national au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, l'exposition met en regard les dessins d'atelier et les réalisations joaillières de la Maison. Riche d'un fonds de plus de soixante mille dessins et de photographies prises depuis les années 1890, la Maison a puisé dans les archives de ses différents ateliers pour rendre hommage à une Nature inspiratrice. L'exposition présente aussi quelques maillechorts (un alliage de cuivre, zinc, et nickel employé pour transposer en trois dimensionnels dessins d'atelier avant fabrication) et de très rares pièces de son orfèvrerie.
Si l’Impératrice Joséphine fut une des grandes muses de la maison Chaumet, l'influence majeure de cette exposition est sans conteste Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) dont l'ombre plane sur les dessins d'atelier datés de la fin du XIXème siècle : des observations naturalistes du monde végétal, proches de planches botaniques dont la finesse de trait charme. Marc Jeanson les compare à un "herbier joaillier".
Au fil du parcours que l'on suit sur trois étages, la nature apparaît sous différents jours : sauvage, ordonnée, puis domestiquée.
Au premier étage, la Nature apparaît dans son état sauvage
Nymphéa blanc, cèdre, chêne, lierre, houx... Une luxuriance végétale imprègne les créations joaillières de Jules Fossin et Joseph Chaumet en cette seconde moitié du XIXème siècle.


Clin d'oeil aux ouvrages de botanique du XVIIème siècle : un papillon s'immisce dans la végétation


Au deuxième étage, la Nature est "ordonnée"
La profusion du premier étage laisse place à l'étude, à l'analyse des formes et de leurs variations. D'observateur, l'homme devient un ordonnateur du vivant. Roseau à massette ou "roseau des étangs", avoine, blé sont les nouveaux modèles des ateliers qui s'emploient à les restituer méticuleusement sur papier, puis dans leurs bijoux.


Le troisième étage est consacré à une Nature "domestiquée"
Dans cette dernière section, le créateur interprète et stylise les éléments de la nature qu'il a auparavant observés. L'horticulture, le jardin botanique, le jardin à la française et la folle histoire de l'introduction de la tulipe en Europe témoignent de cette appropriation de la nature par l'homme. Feuilles de vigne et grappes de raisins (demi-parure de J-B Fossin 1820-25), acanthes et fleurs de fuchsia stylisées ponctuent les différentes époques, de l'Empire à nos jours sans oublier la Belle Epoque. Le diadème "Vertiges" créé en 2017 par Scott Armstrong souligne l'audace, le dynamisme et la pérennité de la thématique végétale.






Dess(e)in de nature
Du 19 avril au 15 juin, puis du 24 juillet jusqu’au 14 septembre 2019.
Exposition gratuite, du lundi au samedi de 10h à 18h (réservation recommandée).
Plus d’informations et réservations sur www.chaumet.com
165, Boulevard Saint-Germain. 75006 Paris.
Chaumet, Flammarion, avril 2017.
In bloom : chez Sotheby's à New-York
In Bloom : a selling exhibition of floral jewels. Imaginée par Carol Woolton and Frank Everett, cette exposition-vente retrace l'évolution du motif floral dans la création joaillière depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à nos jours.
"Flowers are where jewellery art can shine, and we weren’t looking for anything in particular except the prettiest flowers" (C'est avec les fleurs que l'art joaillier s'exprime le plus brillamment, et nous ne recherchions rien de particulier si ce n'est les plus jolies fleurs).

L'exposition présente soixante-treize bijoux qui diffèrent par les techniques, le choix des motifs floraux, les gemmes employées et par les origines culturelles des créateurs. Il n'est ni linéarité ni évidence dans cette histoire du motif floral : si d'emblée on croit déceler une veine naturaliste puis assister, à partir des années soixante-dix, à la floraison de fleurs fantaisistes ou imaginaires, un regard plus attentif révèle combien les joailliers brouillent les repères traditionnels et trouvent leur inspiration à tous vents. La nouvelle-garde internationale excelle dans la précision du motif, dans les dégradés subtils ou chatoyants de couleurs que permet la richesse du marché des gemmes actuel, et l'on note enfin la virtuosité technique des réalisations.
L'exposition new-yorkaise dissémine dans ses vitrines pièces anciennes et pièces de facture récentes. Les créations florales joaillières reposent sur des herbes folles, dans une forêt de conte de fées où branches et arbustes scintillent de mille feux. Pour une lecture plus aisée de cette exposition, vous trouverez dans la sélection ci-dessous les bijoux floraux caractéristiques du XXème siècle, puis, dans un foisonnement ordonné seulement par les différentes nationalités des créateurs, celles du XXIème siècle.
Floraison du XXème siècle







Floraison contemporaine
L'Asie à l'honneur
"The Chinese make the most beautiful contemporary flower jewellery, with their use of sculpture and colour" Frank Everett. (Les Chinois créent les plus beaux bijoux contemporains de fleurs grâce à la sculpture et aux couleurs qu'ils emploient) et Carol Woolton ajoute : "They have a whole new aesthetic and perspective" (ils ont une esthétique et une approche complètement nouvelles).
Deux créatrices taïwanaises : Cindy Chao et Anna Hu


Gimel, ou la poésie du Japon

Wendy Yue et James Ganh, talentueux joailliers originaires de Chine



La Grande-Bretagne, et ses "léopards"
Le cercle des "leopards" rassemble des créateurs et des professionnels de la joaillerie britannique. Carol Woolton fait partie des membres fondateurs avec aussi, présents dans cette exposition, Solange Azagury-Partridge, Shaun Leane et Stephen Webster.




Made in US : Irene Neuwirth et Robert Procop


Trois créateurs français : Emmanuel Tarpin, SABBA et Lydia Courteille


13 800 USD

Le Brésil exotique de Silvia Furmanovich

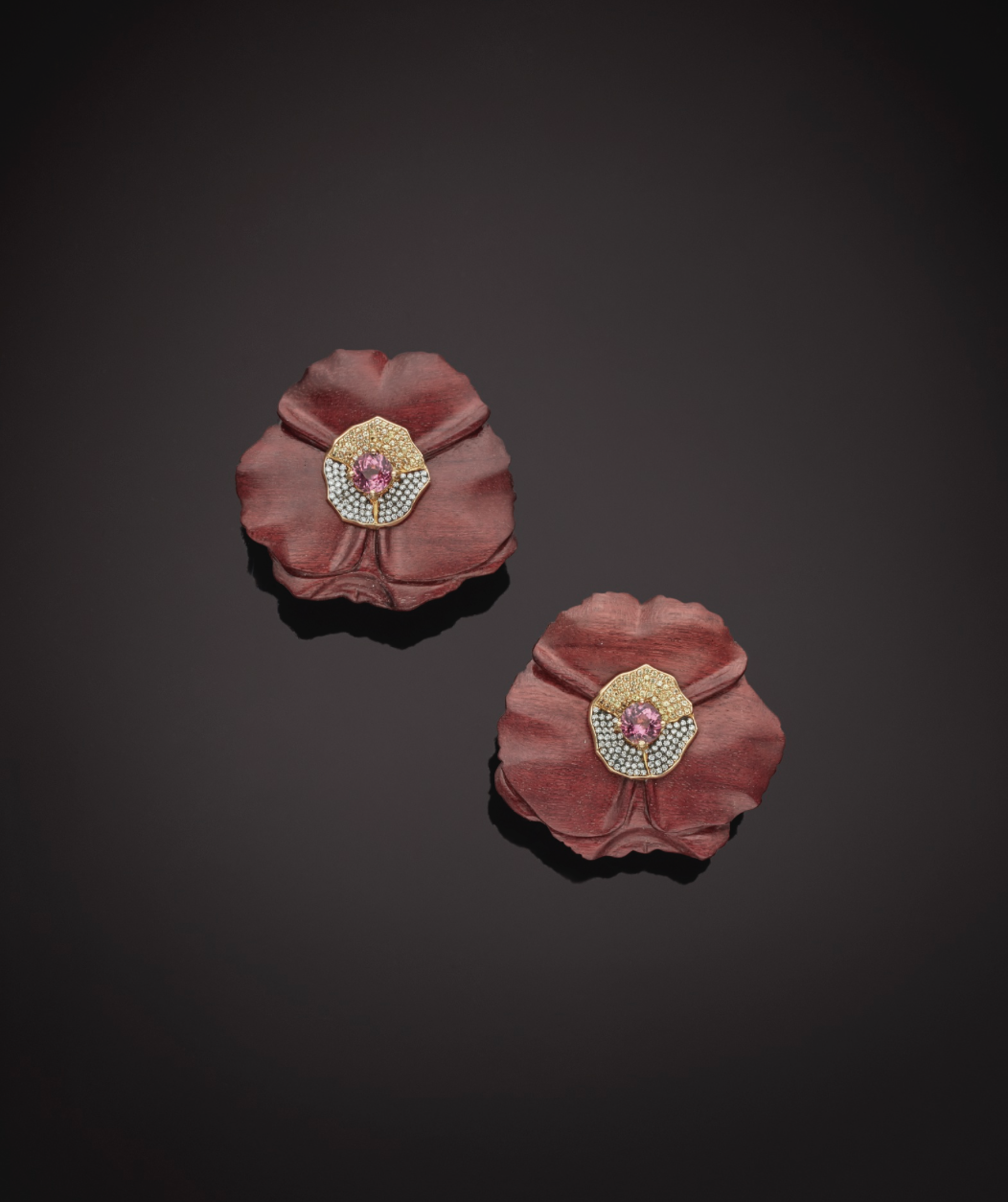
12 000 USD
L'Inde stylisée de Santi et de Neha Dani



"In Bloom : a selling exhibition of floral jewels"
jusqu'au 24 mai 2019, Sotheby's à New-York
1334 York Ave, New York, NY 10021.
Floral jewels, Carol Woolton. Prestel publishing, 2014.
Les sept plus beaux bijoux floraux des Magnificent Jewels de mai chez Sotheby's à Genève
Univers floral stylisé
Un magnifique collier d'émeraude en grappe de Leopoldo Janesich (1802-1880) qui, ainsi que le souligne David Bennett, n'est pas sans rappeler celui redécouvert à peu près à cette époque dans le trésor londonien de Cheapside Hoard



Quatuor de broches Cartier



Fleurs figuratives

Lot 195. Broche en corail et diamants, Cartier, 1960. @Sotheby's


Lot 185. Demi-parure en corail et diamants, «Rose de Noël», et une bague, «Philippine», Van Cleef & Arpels. @Sotheby's
Tous mes remerciements à Monsieur David Bennett, Catherine Allen et Amanda Bass chez Sotheby's
***
A télécharger :
Understanding Jewellery : La nouvelle application incontournable pour les passionnés de joaillerie. Conçue pour les tablettes tactiles, cette application peut être téléchargée via les plateformes de distribution App Store (de Apple) et Google Play (pour appareils Android) pour 19,99$.
A lire :
Flore, Patrick Mauriès et Evelyne Possémé. Collection Galerie des bijoux. Musée des Arts Décoratifs. Octobre 2016.
Understanding Jewellery, David Bennett & Daniela Mascetti, troisième édition, 2015, ACC Art Books, 496 pages.
Pour recevoir la prochaine newsletter de Property of a lady, cliquez sur ce lien. Merci !
***
visuel de "une" : Paire de boucles d'oreilles asymétriques et transformables spécialement créées par Shaun Leane pour "In bloom". Inspirées par l'Art Nouveau, ces boucles d'oreilles sont ornées l'une d'un diamant de couleur vert vif SI1 de 0,89 ct et l'autre d'un diamant incolore D, IF, de 0.82 ct, et de grenats tsavorites et émail. Exposition-vente Sotheby's New-york "In bloom". Prix de vente : 1.100.000 USD.
Marie-Caroline de Brosses, en souvenir
Marie-Caroline de Brosses nous a quittés le 6 avril 2019.
Dernière créatrice de la célèbre Maison Boivin, elle fut également une grande créatrice en son nom propre jusqu'à ce que la maladie la frappe début 2019. De son travail, on retiendra assurément l'originalité des mélanges des matériaux (pierres précieuses et bois naturels par exemple), un style très féminin, l'élégance et bien sûr un humour toujours présent, l'inscrivant, avec son style propre, dans la grande tradition du bijou français et de ses prédécesseures illustres au sein de la maison Boivin.
En mai 2017, nous avions publié un article sur son travail de joaillière de la Maison Boivin, et sur ses créations plus récentes. Elle avait alors accepté de nous consacrer de longues heures pour nous guider dans l'histoire de son travail. Je me souviens aujourd'hui avec émotion de ces échanges sous la véranda de sa jolie maison de Boulogne.
Cet article avait trouvé son prolongement dans une conférence en forme de conversation que nous avions tenue ensemble à L'Ecole des Arts joailliers en janvier 2018. Le public avait alors redécouvert son travail et sa personnalité éminemment attachante. En hommage, nous proposons ici un choix de créations passées en vente ces derniers mois qui ne figuraient pas dans l'article, et qui attestent la vitalité de son imagination et de son caractère d'artiste.
Nul doute que son oeuvre lui survivra.



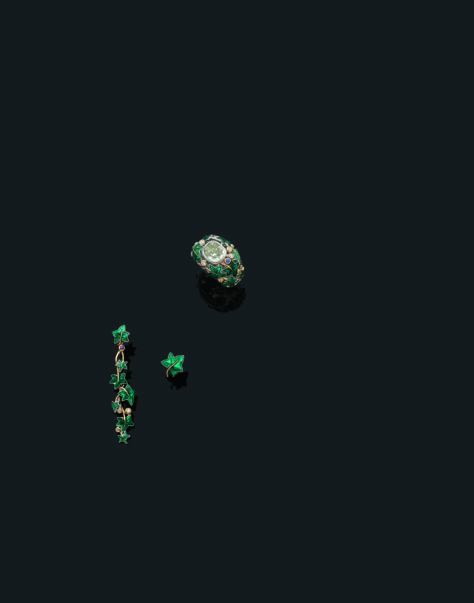



Sotheby's Fine Jewels Londres. 6 juin 2016. Lot 73. René Boivin, vers 1980. Six rangées de perles de culture de couleur grise et crème, un clip central muni d'un fermoir orné d'une kunzite ovale et rehaussé de kunzites de taille circulaire et de diamants taille brillant. Ce bijou peut être porté comme un bracelet avec des perles grises d'une longueur d'environ 160 mm. Ou bien avec les perles grises et crème en tour de cou, longueur du collier d'environ 320 mm.

Sotheby's Magnificent jewels and noble jewels. 11 novembre 2015. Genève. Lot 52. Caractéristique du travail de Marie-Caroline de Brosses, cette broche Botte de Radis en diamants, rhodochrosite polie et grenats tsavorite. René Boivin, 1985
***
Visuel de "une" : Christie's Paris Fine Jewels. 6 juin 2018. Lot 180.
Chevalière en bois et or au motif de tête de panthère.
Jacques Lenfant : inventeur du bijou optico-cinétique
Par Marie-Laure Cassius-Duranton.
Historienne d'Art, gemmologue, professeur au Laboratoire Français de Gemmologie ainsi qu'à l'Ecole des Arts Joailliers.
Photographies : Yves Gellie.

Acrylique sur toile, 170 x 170 cm.
Collection particulière.
Photo © Editions du Griffon, Sully Balmassière © Adagp, Paris, 2018.
Alors que le Centre Pompidou consacre à Victor Vasarely (1906-1997) sa première exposition parisienne majeure, les pièces de la collection « Optical » réalisée par le bijoutier-chaîniste Jacques Lenfant (1904-1996) dans les années 1970 sont toujours plus cotées sur le marché des enchères.
Pendant "Jeux de jetons", Collection Optical,
poinçon de maître Georges Lenfant. Collection privée.




"Vasarely et l’invention de l’art optico-cinétique"

« L’avenir nous réserve le bonheur en la nouvelle beauté plastique mouvante et émouvante ». C’est en ces termes que Victor Vasarely conclut ses Notes pour un manifeste publié à l’occasion de l’exposition de la galerie Denise René intitulée « Le Mouvement » (Paris, 1955). En tant qu’auteur du manifeste, il est considéré comme le « père » de l’art cinétique, du grec kinesis, qui signifie « mouvement, moteur ». Héritier des avant-gardes, l’art cinétique est adoubé par Marcel Duchamp et Alexander Calder qui participent à l’exposition aux côtés de Vasarely, Jesus Rafael Soto, Yaacov Agam, Robert Jacobsen, Pol Bury et Jean Tinguely.

Éditions du Griffon, Neuchâtel
© Editions du Griffon, Neuchâtel
© Adagp, Paris, 2018
Issu de l’abstraction géométrique, l’art cinétique cherche à mettre en valeur l’esthétique du mouvement. Les principes de l’art cinétique associent les fondamentaux de l’art abstrait comme la « composition pure » et la « forme-couleur » aux principes de la perspective qui induisent le mouvement et la durée. Pour Vasarely, l’essentiel est « l’unité plastique » à la fois physique et métaphysique. Il introduit aussi la notion de « produit d’art » qui apparaît comme la condition de l’expansion de l’art à tous les domaines de la vie, de « l’agréable objet utilitaire » à « l’art pour l’art », du « bon goût » au « transcendant ». L’ensemble des activités plastiques s’inscrit dans une vaste perspective (arts décoratifs, mode, publicité, propagande par l’image,…).
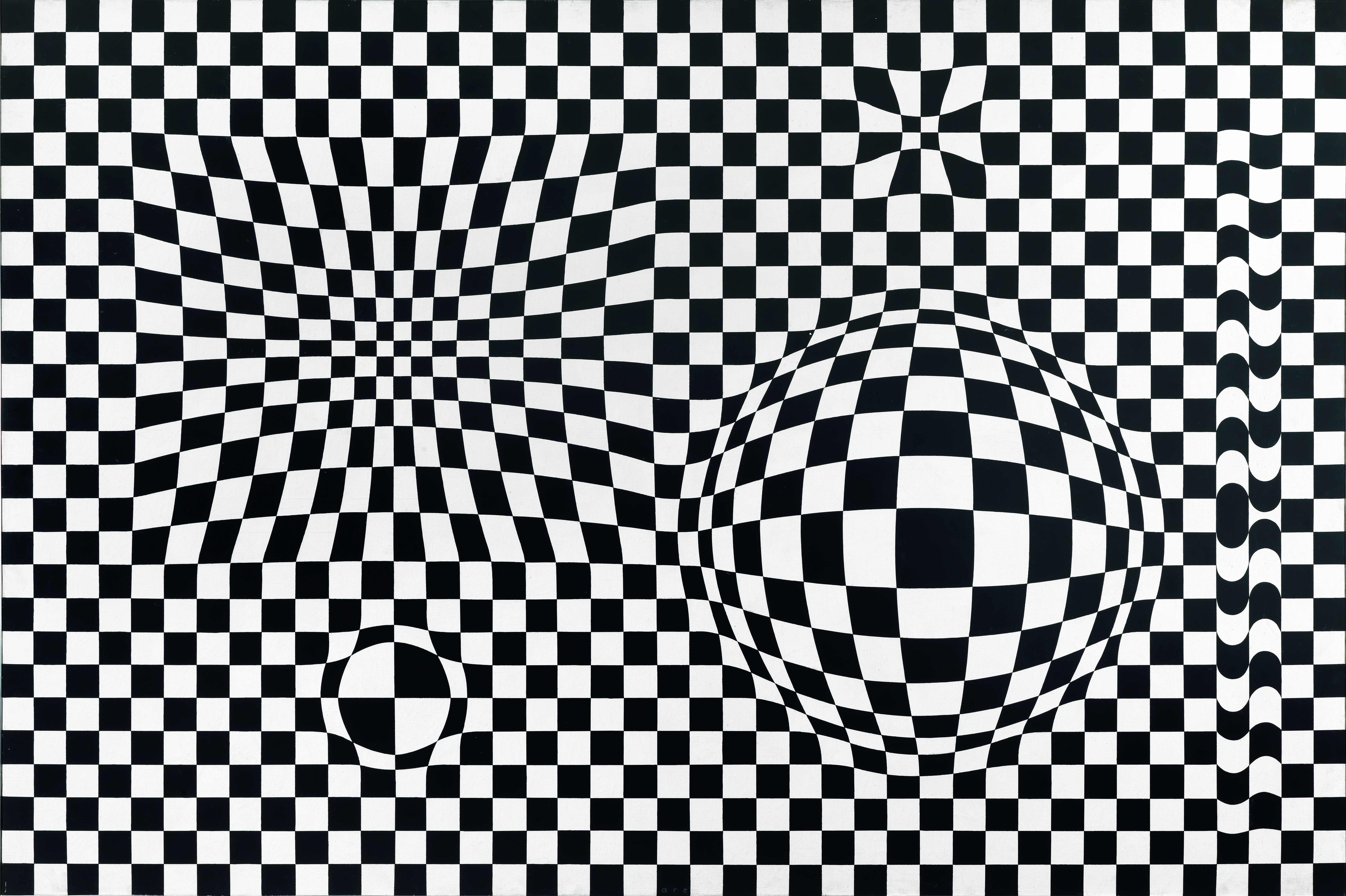
Dans les années 1950, Vasarely réduit son langage visuel au noir et blanc et travaille sur les potentialités de déformation de la grille de la perspective afin de provoquer des effets de dilatation et de rétractation de l’espace. A l’origine de la série des « Vega » se trouve le carré, mais c’est un carré en mouvement, conjugué avec l’ellipse. Les formes géométriques constituent l’essence de son vocabulaire plastique mais elles doivent être dynamiques. Par ces choix, Vasarely propose non seulement une interprétation moderne du trompe-l’œil et de l’anamorphose, mais surtout il cherche à traduire l’énergie des ondes et des particules qui anime l’univers, ce qui existe physiquement mais qu’on ne voit pas. Il est en train d’inventer l’ « Op art ».

Le terme d’ « Op art », abréviation de « optical art », est utilisé pour la première fois dans un article anonyme du magazine Time en 1964. Il définit les œuvres d’art qui utilisent les illusions d’optique dans la relation au spectateur. En 1965, ce mouvement atteint la reconnaissance internationale grâce à une exposition du MoMA de New York : « The Responsive Eye » (l’œil réceptif) à laquelle participe Vasarely. Le commissaire de l’exposition, William G. Seitz, explique : « Ces œuvres existent moins comme objets à examiner que comme des générateurs de réponses perceptuelles dans l’œil et l’esprit du spectateur ».
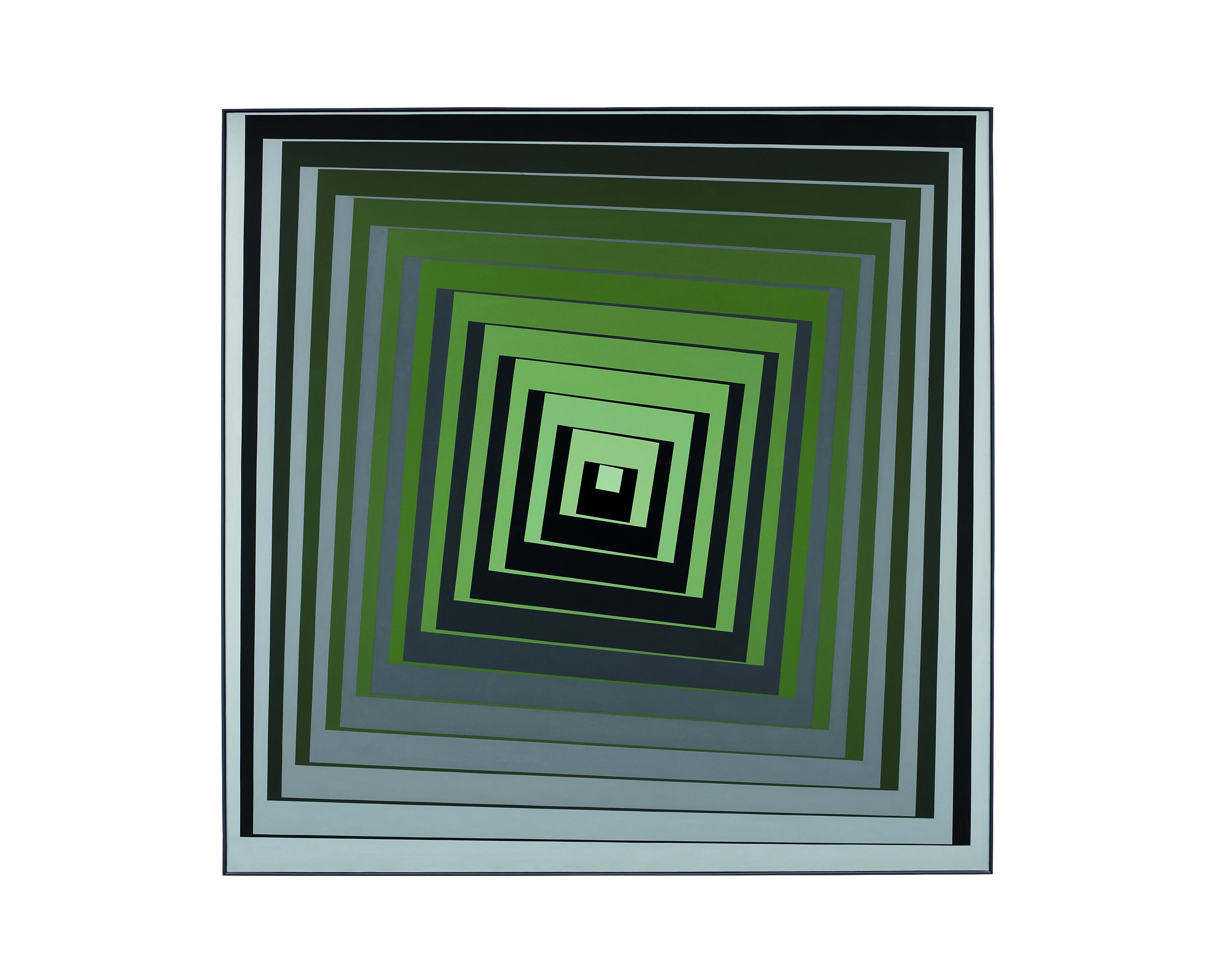
Acrylique sur toile, 180 x 180 cm
Collection particulière
Photo © Editions du Griffon, Sully Balmassière © Adagp, Paris, 2018
Dans les années 1960, Vasarely revient à la couleur et met au point un vocabulaire visuel basique qu’il veut universel et qu’il appelle « unité plastique ». Ce terme désigne l’inscription d’une forme géométrique dans une autre de couleur contrastée. La combinatoire des formes et des couleurs est infinie. Son ambition est de l’étendre à tous les « produits d’art », c’est-à-dire à tous les domaines des arts et de la culture visuelle. Le succès populaire est immense.

Sérigraphie éditée à l’occasion du premier vol spatial habité franco-soviétique Saliout 7, en juin 1982,
et signée par les astronautes Vladimir Djanibekov,
Alexei Ivantchenkov, Jean-Loup Chrétien, 46,2 x 28,4 cm Édition 119/500
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
Photo © Centre Pompidou / Philippe Migeat
© Adagp, Paris, 2018
Dans le domaine du bijou, comment l’art optico-cinétique a-t-il été interprété ?
Jesus Raphael Soto et Pol Bury ont trouvé dans le bijou un medium adéquat alors que Vasarely s’est principalement exprimé à une échelle monumentale, ses trompe-l’œil faisant corps avec l’architecture.
Les seuls bijoux de Vasarely ont été édités avec Circle Fine Art tardivement au milieu des années 1980. Il s’agit du bracelet et des boucles d’oreilles « JOLIE » en argent, nacre et émail noir, édités à 250 exemplaires, dont un ensemble appartient à la collection Diane Venet.

La relation de Vasarely au bijou a donc été plutôt anecdotique. Par contre, les principes de son vocabulaire visuel ont profondément inspiré l’un des bijoutiers les plus importants du XXe siècle : Jacques Lenfant.
"Jacques Lenfant et le bijou optico-cinétique"

Jacques Lenfant (1904-1996)
Jacques est le fils du joaillier Georges Lenfant qui insculpe son poinçon de maître au service de la garantie en 1909 (l’atelier conservera toujours ce nom et ce poinçon). Il commence à travailler dans l’atelier familial en 1915 à l’âge de 11 ans. Jacques réussit à mener de front son travail à l’atelier et ses études secondaires jusqu’au baccalauréat obtenu en 1920. Il poursuit ensuite ses études à la prestigieuse Ecole Supérieure des Arts Décoratifs jusqu’en 1924. Il se spécialise dans le dessin joaillier auprès d’Alphonse Grebel, artiste aux talents multiples, sculpteur, peintre, décorateur, affichiste et joaillier (il gagne une médaille d’or à l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en 1925), puis acquiert de l’expérience en Allemagne, Angleterre et Autriche. Jacques Lenfant se distingue par une connaissance complète du métier de bijoutier-joaillier tant d’un point de vue technique qu’artistique et intellectuel.
Dès la fin des années 1920, l’atelier se spécialise dans le travail de la maille et de la chaîne. Et c'est comme chaîniste que Jacques Lenfant se présente essentiellement. Il écrira d’ailleurs Le Livre de la Chaîne à la demande de la Chambre Syndicale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, publié après sa mort en 1996. Au cours du XXe siècle, l’atelier est devenu propriétaire de Gustave Sandoz et Verger Frères et a travaillé pour de grandes maisons françaises comme Fred, Hermès, Cartier, Mellerio, Mauboussin, Boivin, Van Cleef & Arpels, mais aussi internationales comme Gübelin, Rolex, Tiffany & Co, Bulgari. Très investi dans la profession et dans sa transmission, Jacques Lenfant a occupé différentes fonctions à la Chambre Syndicale et a créé en 1980 un prix destiné à récompenser la meilleure pièce du concours qui réunit les élèves du métier. Le prix Jacques Lenfant continue d’être décerné chaque année.
Profondément ancré dans la tradition, Jacques Lenfant était passionné par la recherche de la nouveauté formelle et de l’innovation technique. Il déposera d’ailleurs à l’INPI plusieurs brevets d’invention ainsi que des dessins et modèles essentiellement relatifs à l’élaboration de chaînes et de tissus ainsi qu’aux systèmes de fermeture.
La Collection Optical
A l’apogée de son art, à la fin des années 1960, il invente la collection OPTICAL et devient l’interprète le plus remarquable des principes de l’art optico-cinétique à l’échelle du bijou.
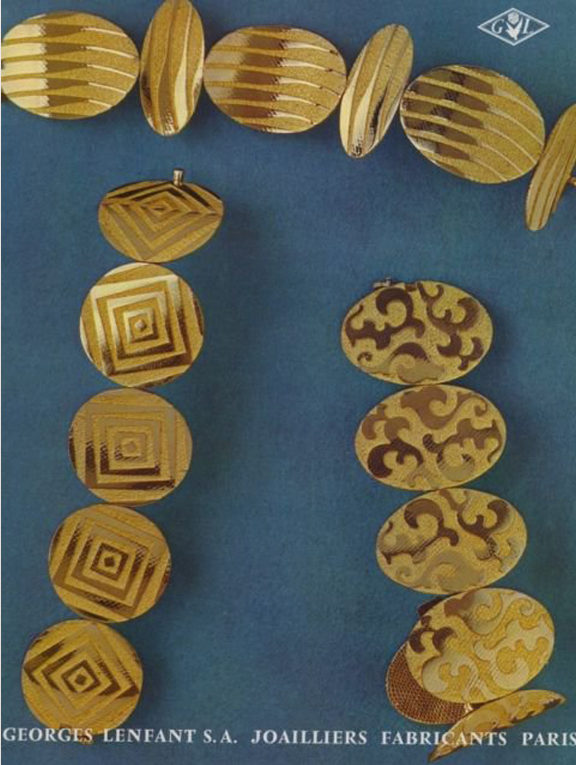
Il s’approprie le vocabulaire formel de Vasarely et transforme son système des couleurs en contraste de textures. Pour répondre à une problématique inhérente à l’esthétique contemporaine, il adapte la technique bijoutière.

Dans la continuité des tissus d’or milanais et polonais réalisés par l’atelier dans les années 1926-1930, Jacques Lenfant met au point la technique du « pur fil pressé relief surfacé diamant ». Il dépose un brevet d’invention en 1970 (INPI FR 2098499 A5) qui sera délivré en 1972. Les dix pages du brevet décrivent une technique assez complexe. Des plaques de tissu souple sont découpées, goupillées verticalement et articulées en vue de produire une surface souple à l’aspect rigide. Le dessin est créé par un estampage à la presse dans une matrice au modèle. L’effet trompe-l’œil est dû à la répétition du motif et résulte du contraste entre les parties pressées, mates et en creux, et les parties en relief, brillantes grâce au poli miroir.
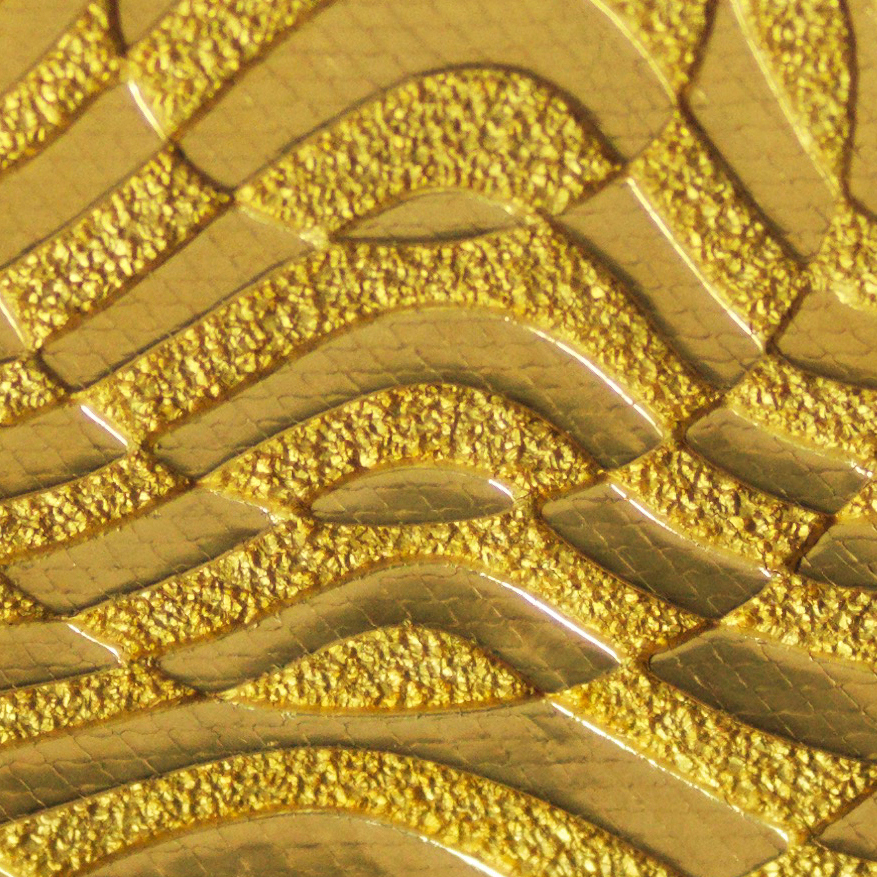

Dans ces pièces essentiellement abstraites, l’impression dynamique est liée aux vibrations alternées de la lumière sur les surfaces. L’effet est inédit et les pièces de cette collection aux noms évocateurs (« Fin de vagues », « Longueurs d’onde », « Sinusoïdes », « Cercles décalés »,…) sont une interprétation réussie des principes optico-cinétiques de l’esthétique contemporaine.


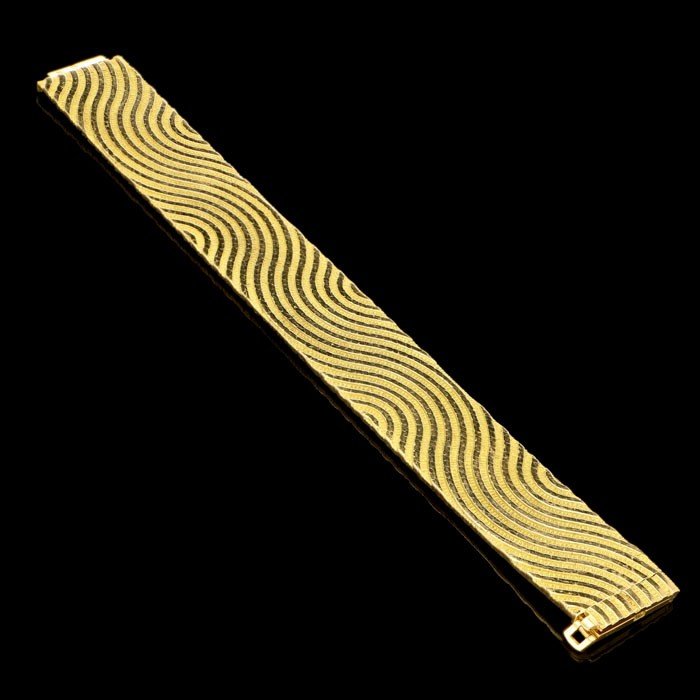
Certaines grandes maisons de joaillerie et d’horlogerie sauront apprécier ces créations. Les bracelets Mikado et Op’Art Vagues de Van Cleef & Arpels sont en fait les modèles « Tournesol » et « Eventail » de la collection Optical. Bulgari a signé le bracelet « Cercles décalés » et Rolex les montres « Tournesol » et « Fin de vagues ».


Après la mort de Jacques, l’atelier Georges Lenfant a été vendu à Benjamin Leneman en 1998. Selon lui, la collection OPTICAL a été un véritable échec commercial. En effet, Jacques Lenfant a consacré beaucoup de temps et d’argent à l’élaboration de solutions techniques novatrices et sophistiquées pour réaliser des pièces probablement trop avant-gardistes pour le marché de l’époque. Parmi les clients de l’atelier, il n’y avait pas que les grandes maisons mais aussi de nombreux bijoutiers de quartier dont la clientèle avait des goûts plus conservateurs. La collection est probablement arrivée trop tôt sur le marché et n’a pas rencontré le succès qu’elle aurait mérité comme les gourmettes de la série « paillette » par exemple (un des « best-sellers » de l’atelier dans les années 1960-1970). La notion de « produit d’art » chère à Vasarely n’a peut-être pas essaimé dans le bijou avec autant de succès que dans d’autres domaines des arts visuels.
Dans les salles de vente
Par contre, ces dernières années, le prestige des pièces de l’atelier Georges Lenfant s’est particulièrement accru chez les collectionneurs et les amateurs comme en témoigne l’évolution de sa cote aux enchères. Le poinçon de maître désormais bien connu a le prestige d’une signature de grande maison. Par exemple, le prix des fameux bracelets « Chaîne d’ancre tressée » d’Hermès flambent dès qu’ils portent le poinçon de Georges Lenfant. Les résultats les plus remarquables ont été réalisés par des pièces de la collection OPTICAL (parfois présentées de manière anonyme par les maisons de vente et généralement accompagnées d’estimations extrêmement basses, mais en général repérées par les acheteurs). Ainsi un bracelet « Sinusoïdes » estimé entre 2000 et 3000 $ a été adjugé 16.250 $ dans la vente Christie’s Jewels online en avril 2016. Le mois suivant, un bracelet « Eventail » estimé entre 2500 et 4500 € atteignait 35.000 € chez Pandolfini à Florence et une montre « Tournesol » signée Rolex culminait à 52.500 CHF chez Phillips à Genève. Dernièrement, un ensemble pendant et clips d’oreilles « Fin de vagues » estimé entre 5000 et 7000 $ a réalisé 27.500 $ et une montre au modèle signée par Rolex 35.000 $ lors de la vente Phillips à New York en décembre 2018.

Aujourd’hui, la plupart des antiquaires et collectionneurs de bijoux anciens cherchent à acquérir des bijoux Georges Lenfant. En particulier, Martin Travis et Sophie Jackson de Symbolic & Chase qui ont réuni un ensemble remarquable de pièces de la collection OPTICAL et ont ainsi participé à la reconnaissance de l’œuvre novatrice de Jacques Lenfant et de sa dimension artistique.
"Bibliographie et remerciements"
Victor Vasarely, Le Mouvement, Notes pour un manifeste, Galerie Denise René, Paris, 1955
William Seitz, The responsive eye, MOMA, New York, 1965
Michel Gauthier et Arnauld Pierre (sous la direction de), Vasarely, le partage des formes, éditions du Centre Pompidou, Paris, 2019
Jacques Lenfant, Le livre de la chaîne, éditions Scriptar SA, Lausanne, 1996
Jacques Lenfant, Bijouterie-Joaillerie, encyclopédie contemporaine des métiers d’art, Dessain et Tolra, Paris, 1979
Bijoux d’artistes, de Calder à Koons. La collection idéale de Diane Venet.
MAD, Flammarion. mars 2018
***
Jusqu'au 6 mai 2019 ne manquez pas l'exposition Vasarely "Le partage des formes" au Centre Pompidou.
6 février 2019 - 6 mai 2019
de 11h à 21h
Galerie 2 - Centre Pompidou, Paris
***
Où acquérir un bijou de Georges Lenfant ?
***
Tous mes remerciements à :
Martin Travis et Sophie Jackson de Symbolic & Chase
Benjamin Leneman, propriétaire de l'atelier Georges Lenfant
Yves Gellie pour sa série photographique du pendant "Jeux de jetons" de la Collection Optical.
***
Si vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Property of a lady, veuillez cliquer sur ce lien. Merci !
Meilleurs voeux aux abonnés
Chers abonnés,
Exceptionnellement, pour faire suite à de nombreuses demandes, l'interview d'Olivier Baroin sur la redécouverte de Suzanne Belperron et sa cote dans les enchères internationales fait l'objet d'une traduction en anglais due aux bons soins de Madame Claudine Seroussi.
Je souhaitais à l'occasion de cette publication vous remercier pour votre soutien constant et croissant. Trois années exactement après le lancement de Property of a lady, les marques d'intérêt et le nombre de lecteurs ne cessent d'augmenter, et je vous en suis profondément reconnaissante.
Mes meilleurs voeux à chacun de vous : que 2019 soit une année lumineuse et colorée de mille feux!
***
visuel Artcurial - vente du 19 juillet 2016 /Lot 65.
Paire de clips de revers "Spire" par Suzanne Belperron vers 1938-39.
Paris Couture 2018 : Rien que pour vos yeux...
Paris - Du 1er au 5 juillet 2018 - Pas d'extravagances d'avant-garde en cette FashionWeek. Mais chez les grandes maisons parisiennes le voeu d'approfondir les fondamentaux, et même de revenir aux racines : Van Cleef & Arpels puise dans les contes populaires racontés par les frères Grimm, Dior réaffirme et magnifie les traits majeurs de son identité esthétique, Chaumet explore les traditions africaines, Chanel crée autour du vaste paravent en laque de Coromandel de sa fondatrice, Coco Chanel, cependant que d'autres ont confié leur imaginaire à cette saison solaire, comme Piaget, et fleurie, comme Boucheron ou Lorenz Bäumer, de manière stylisée ou plus figurative - "voici des fleurs, des fruits, des feuilles" comme disait Verlaine. De là des collections qui vibrent de sincérité et de sens, déployant des savoir-faire éblouissants. Les images cette fois-ci parleront d'elles-mêmes.


Des bijoux à forte identité
"La laque, c'est mon élément, ça ne vous saute pas à la figure. J'ai acheté trente-deux paravents, j'en ai beaucoup donné mais il m'en reste assez pour tapisser ma maison". Mademoiselle Chanel



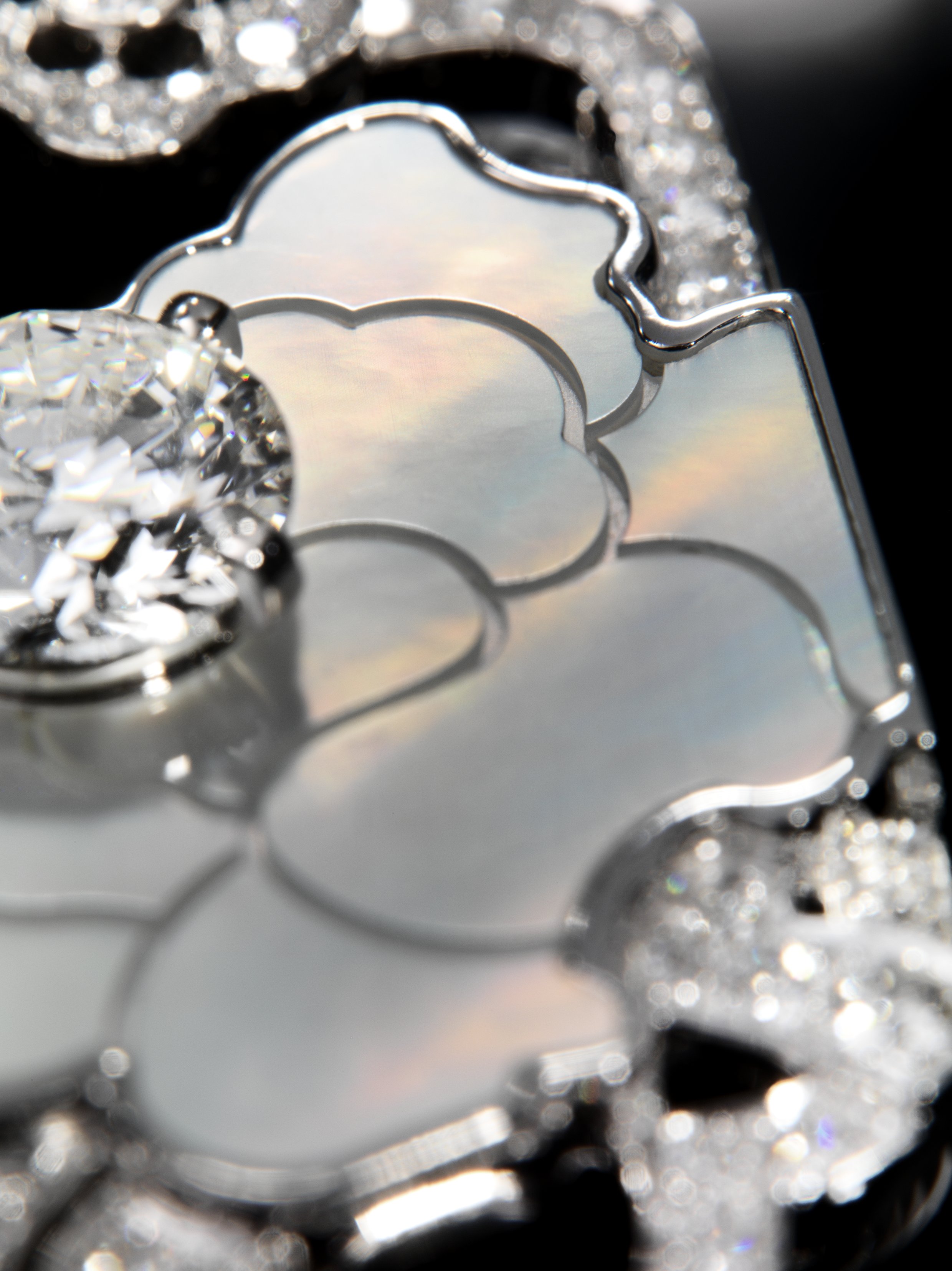
Boucheron : les archives revisitées



Dior joaillerie : la Haute-couture transposée en joaillerie
"J'ai souhaité retrouver la sensation de légèreté aérienne et la signature haute-couture de la dentelle, qui appartient comme le ruban, la soie et les drapés, à l'abécédaire de Dior". Victoire de Castellane.






Des contes réinterprétés, de la poésie, et une pincée de magie
Van Cleef & Arpels ouvre les portes du merveilleux. La Maison transpose dans une collection exceptionnelle de haute-joaillerie quatre histoires des frères Grimm : Les souliers usés au bal, L’oiseau d’or, Les musiciens de Brême et Les trois plumes.








Terres d'Afrique
Chaumet a imaginé de nouvelles créations autour d'un thème cher à la Maison, celui de la Nature. C'est en Afrique pour la première fois que Chaumet est allée puiser son inspiration. Trésors d'Afrique, nom de cette étonnante collection, foisonne de couleurs vives, d'humour, et d'élégance.







Lydia Courteille conte également l'Afrique avec une profonde tendresse, et toujours beaucoup d'originalité. Six bagues, six historiettes du fleuve Okavango près duquel, durant la saison sèche, viennent s'abreuver une riche variété d'animaux sauvages.



La plus jolie saison pour les fleurs? L'été!
L'univers poétique et coloré de Lorenz Bäumer s'illustre dans deux collections, Rêverie d'été et Black Magic.




Calligraphie florale chez Chanel


Boucheron célèbre les cent-soixante ans de la Maison à travers une ode à une "Nature triomphante".


Une véritable prouesse technique se cache derrière neuf bagues appelées "fleurs éternelles". La Maison explique que "des fleurs naturelles, anémones, pensées hortensias, pivoines... sont scannées pour capturer leurs volumes dans les moindre détails. Les pétales sont ensuite stabilisés sans pigment ni substance chimique, puis apposés sur ces formes de fleurs en titane. Le défi étant de protéger leur texture, leur légèreté, leur velouté et leur délicatesse".




***
Si vous souhaitez être tenu informé des nouveaux articles de Property of a Lady, veuillez cliquer sur ce lien.
***
Visuel de "une": Bague double dentelle popeline rubis.
Or blanc et rose 750/1000e, diamants et rubis. Victoire de Castellane. Dior joaillerie.
De l'authenticité des intailles : conversation avec Marc Auclert
Aussi étonnant que cela paraisse, il y a une réelle difficulté à distinguer les intailles antiques des modernes.
Le passage des siècles n’est pas un indicateur pour dater des intailles. Lorsque les gemmes sont conservées dans de bonnes conditions, elle ne « s’usent » pas. On peut y percevoir une patine mais qui ne permet aucunement une datation scientifique de l’intaille. La technique de la gravure ne permet pas non plus d’assigner une date à une intaille puisque les techniques sont restées à peu près les mêmes jusqu’au XIXème siècle. On pourrait penser que les formes des gemmes ou bien que les matières sont différentes selon les époques et la géographie des lieux : c’est en partie vrai, mais pas toujours ! Les intailles de la Renaissance par exemple sont très semblables aux intailles de la Grèce antique. Les sujets et les styles ne permettent pas non plus de les distinguer. A toute époque un lithoglyphe habile a pu reproduire une intaille d’une période antérieure.
Les procédés scientifiques de datation des objets qui aident à la détection comme le carbone 14 (pour les matériaux organiques), la dendrochronologie (pour les objets en bois), la thermoluminescence (pour les céramiques) etc… ne sont d’aucune utilité dans la datation d’une intaille ou d’un camée.


« Quand j’achète une intaille romaine, il est convenu qu’elle est « romaine » à 80 % et à 20% elle est peut-être classique (XVIII-XIXème). Inversement, je peux avoir du très beau XIXème et quand même avoir un doute et me dire que c’est du sublime romain…» reconnait Marc Auclert. La question se pose avec cette paire de boucles d'oreilles : les camées sont-ils du Ier ou du XVIIIème siècle?

« L’iconographie néo-classique XVIIIème et celle du XIXème sont semblables à l’iconographie antique. Les lithoglyphes utilisaient les mêmes pierres, traitaient des mêmes sujets, les outils dont ils se servaient étaient les mêmes de l’antiquité jusqu’aux années 1870-80 » « Mais, précise Marc Auclert, je vois des différences dans les dimensions des gemmes. La plupart des intailles et camées de l’Antiquité sont de petits objets; sauf quelques-uns de provenance impériale et que l’on peut trouver dans les musées. Une grande intaille antique, c’est à mes yeux douteux… Il faut attendre la Renaissance et le XIXème siècle pour avoir de grandes intailles ».
Force est de donc constater auprès des spécialistes de la glyptique, que le doute, parfois l’erreur, font partie de la vie des marchands et collectionneurs d’antiques. Marc Auclert possède dans sa bibliothèque un remarquable ouvrage d’Anatole Chabouillet, numismate, chercheur et conservateur français qui fut en poste un demi-siècle durant au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale. Ce dernier proposait en 1858 une classification des gemmes gravées tout à fait intéressante :
« Les pierres gravées conservées à titre d'antiques dans les cabinets publics de l'Europe devraient, selon moi, être divisées en trois classes, au point de vue de l'authenticité. Dans la première, se placeraient les pierres munies de titres de noblesse en règle, celles qui ont été au Moyen-âge employées à la décoration de croix, de châsses, de reliures de manuscrits, etc., qu'elles soient encore dans des trésors d'église ou qu'elles en soient sorties notoirement, en un mot, les pierres dont on peut prouver l'existence avant la Renaissance de la glyptique en Italie. (…). Dans la seconde classe, viendraient les pierres qui, quoique privées de lettres de noblesse, exhalent un tel parfum d'antiquité, qu'il est impossible de leur refuser créance; encore, même à l'égard de ces pierres d'élite, faut-il s'attendre à ne pas rencontrer l'approbation générale. Dans la troisième classe, enfin, se presseraient en foule les pierres sans histoire, dont le travail, estimable ou remarquable, n'est ni assez franc, ni d'un style à inspirer la confiance à première vue, en un mot, les pierres qu'un connaisseur hésiterait à déclarer antiques ».
In Études sur quelques camées du cabinet des médailles, Anatole Chabouillet, Paris, 1858.


Ce doute sur la datation joue-t-il sur la valeur de l’intaille ?
« Cela ne change pas le prix ! Une jolie intaille à 5000 euros datée de la fin du XIXème sera vendue au même prix que si elle était d’époque Impériale, ce que bien entendu je reproduis sur mes propres tarifs. Évidemment, je préfère qu’elle soit impériale, c’est plus rare et plus émouvant ! »
Qu’en est-il des copies d’antiques ?
« C’est un vaste sujet sur lequel le doute persiste encore. Les faussaires n’ont pas toujours été très adroits, notamment en signant leurs œuvres. Les caractères alphabétiques révèlent souvent des inexactitudes, des fautes d’orthographe ou des mélanges de typographie entre différentes époques. Certains cependant ont été d’excellents lithoglyphes … »

L'histoire raconte que le Prince Stanislas Poniatowski (1754-1833) avait hérité de son oncle une superbe collection de gemmes gravées qui comprenait des trésors de l’Antiquité, de la Renaissance et des pièces modernes. Il se passionna pour cette collection et s’installa à Rome pour l’accroître dans l’environnement qu’il jugeait le plus favorable. A sa mort on découvrit une collection comptant 2601 gemmes gravées dont une vingtaine de camées et le reste d’intailles. Les gemmes étaient dans leur ensemble de grandes dimensions et 1737 d’entre elles portaient la signature d’anciens graveurs. « La collection est pleine d’œuvres de Pyrgotèle, Polyclitès, Apollonide, Dioscuride, en plus grand nombre qu’il n’y en avait dans l’Antiquité », notait D.Raoul-Rochette spécialiste de l'archéologie classique sous la restauration et la Monarchie de Juillet. Le scandale ne fut révélé qu’après le décès du Prince dont on comprit qu’il avait fait réaliser de fausses signatures sur de ravissantes œuvres de la fin XVIIIème et du début du XIXème siècle !
Marc Auclert, pouvez-vous nous dire où les collectionneurs comme vous achètent leurs intailles ?
« J’achète uniquement en salle de vente, chez des antiquaires et chez mes marchands. L’origine des objets est très importante, précise-t-il, et il faut être d’une probité exemplaire dans mon métier. Je me dois de connaître la provenance de tout objet que j’achète. Face au trafic illicite d’objets archéologiques, aux fouilles clandestines, aux pillages d’antiquités, un marchand digne de ce nom ne prend aucun risque. L’objet archéologique est une valeur stable, une valeur refuge et de ce fait il est très recherché ». Et Marc Auclert de conclure : « Pour toutes ces raisons, je n’achète jamais à des particuliers. »
Il y a sept ans, en juin 2011, la Maison Auclert ouvrait ses portes rue de Castiglione, dans le premier arrondissement de Paris. Sept ans… le nombre d’or chez les Anciens, et un premier cycle accompli, durant lequel Marc Auclert a gagné la confiance d’experts et de clients exigeants, dans un domaine où la joaillerie, l’histoire et l’art se rejoignent au plus haut degré.
Maison Auclert
10, rue de Castiglione, 75001 Paris
Tél : +33 (0)1 42 61 81 81
maisonauclert@gmail.com
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 sauf le dimanche
Visuel de "une" : BRACELET GRANDE INTAILLE.
Bracelet en or rouge mat 18K serti d'une large intaille en agate rubannée figurant Hercule appuyé sur sa massue et Vénus accompagnée de Cupidon, travail Milanais du début du XVII° siècle, agrémenté de perles de calcédoines bleues antiques et de diamants cognac (2.77 carats) et milky (5.41 carats).
***
Pour devenir un spécialiste de la glyptique :
Ancient Gems and Finger Rings
Catalogue of the Collections
Jeffrey Spier
This fully illustrated catalogue documents the comprehensive collection of Greek, Roman, Etruscan, and Near Eastern gems in the J. Paul Getty Museum.
Carvers and Collectors: The Lasting Allure of Ancient Gems
March 19–September 7, 2009 at the Getty Villa
Anatole Chabouillet, Etudes sur quelques camées du Cabinet des médailles
Louis XV un moment de perfection de l’art français. 1974, Josèphe Jacquiot.
Josèphe Jacquiot, Mathilde Avisseau, “Glyptique”, Encyclopaedia Universalis.
BnF - Collections du département des Monnaies, médailles et antiques.